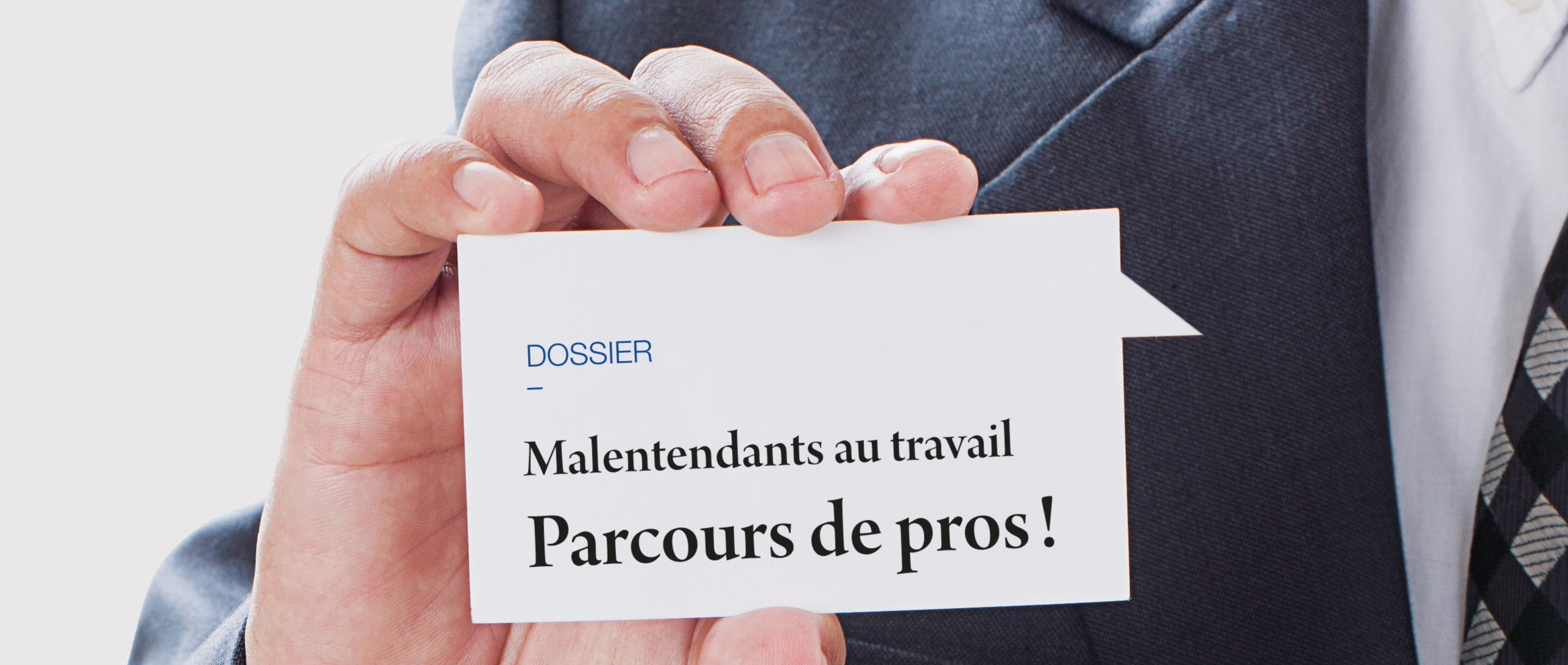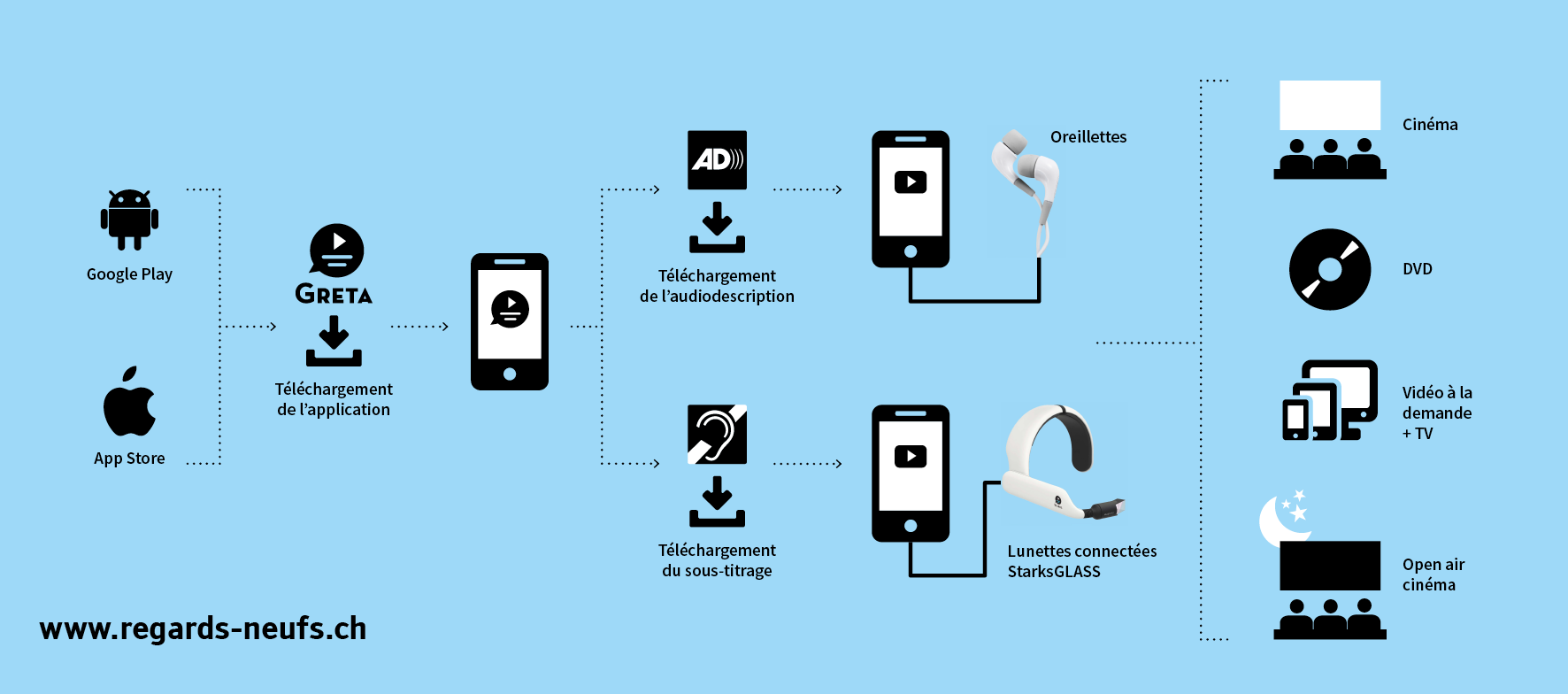2491 résultats
- La moitié des troubles auditifs de l'enfant sont génétiques | FoRom Ecoute
Retour au Magazine La moitié des troubles auditifs de l'enfant sont génétiques 19 novembre 2021 Publié le : Selon une étude dirigée par les Hôpitaux universitaires de Genève et l’université de Genève, et s’appuyant sur des techniques rapides et modernes de séquençage de l’ADN, au moins 52% des troubles auditifs neurosensoriels des enfants, trouvent leur cause dans une origine génétique. Ce résultat souligne l’importance de l’approche génétique pour intervenir précocement et adéquatement sur la déficience auditive. «Chez l’enfant et le nouveau-né, la majorité des troubles auditifs neurosensoriels est d’origine génétique. La littérature scientifique reste néanmoins floue, avec une large fourchette de 10 % à 80 % selon les études», indique Ariane Giacobino, médecin adjointe au Service de médecine génétique des HUG et professeure au Département de médecine génétique et développement de la Faculté de médecine de l’Université de Genève (UNIGE). Selon une étude dirigée par les Hôpitaux universitaires de Genève et l’université de Genève, au moins 52% des troubles auditifs neurosensoriels des enfants, trouvent en effet leur cause dans une origine génétique. L’équipe des HUG a étudié une cohorte de 70 patients suivis en ORL, composée de neuf adultes et de 61 enfants avec des troubles de l’audition ou de perception, réhabilités par un appareil auditif ou un implant cochléaire. La cohorte a été soumise à un séquençage de la portion codante du génome suivi de la lecture ciblée de 189 gènes candidats, une approche connue sous le nom de séquençage de l’exome. Un résultat « stupéfiant » L’étude révèle un taux très élevé de diagnostics génétiques chez les enfants. 52% d’entre eux montrent donc une cause génétique au trouble auditif. Elle révèle également que 46% des enfants avec un diagnostic génétique ont en fait un trouble auditif dans un contexte syndromique plus large. «C’est un résultat stupéfiant, puisque leur bilan ORL et de santé ne permettaient pas de soupçonner de telles affections», explique Hélène Cao Van, co-auteure de l’étude et médecin adjointe responsable de l’unité d’ORL pédiatrique et de pédo-audiologie du Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale des HUG. Pour la santé des enfants syndromiques identifiés par cette approche, le bénéfice est immense. Les reins, les yeux ou encore le cœur peuvent être surveillés de manière anticipée pour prévenir d’éventuelles complications» , souligne Dre Cao Van. De plus, en cas d’hérédité potentielle, l’approche apporte un bénéfice pour les familles en leur permettant de se savoir porteuses des mutations à l’origine de ces troubles. Elles peuvent être ainsi surveillées. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la déficience auditive touche 1,5 milliard de personnes dans le monde, dont un nouveau-né sur 500. C’est pourquoi, depuis 2001, la Suisse procède à un dépistage auditif systématique des enfants et nouveau-nés en mesurant les otoémissions acoustiques (OEA), c’est-à-dire l’activité spontanée de l’oreille en réponse à une stimulation sonore extérieure. Ce test est néanmoins insuffisant pour identifier toutes les déficiences auditives, le trouble pouvant notamment être évolutif et non exprimé à la naissance. Pourtant, un diagnostic précis est important pour la prise en charge ORL, car les causes génétiques peuvent impacter non seulement le fonctionnement de l’oreille et le pronostic thérapeutique, mais également la prise en charge globale du patient. SUIVANT PRECEDENT
- Tahiti dans les oreilles | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Tahiti dans les oreilles 8 septembre 2017 Publié le : De ses souvenirs de voyage à Tahiti, une créatrice malentendante propose des bijoux oreilles exotiques pour habiller les appareils auditifs et les implants cochléaires. Inspirée par un séjour en Polynésie française, Nathalie Birault, qui est malentendante depuis l’âge de 12 ans, développe une série de boucles d’oreilles évoquant l’île aux fleurs, se fixant sur les appareils auditifs et implants cochléaires. Porte-parole L’artiste « emprunte » les fleurs de Tiaré pour créer une « empreinte » emblématique aux oreilles. « C’est une manière de se distinguer, de mieux accepter et affirmer d’être malentendante, tout en féminité. A l’adolescence, il m’était difficile d’accepter mon handicap et l’appareil auditif qui va avec. J’ai commencé par customiser la coque de l’appareil avec des couleurs et de la transparence », explique la trentenaire. Sa marque Odiora, (consonance tahitienne mêlant audition et aura valorisées par un bijou) se décline en six collections. Les Fleurs de Tiaré symbolisent la bienvenue et l’ouverture aux autres. Les Messagers interpellent les personnes entendantes pour les faire entrer dans le monde des malentendants. Les Amulettes dotées d’attrape- rêves, de trèfles à quatre feuilles ou de perles magiques shamballa, protègent la personne qui les porte. Les Design sont épurées et intemporelles. Les Tiny, plus courtes, se placent au-devant de l’appareil. Enfin, les Collectors sont réalisées en collaboration avec des bijoutiers de renom. En fonction des vêtements portés et des envies, les bracelets, colliers et bijoux oreilles fantaisie jouent le rôle de porte-parole, s’adaptent à toutes les marques d’appareils auditifs et d’implants cochléaires, sans chercher à les cacher mais plutôt à permettre de les assumer avec style. Ils sont, de plus, antiallergiques et non- abrasifs. L’accroche faite de silicone se fixe aisément sur le devant de l’appareil auditif et de l’implant cochléaire. Une fixation en forme de serpentin s’enroule sur le tube reliant l’appareil à l’embout. Les pièces des différentes collections se vendent à des prix abordables, disponibles en ligne sur le site internet, auprès d’audioprothésistes et associations partenaires françaises. Et en Suisse ? Odiora cherche des partenaires professionnels de l’audition pour ouvrir les frontières à la mode des oreilles attentives. Une campagne de crowdfunding (financement participatif) va se mettre en place en 2018 pour élancer cette entreprise sociale et solidaire. Formations Durant l’adolescence, Nathalie suit des stages auprès d’audioprothésistes pour appréhender le fonctionnement des appareils. Son bac scientifique en poche, elle réalise qu’elle ne peut se développer dans cette profession à cause de son niveau d’audition. Elle s’oriente alors vers les Beaux-Arts afin de trouver son identité, s’exprimer et inviter les gens à entrer dans sa bulle de malentendante à travers la photo, la vidéo, les installations et le graphisme, qui lui permettront de monter une exposition nommée « Silence ». Avec un diplôme en communication visuelle, l’artiste obtient un poste de webmaster infographiste. Grâce à la mission handicap de l’entreprise, elle a insufflé un souffle nouveau à son travail de fin d’études et réaliser une autre exposition intitulée « Ecoutez voir ». Le Club Affaires 69 lui attribuera le « Prix de la Détermination 2010 ». En 2015, aidée financièrement par une fondation qui soutient les personnes porteuses de handicap dans leur projet de vie (Banque Populaire), la lyonnaise suit une formation en médiation artistique pour animer des ateliers participatifs reliant entendants et malentendants. Entourée d’une fine équipe de bijoutiers créateurs, l’artiste lance son concept et ouvre son atelier, soutenue par des sociétés et associations comme Ronalpia, incubateur d’entrepreneurs sociaux. La fabrication des bijoux est confiée à des personnes handicapées formées par la fondatrice d’Odiora. Odiora a, en outre, présenté ses créations au Congrès des Audioprothésistes à Paris en avril 2017 durant trois jours et l’intérêt des professionnels de l’audition s’est fait entendre ! Elle a également reçu de nombreuses distinctions ses deux dernières années, notamment : le Trophée de l’Innovation remis par l’Agefiph, le 1er prix du Social Business Challenge, le 2e prix Handi-Entrepreneur ATOS, la Fabrique Aviva. Avis à la gent féminine, appareil auditif rime avec élégance et culture, à portée d’oreilles! Plus d’infos sur http://www.odiora.fr/marque/la-creatrice- d-odiora/ A suivre sur les réseaux sociaux : Facebook , Twitter , Instagram et Youtube SUIVANT PRECEDENT
- René Schwab nous a quittés | FoRom Ecoute
Retour au Magazine René Schwab nous a quittés 10 décembre 2020 Publié le : Président de l’Amicale des malentendants de Neuchâtel durant 3 décennies, cheminot et fier de l’être, René Schwab est décédé le 5 décembre dernier à l’âge de 94 ans, au terme d’une vie bien remplie, marquée par un engagement associatif sans failles. La communauté des malentendants se souviendra longtemps de sa grande silhouette et de son sourire affable, lui qui ne ratait jamais les rencontres que forom écoute organise chaque année. Ancien président de l’Amicale des malentendants de sa ville, le Neuchâtelois René Schwab nous a quittés le 5 décembre dernier, dans sa 94e année. Pour qui ne le connaissait pas, René Schwab était un homme discret, timide presque, et dont le visage arborait un éternel sourire. Mais il suffisait de le rencontrer pour constater à quel point cet homme d’engagement, qui a élevé 4 enfants dont la réussite professionnelle faisait sa fierté, était animé d’une joie de vivre, d’un humour, d’une force de caractère et d’une gentillesse hors normes, lui sur lequel le poids des ans semblait ne jamais avoir prise. « La seule chose qui m’enquiquine vraiment, c’est d’être aussi vieux, nous déclarait-il pourtant avec malice, à l’occasion d’un portrait que nous lui consacrions il y a déjà 10 ans . Il y aurait encore tellement de choses à faire. Mais j’ai un arrière-fond chrétien. Et tous les soirs, je suis reconnaissant d’avoir pu faire tout ce que j’ai fait dans la journée ! » Dévouement La reconnaissance, tous ceux qui l’ont rencontré pourraient également l’éprouver tant cet homme aux origines modestes et veuf très tôt, a voué une large part de son existence aux autres, à travers son engagement associatif, au sein d’un club de loisirs du 3e âge, mais surtout en faveur des personnes souffrant de troubles de l’audition, lui-même n’étant pas atteint par ce handicap dont il connaissait pourtant parfaitement les vicissitudes. C’est en effet au milieu des années 70 que cet employé des CFF, ancien conducteur de locomotive et père de 4 enfants intègre, un peu par hasard le comité de l’Amicale des malentendants de Neuchâtel. Un comité dont il prendra la présidence quelques années plus tard, occupant ensuite cette fonction avec dévouement durant pas moins de trois décennies. Le nombre de membres baissant régulièrement, l’Amicale finit par se dissoudre en 2011, à la grande tristesse de René Schwab qui eut bien du mal à accepter cette disparition inexorable, lui qui si souvent, déplorait avec fatalisme l’absence de relève. René Schwab était un homme très indépendant qui avait le goût du bonheur et des choses simples. Il manquera à tous ceux qui l’ont côtoyé. SUIVANT PRECEDENT
- Culture et Droits | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Culture et Droits 21 mars 2019 Publié le : Le Forum valaisan « Ma culture – Ta culture - Notre culture », ouvert à tout public, qui se déroulera le 16 mai 2019, porte sur les droits des personnes handicapées, dont les personnes avec un handicap de l’ouïe. A vos agendas. Pour faire le point et explorer les mesures mises en place dans le canton du Valais, la Fondation Emera et la Haute Ecole de Travail Social de la HES-SO Valais-Wallis organisent le Forum « Ma culture – Ta culture - Notre culture », qui se déroulera le 16 mai prochain à Sierre. Les conférences seront traduites simultanément en français, en allemand et en langue des signes, LSF. Une aide est prévue sur demande pour les personnes ayant besoin d’accompagnement. L’article 30 de la Convention de l’ONU, signée en 2014, stipule le droit des personnes en situation de handicap à la « participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports ». Celui-ci doit être appliqué par des mesures d’accessibilité aux produits et lieux culturels, tels que l‘accompagnement et l’accès aux bâtiments ou le droit à l’expression du potentiel créatif, artistique et intellectuel. Ce Forum permettra aux intervenants et aux visiteurs de se pencher sur les deux premiers alinéas de cet article 30 de la Convention de l’ONU et rendre visible sa mise en œuvre. Des organisations au service de l’humain Depuis 80 ans, la Fondation Emera œuvre pour améliorer la qualité de vie de personnes subissant un handicap physique, intellectuel et/ou psychique sur tout le territoire valaisan. Le but étant d’améliorer leur autonomie et leur participation à la vie sociale. La Fondation travaille en étroite collaboration avec les institutions publiques, privées et les associations d’entraide. La Haute Ecole de Travail Social de la HES-SO Valais-Wallis, quant à elle, forme des futurs travailleurs sociaux, en vue du Bachelor HES-SO à travers sa filière en Travail social. Ensemble, ces deux organisations chapeautent et financent le Forum « Ma culture – Ta culture - Notre culture », soutenues par l’association Forum Handicap Valais-Wallis. Celle-ci représente la faîtière des organisations d’aide et d’entraide valaisanne dans le domaine du handicap. Elle défend les intérêts collectifs des personnes en situation de handicap en Valais. Le rôle du Service Social Handicap de la Fondation Emera envers les personnes touchées par un handicap s’appuie sur le droit à chacun, dans la mesure de ses possibilités, de pouvoir décider et organiser sa manière de vivre. Vous favorisez leur participation sociale de manière individuelle, collective ou de durée indéterminée, ainsi que la réalisation de leurs habitudes de vie et leur autonomie, ainsi. Pour cela, les consultations auprès des assistantes sociales du SSH offrent conseil, information et orientation pour les personnes concernées et leurs proches. Questions-réponses avec l’assistante de direction du Service Social Handicap de Sion, Sarah Dujoncquoy. Pouvez-vous nous donner un exemple de mesures concrètes mis en place pour les personnes malentendantes ? SSH a assuré un suivi du concept de cantonalisation de la logopédie pour intégration des besoins spécifiques des enfants malentendants. Certaines assistantes sociales (AS) du SSH formées spécifiquement à la langue des signes. Dans leur accompagnement des clients, les AS du SSH veillent à l’application de la LHand et la Convention de l’ONU (ex. garantir l’accessibilité des services publics aux besoins des personnes malentendantes). Alors que la Constituante valaisanne a quatre ans pour mettre en place son intégrale révision sous la coupelle du Conseil d’Etat, qu’escomptez-vous comme futures mesures ? La reconnaissance de la langue des signes, l’accessibilité garantie de l’environnement bâti et urbain et des dispositifs de communication accessibles pour tous. Les deux précédentes éditions portaient sur la mise en œuvre de la Convention en général, puis sur l’article 19 de cette Convention traitant du libre choix du lieu de vie. Quels impacts favorables ont-elles apportés ? La sensibilisation générale des politiques, de l’administration et du grand public valaisans. Plus encore, des discussions en cours avec l’Etat du VS concernant l’élaboration d’une politique cantonale du handicap. Egalement, la flexibilisation de l’offre des institutions spécialisées, vers des solutions plus individualisées de prise en charge, respectant plus les choix des personnes en situation de handicap qu’elles accompagnent. Enfin, l’augmentation des moyens investis par l’Etat du VS dans le maintien à domicile (ex : augmentation du nombre d’heures de soutien socio-éducatif à domicile). Forum « Ma culture – Ta culture - Notre culture » Dans le cadre du Forum du jeudi 16 mai prochain, les organisateurs invitent des acteurs des domaines institutionnels, étatiques, universitaires et culturels à débattre. Environ 300 visiteurs cible sont attendus à l’Aula de la HES-SO Valais-Wallis, à Sierre. Personnes en situation de handicap, proches, professionnels ou bénévoles accompagnant des personnes en situation de handicap au sein d’une institution spécialisée ou une organisation d’entraide, enseignants et élèves de la HES-SO et enfin toute autre personne intéressée par la thématique du handicap. C’est un chiffre de participation important, le public est donc demandeur. Pourquoi à votre avis ? L’arrivée de la Convention de l’ONU et les informations qui ont circulé dans ce cadre, ont montré l’ampleur de l’écart qui nous sépare encore d’une société respectant pleinement les droits et libertés fondamentaux des personnes en situation de handicap. Cela suscite l’intérêt d’en savoir plus. Les forums Emera-HETS permettent de faire des points de situation par thématique, avec certains des meilleurs experts en la matière, tout en restant compréhensibles du grand public. Du côté de la Fondation Emera, la liste des expectatives de la journée du 16 mai est longue. « Continuer la sensibilisation générale des politiques, de l’administration et du grand public valaisans. Cette année, en particulier sensibiliser sur l’importance de la culture pour l’humain. Faire connaître des outils existants pour une meilleure accessibilité de la culture. Informer le public sur les projets actuels et futurs concernant l’accès à la culture en Valais. Mettre en valeur des acteurs du domaine de la culture (artistes, musiciens, danseurs, etc.) en situation de handicap ». Et du côté de la Haute Ecole de Travail Social : « sensibiliser les étudiants à leur rôle de futurs professionnels du travail social. Une bonne compréhension de ce que signifie la participation pleine et effective des personnes en situation de handicap dans la société. Promouvoir la prise de conscience des capacités et de la contribution des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la vie. Permettre l'accès à toute la diversité des productions culturelles (télévision, cinémas, théâtres, musées, monuments...). Soutien et promotion de la production de produits culturels. Renforcement du potentiel créatif, artistique et intellectuel tant en termes d'enrichissement personnel des personnes concernées que de la société dans son ensemble. Reconnaissance des conditions-cadres et des possibilités régionales ». Espérons que celles-ci soient entendues et qu’on y donne suite ! Informations importantes Pour les sourds, un interprète en langue des signes, LS français et allemand, ainsi qu’une boucle magnétique pour les malentendants appareillés avec la position T sont prévus. Si la journée est gratuite, il est nécessaire de s’inscrire. Elle se clôturera avec un apéritif et la découverte des travaux de l’atelier d’expression artistique de la Fondation valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales, FOVAHM. Liens utiles Inscriptions au Forum : www.hevs.ch/forum-emera-hets Fondation Emera et Service Social Handicap Sion : https://www.emera.ch/ , 027 307 20 20 Haute Ecole de Travail Social de la HES-SO Valais-Wallis : https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-travail-social/ Convention de l’ONU : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20122488/index.html SUIVANT PRECEDENT
- Malentendants au travail: Parcours de Pros ! | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Malentendants au travail: Parcours de Pros ! 9 juillet 2014 Publié le : Ils sont huit. Huit malentendantes et malentendants qui ont accepté de témoigner pour nous révéler les secrets de leur parcours professionnel. Car en effet, on peut être malentendant, souffrir d’une déficience auditive parfois profonde, et réussir à devenir psychologue, enseignant, comédienne, notaire, médecin, ingénieur, etc. Des professions déjà exigeantes pour le commun des mortels, mais qui, pour un malentendant, relèvent souvent de l’exploit. Et pourtant ! A force de travail, de soutien et de sacrifices, ces hommes et ces femmes ont réussi l’impossible : s’imposer dans le métier de leur choix. Le mérite de leurs témoignages ? Montrer à tous que malgré les difficultés, le rêve est toujours à portée de main. Eva Hammar, biologiste « Enthousiasme et bonne humeur » Biologiste et coordinatrice pour la « Consultation génomique » aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Eva Hammar a développé de subtiles stratégies pour exercer son métier. D’abord la transparence, car elle n’hésite pas à expliquer son handicap à ses collègues, mais aussi l’humour et bien sûr la lecture labiale. Du coup, elle rencontre très peu de difficultés dans l’exercice de sa profession, vraisemblablement en raison de la plus grande ouverture que l’on rencontre tant à l’université que dans le milieu hospitalier, plus ouverts à la différence. Pourtant rien n’a été facile pour cette biologiste de 43 ans, sourde profonde de l’oreille droite et sourde sévère de l’oreille gauche depuis sa naissance. Ne comprenant qu’une partie de l’enseignement qui lui était prodigué tant au collège qu’à l’université, elle s’est employée à surmonter ses difficultés en lisant nombre de documents et ouvrages pour rattraper son retard, mais aussi en photocopiant les notes de ses camarades de classe. « J’ai décidé de faire des études de biochimie en partie parce que je pensais que ma surdité poserait peu de problèmes pour exercer ce métier » , explique-t-elle. « Mais je m’étais trompée, car quand on travaille dans la recherche scientifique, il faut énormément communiquer et échanger avec ses pairs, participer à des congrès, etc… Heureusement, entre temps, j’avais appris à vivre avec ma surdité ! » Pour elle, aucune profession ne devrait être interdite à un malentendant, quelle que soit sa perte auditive. « Il faut faire attention aux idées préconçues, et parfois une personne sourde ou malentendante peut très bien réussir dans une profession que l’on imagine hors d’accès pour une personne déficiente auditive. Je pense par exemple à Evelyn Glennie, une femme sourde anglaise qui a fait une très belle carrière en tant que musicienne professionnelle. » Et de conclure : « Il faut choisir une profession qui nous plaise car la motivation permet de surmonter les barrières sans trop de difficultés. Ensuite, il faut bien sûr beaucoup travailler, avec enthousiasme et bonne humeur, et ne pas hésiter à demander un soutien de la part des collègues, de son supérieur ou de l’AI, pour avoir un interprète en langue des signes ou un preneur de notes». Isabelle Fruchart, comédienne « Devenez cosmonaute ! » « Si vous avez envie de devenir cosmonaute, devenez cosmonaute ! » C’est en ces termes qu’Isabelle Fruchart, comédienne parisienne, auteure de la pièce « Journal de ma nouvelle oreille » et oratrice du dernier congrès de forom écoute (lire en page 6), résume sa vision des choses. Pour elle, aucun métier ne doit être interdit aux malentendants, dès lors qu’on en a vraiment envie, et bien sûr qu’on s’est donné les moyens d’y arriver. Dans son parcours, une seule certitude : elle a été artiste dans l’âme, avant même de devenir malentendante. Enfant, Isabelle Fruchart fait déjà du théâtre, de la danse, du chant. Une vocation et une inspiration artistiques venues de très loin et qui la poussent à faire sa première mise en scène, quand elle n’a que… 8 ans. A l’âge de 14 ans, elle contracte une méchante sinusite, avec pour résultat une perte auditive de 70% au niveau de chaque oreille, particulièrement marquée pour les sons aigus. Durant de longues années, sa perte auditive passe… inaperçue, et ce n’est qu’à l’âge de 26 ans, qu’elle est enfin diagnostiquée. Il lui faudra encore attendre 11 années supplémentaires pour être enfin appareillée. Elle est âgée de 37 ans, et a déjà une longue carrière de comédienne derrière elle. Car, en parallèle de ce parcours « médical », l’artiste vit et travaille. Elle danse, chante, fait du théâtre et continue à écrire, en s’adaptant au prix d’un effort parfois considérable. Sa pièce « Journal de ma nouvelle oreille », relate non seulement le long parcours qui l’a conduite à accepter sa malaudition, mais raconte également à grand renfort d’humour la manière dont elle s’était adaptée à son handicap. Bernard Gachet, enseignant « Mes élèves jouaient le jeu» On peut être malentendant et transmettre son savoir. Aujourd’hui à la retraite, Bernard Gachet a été ébéniste-enseignant au Centre de formation professionnelle de la construction (CFPC) du Département de l’Instruction Publique genevois. Pour réussir cette performance, les ingrédients ont, comme toujours, été travail, persévérance et ingéniosité. « L'enseignement demande de bonnes compétences relationnelles et un minimum d'audition est quand même nécessaire. Bien sûr, j’ai rencontré des difficultés de communication, entre autres avec les élèves » , raconte celui qui a commencé à perdre ses capacités auditives dès l’âge de 7 ans. « Il fallait toujours être sur le qui-vive pour ne rater aucune information ou aucune question. Heureusement, humour et confiance sont très importants. Mes collègues et mes élèves ont toujours joué le jeu, les élèves par exemple faisaient un signe avant de parler afin de capter mon attention. La lecture labiale m'a en outre énormément aidé ! » Evidemment, tout n’a pas été rose pour autant. Les études n’ont pas été faciles, en raison des difficultés pour comprendre les consignes, notamment en français et en langue étrangère. Heureusement, un travail acharné, « plus que les autres », l’appui logopédique, l’appareillage de ses deux oreilles en 1987, et l’apprentissage de la lecture labiale lui ont permis d’en venir à bout. « En outre, dans mes activités d’enseignant, j'ai dû renoncer à l'atelier machines pour cause de niveau sonore trop élevé » , ajoute Bernard Gachet. « La sécurité en particulier était à gérer avec une attention particulière ». Carine Schwarz Blatt, médecin-gynécologue « Mes parents ont joué un rôle important» Âgée de 51 ans, Carine Schwarz Blatt est médecin-gynécologue, installée en privé dans son propre cabinet à Genève. Cette malentendante de naissance, avec une perte auditive de 75% a, aussi loin qu’elle se souvienne, toujours souhaité devenir médecin. Plusieurs facteurs ont contribué à expliquer sa réussite professionnelle. «Mes parents ont joué un rôle important » , explique-t-elle. « Grâce à eux, le diagnostic de mon handicap a été précoce, et ils ont tout mis en place pour que je puisse m’adapter à mon environnement. Ensuite, j’ai eu la chance d’être aidée par une logopédiste compétente, ainsi que par quelques camarades au collège. Enfin, l’autre élément essentiel est la lecture labiale qui est vraiment devenue une sorte de 6ème sens.», ceci d’autant plus que les appareils acoustiques ont été longtemps très inconfortables, difficile à porter. En dépit des réticences exprimée par la faculté en raison de son handicap, elle fera sa formation et travaille essentiellement seule, sauf pour ses examens de fin d’études où elle travaille en équipe, période dont elle garde un bon souvenir. Grâce à sa volonté et son travail, elle obtient son diplôme de médecin. Pour elle, il ne faut s’interdire aucun métier, à condition de prendre en considération les possibilités d’adaptation par rapport à la malentendance, et de ne pas hésiter, si c’est possible, à se faire aider pour atteindre son objectif professionnel. « Aujourd’hui, ajoute-t-elle, je rencontre relativement peu de problèmes dans l’exercice de mon métier. Appareillée (la technologie s ’est considérablement améliorée) et travaillant en cabinet, l’entretien avec les patients est organisé pour que je puisse les entendre. En outre, si je rencontre des difficultés, je n’hésite pas à les informer de ma malentendance» . Sébastien Lefondeur, ingénieur « Je prépare l’avenir» Il est ingénieur, mais un peu par défaut. A l’âge de 21 ans, Sébastien Lefondeur a en effet dû renoncer à une carrière de sapeur-pompier professionnel en France, suite à des audiométries « pas si catastrophiques, mais pas adaptées à ce métier ». Des performances auditives moyennes qui ne l’ont heureusement pas empêché d’entamer et de mener à bien des études d’ingénieur. Aujourd’hui âgé de 35 ans, ce jeune père de famille est « Ingénieur projet en hydromécanique », dans une société veveysane. Depuis quelques années, sa malaudition est devenue handicapante (30 et 50% de perte) et il s’est appareillé il y a 4 ans environ. Ce qui ne l’empêche pas d’envisager l’avenir avec une certaine inquiétude : « Mon travail actuel a été "décroché" peu avant la nécessité de m’appareiller » , raconte-t-il. « J’appréhende ma prochaine recherche d’emploi. Mon handicap me freine dans mes projets de carrière et d’évolution interne dans la société qui m’emploie actuellement » . Il faut dire que l’exercice de son métier n’est plus une sinécure : réunions et conversations téléphoniques difficiles, sentiment d’exclusion au sein de l’équipe dans laquelle il travaille et crainte de commettre des erreurs sont désormais son quotidien. « L’omission d’un détail ou d’une remarque technique peut facilement être fatale à des projets de réalisation, de construction, de fabrication ou de réhabilitation industrielle. Le jour où cela m’arrivera sera le début de la fin pour moi dans ce domaine ». Ce qui ne l’empêche pas d’affûter ses armes pour mieux négocier les échéances à venir, en entamant par exemple des cours de lecture labiale. Pierre Badoux, notaire « S’investir plus que les autres » Âgé de 49 ans, Pierre Badoux est notaire, « une profession exigeante mais humainement passionnante qui moyennant quelques efforts se passe très bien ». Malentendant depuis la naissance, avec 100 % de perte auditive d’un côté et 50% de l’autre, ce père de famille, installé au Sentier et par ailleurs président de l’Amicale des malentendants de la Vallée de Joux, a très tôt souhaité exercer un métier « de contact qui se passait face à face ». Seulement voilà. Pour arriver jusque-là, beaucoup d’efforts ont été consentis : recours à la lecture labiale, pratiquée de manière « innée », appareillage bien sûr, mais aussi investissement massif dans des cours. Car on l’imagine sans peine, la recette de cette réussite n’est pas un secret : « pour réussir dans la profession de son choix, le malentendant doit s’investir plus que les autres pour être en meilleure position lorsque l’audition pose un problème ». Fort heureusement, l’exercice de son métier se déroule aujourd’hui de manière très harmonieuse : « C’est un métier parfait. Seules les discussions de groupe, comme par exemple lors d’un repas peuvent poser problème. Pour le reste, je privilégie systématiquement le face-à-face, et tout se passe bien » . Anoucha Betti, (future) enseignante en lecture labiale « Avoir une conviction et foncer » Assistante médicale, conseillère en conseillère en personnel médical et gestion du personnel dans les ressources humaines, mère au foyer et bientôt enseignante en lecture labiale. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le parcours d’Anoucha Betti a été plutôt… riche et varié. Cette malentendante de 38 ans, appareillée depuis l’âge de 3 ans, se destinait au départ à devenir logopédiste. Seulement voilà, un problème de santé en première année d’université, l’a obligée à changer de projet et s’orienter vers une formation d’assistante médicale, métier qu’elle a pratiqué durant 7 ans. Après avoir exercé ensuite deux ans dans une agence de placement, elle se tourne vers les ressources humaines, avant d’interrompre ses activités professionnelles pour se consacrer à ses enfants. La clé de sa réussite : assumer totalement ses problèmes d’audition. « Le fait que je montre bien que ce handicap ne m’handicape pas incline les gens à me considérer comme « normale ». J’ai toutes mes capacités motrices et intellectuelles et ne suis ni stupide ni lente. » Ainsi très tôt, ses parents ont souhaité lui faire suivre une scolarité dans une école publique. Et à chaque changement de « maîtresse », son problème était clairement exposé de sorte que l’enseignante puisse agir en conséquence. Depuis le mois de janvier dernier, Anoucha suit la formation d’enseignante en lecture labiale organisée par forom écoute en partenariat avec l’Association Romande des Enseignantes en Lecture Labiale (ARELL) et l’Ecole d’études sociales et pédagogiques (EESP) de Lausanne (lire notre article en page 8). « De par mon parcours, je pense comprendre les gens qui vivent avec ce handicap et espère leur apporter un peu de légèreté » , soutient-elle. « Mais il est clair que je vais devoir travailler plus que les autres étudiantes pour y arriver, et qu’ensuite je devrais me concentrer plus que les autres pour exercer mon métier. » Et de conseiller : « Tant qu’on a une conviction et qu’on sent qu’on pourrait s’y épanouir, il faut foncer. La première étape est de trouver une profession qui nous intéresse. Ensuite, il faut évaluer si elle est compatible avec notre handicap et ça, il n’y a que nous-même pour le savoir. Personnellement, je ne me serais jamais lancée comme infirmière aux Urgences : imaginez qu’on me demande d’injecter tel produit et je l’entends mal et j’injecte autre chose ! » Solène Perruchoud, (future) psychologue « Ma surdité a été une source de motivation » « Mes parents m’ont toujours dit de ne pas me tirer une balle dans le pied avant d’avoir essayé de suivre mes envies. Ce n’est pas parce que l’on a un handicap qu’on ne peut pas s’empêcher de tenter des choses et d’avoir une vie rêvée. Tout est possible, il suffit juste d’y croire! » Bien connue des lecteurs du magazine aux écoutes , Solène Perruchoud achève, à 24 ans, son bachelor en psychologie à l’Université de Fribourg, tout en travaillant en parallèle de ses études, à la Télécabine de Vercorin et à l’Ecole Suisse de Ski. Dans le choix de cette profession, la surdité (de sévère à profonde tout de même !), n’est pas directement entrée en ligne de compte. « Etre psychologue est plutôt pour moi un moyen de pouvoir donner ce que j’ai reçu et de pouvoir aider les autres à surmonter leurs peurs, souffrances, difficultés car on est capable de le faire, tous à des niveaux différents. Ma surdité a surtout joué comme source de motivation, pour se surpasser. » A l’instar des autres parcours exposés dans ce dossier, sa réussite tient à une subtile alchimie entre travail, recours à des moyens pour surmonter le handicap et… transparence. Grâce au LPC et au micro qu’elle donnait à ses profs, Solène a ainsi réussi à surmonter les difficultés liées à son handicap auditif. « A l’Université, je n’ai plus eu recours qu’au micro tout en comptant aussi sur les notes de mes amis pour compléter les trous éventuels. Et surtout, le soutien et la compréhension du cadre de l’université, professeurs, décanat… à qui j’ai expliqué ma situation ». Et de conclure : « Les principales difficultés que j’ai sont plus de l’ordre de l’oubli. Les gens oublient très vite que je suis malentendante et ils ont vite tendance à parler comme s’ils parlaient à un entendant. Du coup, je leur rappelle qu’ils doivent faire attention à bien parler en face de moi et le tour est réglé ». Valérie Adatte, assistante socio-éducative et… clown « bhjUVBKJJINL gylbhb knjk bqqéiu ! » Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne fait jamais les choses comme les autres. Agée de 45 ans, Valérie Adatte est malentendante depuis qu’elle a 18 ans, suite à une otosclérose dégénérative (80% de perte auditive d’une oreille et 20% de l’autre). Celle qui travaille aujourd’hui comme assistante socio-éducative au Foyer des Castors à Porrentruy, une institution pour personnes en situation de handicap physique et mental, a une seconde profession plutôt originale : clown relationnelle, une vocation grâce à laquelle elle apporte un peu de rire et de gaieté à ceux qui en ont besoin. « L’enjeu c’est de transformer son handicap en force » , explique-t-elle. « On développe les autres sens et nous sommes plus sensibles à certaines choses. Il faut toujours croire en soi et se rappeler que rien n'est impossible! » Pourtant, tout n’est pas toujours facile dans son travail d’assistante socio-éducative. Certains résidents du foyer parlent très bas ou n'articulent pas beaucoup et les collègues oublient facilement qu’elle ne comprend pas ce qu'ils disent s'ils sont éloignés ou lui tournent le dos. Heureusement, Valérie est toujours prête à dégainer son arme fétiche : l’humour. « Je leur rappelle que je n'entends pas bien, par exemple en leur répétant ce que j'ai compris, c'est à dire: "bhjUVBKJJINL gylbhb knjk bqqéiu" ! En outre, du fait que je suis très gestuelle et expressive autant avec mon visage qu'avec mon corps, une certaine complicité et facilité de communication s'installe avec les résidents. Je me sens bien dans le milieu du handicap et je me donne tous les moyens pour vivre normalement et faire tout ce dont j'ai envie, professionnellement ou personnellement. » SUIVANT PRECEDENT
- A Payerne, les jeunes malentendants ont foncé plein gaz | FoRom Ecoute
Retour au Magazine A Payerne, les jeunes malentendants ont foncé plein gaz 9 mars 2022 Publié le : Samedi 5 mars, une bonne cinquantaine de jeunes malentendants et sourds se sont retrouvés au karting de Payerne, pour une après-midi de courses sur les pistes. Organisée par la commission jeunesse de forom, la journée a été un franc succès. C’était une séance de rattrapage, surtout après deux années de covid qui ont empêché toute rencontre. C’est donc à peine 6 mois après la précédente journée en septembre dernier, qu’une deuxième journée de karting a été organisée ce samedi 5 mars, comme de coutume au Karting de Payerne. Et pour cause : l’engouement pour ce genre de sortie, qui rencontre un succès croissant, ne se dément pas puisque pour cette dernière édition, pas moins de 50 personne - un record ! – ont été de la partie, en provenance de tous les cantons romands. 2 groupes Après un petit mot d’accueil prononcé par Bastien Perruchoud, membre de la Commission Jeunesse de forom écoute, qui, avec l’aide du personnel de forom écoute, a assuré l’organisation de la journée , suivi par un très appétissant buffet de pâtes, les participants se sont retrouvés sur les pistes. Pour cause d’affluence, les jeunes de forom ont donc dû être scindés en deux groupes, qui ont pu chacun effectuer une première course d’essai de 10 minutes, puis un tour de qualification de 10 minutes, avant de s’engager, après une courte pause, pour la course proprement dite. Après de nombreux tours de piste, un trio gagnant s’est clairement détaché en fin de journée : Fabien, Bastien et Alexis. Bravo à eux et à tous les autres concurrents qui n’ont pas démérité ! Retrouvez ci-dessous cette superbe après-midi en photos. SUIVANT PRECEDENT
- Un quart des résidents d’EMS coupés du monde extérieur en raison de troubles sensoriels | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Un quart des résidents d’EMS coupés du monde extérieur en raison de troubles sensoriels 25 novembre 2016 Publié le : Plus les êtres humains deviennent âgés, plus ils sont exposés à des problèmes visuels ou auditifs. L’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) vient de publier une étude sur la proportion de personnes présentant des troubles sensoriels résidant en institutions pour personnes âgées et centres de soins. L’Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) est occupée depuis plusieurs années par la situation des personnes présentant des handicaps visuels ou auditifs. Dans ce contexte, elle a lancé une étude qui porte sur 24'000 dossiers issus d’institutions pour personnes âgées et de centres de soins, et ceci dans plusieurs cantons de Suisse. Les données proviennent du système d’évaluation RAI (RAI-NC), propre à ces établissements. Et le constat est clair : 42% des résidents et des résidentes étaient atteints de déficiences visuelles. Les chiffres sont également éloquents dans le domaine auditif : le potentiel auditif est si dégradé auprès de 48% des résidents, qu’il engendre des difficultés de communication. Les appareils auditifs sont en outre uniquement installés auprès d’une minorité des personnes malentendantes. Chez 13% d’entre elles, il ressort qu’elles ne peuvent ni comprendre, ni entendre ce qui est dit. En outre, on constate que les troubles auditifs progressent avec les années. Dans le quotidien, la communication est donc limitée et l’intégration des informations devient compliquée. Cet état provoque des malentendus et des maladies qui sont souvent synonymes d’un recul dans la société. Enfin, autre chiffre éloquent, environ 27% des résidents d’institutions pour personnes âgées et de centres de soins sont confrontés à un handicap sensoriel double. Ils ne peuvent plus compenser la perte auditive par une bonne vue, tout comme leur ouïe devient insuffisante pour reconnaître des personnes à la voix, sans le recours à la reconnaissance visuelle. SUIVANT PRECEDENT
- Box « Swisscom TV » pour tous | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Box « Swisscom TV » pour tous 21 août 2017 Publié le : Box « Swisscom TV » pour tous Les personnes souffrant d’un handicap ont accès à la dernière version de la Box « Swisscom TV », améliorée. Explications. Les personnes souffrant d’un handicap peuvent accéder à la dernière version améliorée de la Box « Swisscom TV ». Afin de faire bénéficier les clients de ces nouvelles fonctionnalités, Swisscom a édité une brochure explicative. Elle explique notamment comment l’accès aux sous-titres peut être facilité. forom écoute, ainsi que la Fédération Suisse des Sourds, SGB-FSS, soutiennent cette démarche. Le responsable de projets en faveur des personnes handicapées au sein de Swisscom, plus précisément auprès des associations pour des personnes handicapées, David Rossé, précise : « ce texte doit être lu aux personnes malvoyantes, alors que des icônes fournissent les indications nécessaires aux personnes malentendantes, comme les sous-titres, la fonction EPG (Electronic Programm Guide) du magazine de programmes électronique pour rechercher des émissions dans le but d’effectuer un enregistrement, les sous-titres, langue des signes, etc ». Swisscom proposera sur ses pages web, actuellement en restructuration, un lien internet d’ici quelques semaines. Plus d'info SUIVANT PRECEDENT
- Manon Zecca, une sourde engagée sur tous les fronts | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Manon Zecca, une sourde engagée sur tous les fronts 24 août 2021 Publié le : Personnalité atypique et engagée, devenue déficiente auditive à l’âge de 17 ans, implantée cochléaire à 22 ans, Manon Zecca vient d’entrer au conseil communal de Lausanne. Portrait d’une Lausannoise de 29 ans qui porte haut ses convictions au service des personnes handicapées mais aussi des faibles, des opprimés et des damnés de la terre. A l’époque, quand le diagnostic est tombé, ce fut une sorte de sidération. Manon Zecca n’a que 17 ans quand elle perd son audition. Progressivement, inexorablement et sans que l’on sache exactement pourquoi. Tout au plus une cause dégénérative a-t-elle été évoquée. « Quand on vous annonce que c’est un processus évolutif, c’est évidemment une perspective difficile à appréhender. Je l’ai vécue d’abord comme une épreuve très personnelle que j’ai dû essayer d’intégrer de la manière la plus résiliente possible, histoire d’en faire quelque chose ». La perte inéluctable étant annoncée, malgré le soutien d’appareils auditifs, la jeune Manon tente de se préparer au mieux et apprend donc la langue des signes. Sauf que dans l’intervalle, au cours d’un examen – elle a 22 ans -, un médecin lui propose une implantation cochléaire. « On ne m’avait jamais parlé auparavant d’implant cochléaire et je pensais vraiment que j’allais finir par devenir sourde. Au final, la pose de l’implant m’a beaucoup aidée, raconte-t-elle, puisque la peur de la baisse d’acuité auditive a disparu. Et d’ailleurs, après coup, je me suis rendu compte à quel point j’avais dû faire des efforts dans ma vie quotidienne, à quel point aussi j’avais eu tendance à éviter les interactions sociales. » Identité de sourde De cette expérience, Manon Zecca ressort avec une identité de sourde bien affirmée. Elle qui obtient à l’université de Fribourg un bachelor, puis un master en sciences sociales, décide de faire ses stages à la Fédération suisse des sourds , puis à l’ECES, l’École cantonale pour enfants sourds de Lausanne, dans le but de se forger une expérience dans le monde du handicap. « Étonnamment, se souvient-elle, je pensais que cela ne me plairait pas. Eh bien, cela m’a beaucoup plu ! ». Résultat : dans la foulée, elle devient durant une année enseignante en renfort pédagogique à l’ECES, puis est recrutée comme éducatrice au Centre pour jeunes sourds « Les chemain’S », à Renens où elle travaille depuis 2018. « C’est un travail de terrain avec les personnes sourdes et j’y suis très heureuse » raconte celle qui, de son handicap auditif, a su faire un véritable projet de vie. Et pourtant, limiter Manon Zecca à la surdité serait tellement réducteur. Car en réalité, la jeune femme, élevée dans une famille d’artistes, a fait la preuve d’un engagement bien plus étendu, avec comme dénominateur commun, la défense des plus faibles et la lutte contre les inégalités. A l’école enfantine déjà, elle prenait la défense des plus fragiles, prélude à son action future pour les minorités et les opprimés. Grève des femmes, sans-papiers et migrants, communauté sourde, lutte contre le racisme, défense des minorités sexuelles, la jeune femme est décidément sur tous les fronts. Engagement politique De retour à Lausanne après ses études, cette sympathisante de longue date des mouvements de gauche par affinité personnelle et par tradition familiale, décide de donner un tour plus actif à ses convictions et contacte le parti d’extrême gauche Solidarités, où elle est accueillie à bras ouverts. « Sur le tard, j’ai concrétisé mes révoltes d’adolescente en engagement militant, assorti des armes de la sociologie qui m’ont permis d’explorer les dynamiques sociales et les dimensions collectives » raconte-elle, toujours très analytique. Après des discussions au sein de Solidarités sur l’opportunité d’une présence au conseil communal, la voilà qui se présente aux élections communales de Lausanne et se retrouve, à sa grande surprise, élue en mars dernier avec 12 autres collègues de la liste Ensemble à Gauche. « J’espère que l’on ne va pas se perdre dans des futilités dans ce conseil » , sourit-elle, très consciente de ses responsabilités : « Et puis bien sûr, il va me falloir moi aussi me montrer à la hauteur de la tâche, amener des idées et porter la voix des personnes handicapées dans l’enceinte politique, les inégalités qu’elles vivent étant insupportables ». SUIVANT PRECEDENT
- « Entendre avec son cœur est plus essentiel qu’entendre avec ses oreilles » | FoRom Ecoute
Retour au Magazine « Entendre avec son cœur est plus essentiel qu’entendre avec ses oreilles » 27 septembre 2021 Publié le : Devenue malentendante à l’âge de 25 ans suite à une otospongiose, la comédienne française Zoé Besmond de Senneville raconte dans son « Journal de mes oreilles » le long chemin qui l’a conduite à accepter son handicap. En vous lisant, on a le sentiment que le statut de personne officiellement handicapée en raison de votre surdité a été particulièrement difficile à accepter… C’est vrai et c’est probablement lié à mon âge mais aussi à mon éducation. J’ai été éduquée dans une famille catholique et j’ai étudié dans un établissement catholique où la notion du devoir accompli est toujours très importante. Ajoutez-y que nous vivons dans des sociétés où l’injonction à toujours être très performant ne les rend pas très compatibles avec le handicap. Et puis enfin, il y a aussi mon métier d’actrice et de comédienne qui joue sur ce registre, avec les 5 sens qui doivent toujours être infaillibles. Comment expliquez-vous la puissance des sentiments de honte et de culpabilité que vous avez ressentis ? Lorsqu’on devient malentendant, on vous suggère de ne pas en parler puisque ce handicap est invisible, ce qui induit de la culpabilité. Le résultat c’est qu’on n’a plus d’interlocuteur, personne à qui s’identifier, à qui se confier, à qui dire que l’on n’est pas content de son médecin, de son audioprothésiste… Les médecins n’ont pas su être vos interlocuteurs ? La première fois été que j’ai été confrontée à un ORL, je me suis dit : « ce n’est pas possible, quel manque d’intelligence de considération de l’humain » ! J’ai été choquée par l’étroitesse d’esprit dont les médecins faisaient preuve dans leur diagnostic sans chercher à aller plus loin que l’organe, sans faire de lien avec le reste du corps et ses mémoires. Bien sûr que la médecine peut faire beaucoup de choses et que parfois c’est bien, mais autant que possible, je renonce à voir les ORL car leur discours me plombe. Heureusement, j’ai beaucoup évolué grâce au yoga et aux thérapies alternatives… Le rapport que vous établissez avec vos appareils auditifs est également très ambivalent, entre amour et haine… J’ai une surdité mixte de perception et de transmission et j’ai l’impression que c’est plus compliqué à intégrer car au niveau restitution sonore par les appareils, cela donne des trucs très bizarres. Mais je m’y suis progressivement adaptée… Vous avez donc fait la paix avec vos appareils ? Non, même si ça va mieux. Cela dit, dès que je peux les enlever je les enlève car ils me fatiguent… et qu’avec eux je n’ai pas un retour d’audition naturelle alors parfois, ça me saoule. J’entends avec eux mais je reste gênée… Et avec vos oreilles, avez-vous réussi à faire la paix ? De ce côté oui, ça va beaucoup mieux et même si de temps en temps on se dispute encore un peu, je leur fais beaucoup moins la guerre. Je rêve encore de guérison miraculeuse mais j’accepte que cela prendra du temps. Et sur ce chemin il se passe de très belles choses. Je pense que oui, la maladie va me mener vers la guérison même si celle-ci peut être le chemin de toute une vie. Elle mène le corps vers quelque chose de plus profond. Et on se dit qu’il y a des choses plus essentielles qu’entendre parfaitement, comme entendre avec le cœur! Vous attendiez-vous au succès de votre livre ? J’ai écrit ce que j’avais en moi car je ne pouvais plus me taire. Mais je suis très contente que cela ait pu faire du bien ! J’ai conscience que cela peut aider les autres car dès sa parution, j’ai reçu beaucoup de messages auxquels j’ai d’ailleurs plupart du temps répondu. Beaucoup de gens m’ont dit : « Je vais l’offrir à mon conjoint, comme ça il comprendra ce que je vis ! » Recevoir ce genre de message, il n’y a rien de plus extraordinaire ! Et à vous qu’a-t-il apporté ? Eh bien justement, publier mon récit m’a permis de trouver des interlocuteurs. Et c’est à ce moment-là que j’ai pu me dire que je n’étais pas folle de ressentir ce que je ressentais! « Journal de mes oreilles » récit, Zoé Besmond de Senneville, éditions Flammarion, 2021. En pièce de théâtre en 2022. SUIVANT PRECEDENT
- Des participants engagés pour une rencontre annuelle réussie | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Des participants engagés pour une rencontre annuelle réussie 5 février 2018 Publié le : Comme chaque année, forom écoute organise une rencontre ouverte aux personnes engagées dans la lutte contre la malentendance. Cette édition, qui a eu lieu le 29 janvier dernier, a été un franc succès. Dans une atmosphère très conviviale, une cinquantaine de personnes ont participé à la traditionnelle rencontre annuelle de janvier, chapeautée par forom écoute, qui s'est déroulée le lundi 29 dans une salle de l'hôtel AuLac à Lausanne-Ouchy. La responsable Michèle Bruttin se dit ravie par l'engouement et la présence des participants. " C'était également une bonne occasion de présenter l'équipe de collaborateurs, dont je fais partie, qui s'investit activement à la bonne marche de la fondation. Parmi eux, des têtes connues, de nouveaux collègues et de nouvelles fonctions visionnaires pour lesquelles oeuvrent sur le terrain Camilla Gelbjerg-Hansen, vice-présidente, Anne Grassi, chargée de projets, Huguette Andreae, comptable, Kelly Santos Da Costa, apprentie de commerce en première année, Mary-Luce Boand Colombini, journaliste, Antoine Mayor, trésorier, Gavin Lancaster, webmaster et Gilberto Betti, pour le controlling de l’OFAS ». Langage parlé complété (LPC) et lecture labiale (LL) Madame Sonja Musy, présidente de l'ALPC, a porté au faîte l'importance du LPC pour accompagner la lecture labiale. " Nous favorisons surtout cette pratique pour la compréhension des jeunes malentendants dans le cadre de leur scolarité, aidés et accompagnés par des codeuses LPC ". Collaborateurs, membres de la fondation, anciens et actuels membres d'amicales, bénévoles, associations, corps médical, représentante de la Ville de Lausanne et étaient présents et ont également pu visionner un petit film sur les activités des enfants, organisateurs et accompagnants des stages d'été qui ont lieu à Charmey/FR. Par ailleurs, le prochain stage d’été aura lieu du 5 au 11 août 2018, les inscriptions sont ouvertes sur le site www.alpc.ch où vous découvrirez également d’autres activités. Conviction et détermination A l'heure de l'apéritif, chacun a pu rencontrer, partager et échanger ses convictions sur les problèmes et les solutions liés à la malentendance. Un rendez-vous de toute évidence incontournable, qui offre la possibilité à tous de s'exprimer sur des projets en cours ou à venir, de promouvoir et mener à bien un but commun : se faire entendre auprès des institutions publiques et de toutes personnes concernées par la malentendance qui frappe la population. Rappelons que la Fédération Suisse des Sourds estime à environ 10 000, le nombre de personnes sourdes de naissance ou atteintes d'un déficit auditif grave, ce qui représente 0,2% de la population helvétique et environ 1 million de personnes sont atteintes de troubles auditifs. SUIVANT PRECEDENT
- Vaud - Un kit pour expliquer le handicap | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Vaud - Un kit pour expliquer le handicap 19 septembre 2013 Publié le : Avec le concours des autorités cantonales, l’association insieme Vaud a lancé une campagne de sensibilisation sur le handicap, destinée à tous les écoliers du canton. Fer de lance du projet: un outil pédagogique exceptionnel, intitulé « Kit’explique », et distribué dans toutes les écoles. Forom écoute a participé à l’élaboration de ce kit pour tout ce qui concerne la déficience auditive. « Je suis vraiment très contente de ce projet et j’espère que dans les écoles, les gens vont vraiment l’utiliser. Le produit final est bien coloré, ludique, c’est vraiment quelque chose de bien qui est appelé à rester ! » Silvia Hyka, secrétaire générale d’insieme Vaud, ne cache pas sa satisfaction: la dernière campagne de son association, qui défend les intérêts des proches de personnes handicapées mentales, est en effet appelée à un beau succès. Intitulée «handicap’ d’en parler!», cette campagne, lancée à l’occasion du 50ème anniversaire d’insieme Vaud, est fondée sur un outil pédagogique exceptionnel, le «Kit’explique». Le Kit’explique est une sorte de trousse de toilette en tissu qui se déroule, et qui, à l’intérieur, dévoile 6 pochettes. 4 sont destinées aux principales déficiences (intellectuelle, motrice, visuelle et auditive), une pochette contient un cahier de notes pour y recueillir les remarques, les commentaires et le ressenti des enseignants et des élèves quant à l’utilisation de cet outil, et enfin la dernière pochette contient un DVD et un livre consacrés au handicap. Plusieurs partenaires Offert dès la rentrée 2013-2014 à chaque établissement scolaire vaudois pour les élèves de la 1ère à la 8e HarmoS, ainsi qu’aux écoles spécialisées, le Kit’explique est en réalité un outil ludique qui permet aux enseignants d’aborder la problématique des déficiences au sein de leurs classes. A travers des jeux, des activités, des lectures et des discussions, l’enseignant propose à ses élèves de se mettre à la place des personnes en situation de handicap, afin de mieux comprendre leurs difficultés au quotidien et se comporter de façon plus naturelle avec eux. « Un projet semblable, fondé sur une valise en bois, avait été élaboré en Valais, rappelle Silvia Hyka. De notre côté, nous avons décidé de développer un projet similaire, mais adapté au canton de Vaud, qui vient de voter de nouvelles lois en matière d’intégration (loi sur l’enseignement obligatoire LEO, entrée en vigueur le 1er août 2013, ndlr). En revanche, à la différence du projet valaisan, nous avons souhaité nous entourer de partenaires pour chaque handicap ». Pour l’élaboration de la pochette consacrée au handicap auditif, c’est forom écoute qui, avec l’Association Suisse de Parents d’Enfants Déficients Auditifs (ASPEDA) et la Fédération Suisse des Sourds (SGB-FSS), a apporté sa collaboration et son expertise. Une pochette qui comprend un dépliant destiné à l’enseignant, ainsi que les brochures « C’est quoi la surdité ?», « Comment leur dire? Conseils pour bien communiquer avec les personnes sourdes et malentendantes » et « Mes oreilles, c’est du sérieux ! ». Double objectif « L’objectif de cette campagne est double, résume Silvia Hyka. Donner un outil aux enseignants pour mieux expliquer l’intégration des personnes en situation de handicap, mais aussi soutenir l’intégration de ces enfants. Aujourd’hui, beaucoup d’enfants ne sont plus vraiment confrontés à la différence. Or, ces enfants sont de futurs citoyens, de futurs acteurs sociaux et de futurs employeurs, et il est important qu’ils prennent conscience que ce qui nous lie tous est plus important que ce qui nous sépare ». Mise en place avec le soutien de l’Etat de Vaud par le biais de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF) ainsi que de la Société pédagogique vaudoise (SPV), la campagne a en outre bénéficié d’un important soutien financier de la Loterie Romande, et de la collaboration de l’agence de communication konsept avec l’association konsept of Charity . Bientôt ailleurs ? « Il nous a fallu près de deux ans et demi, depuis les premières réflexions jusqu’à sa concrétisation, pour mener ce projet à bien, ajoute encore Silvia Hyka. Ce qui est fabuleux, c’est que tout le monde a joué le jeu. Les enseignants, une fois qu’ils ont compris qu’on ne souhaitait rien leur imposer mais juste leur fournir un outil de travail, se sont montrés particulièrement enthousiastes. Tous nos partenaires des différents handicaps, dont forom écoute qui a fourni un important matériel, se sont aussi beaucoup investis, et je dois dire que je suis très fière de cette collaboration et de ses résultats ». Diffusé à plus d’une centaine d’exemplaires, le Kit’explique est désormais voué à une longue vie au sein des écoles vaudoises. Au vu de la demande qui s’annonce, de nouveaux exemplaires sont en commande, et le projet pourrait bien essaimer… dans d’autres cantons. « Nous n’avons pas établi de copyright sur le Kit’explique, annonce la secrétaire générale d’insieme Vaud. Le concept de la brochure nous appartient et nous le mettons volontiers à disposition de ceux qui souhaiteraient l’utiliser et l’adapter à leurs spécificités cantonales ». Campagne de sensibilisation sur le handicap pour les écoliers du canton de Vaud. Rens. www.handicapdenparler.ch SUIVANT PRECEDENT
- Cours de tango et mariage à Buenos Aires | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Cours de tango et mariage à Buenos Aires 15 mai 2015 Publié le : Aller à l’aéroport, embarquer seule dans un avion pour aller au bout du monde, le tout pour… assister à un mariage ! Voilà qui ne fait pas peur à Fiona Vullo, une jeune malentendante lausannoise, globe-trotter à ses heures, amoureuse des rencontres et des voyages… En décembre dernier, Fiona Vullo une jeune malentendante de Lausanne, décide de prendre son billet pour Buenos Aires, la capitale argentine. Un jeune couple de ses amis, - elle est Suissesse, lui est Argentin -, y convole en effet en justes noces, et Fiona fait partie des invités. « J’avais découvert Buenos Aires il y a sept ans , raconte la jeune femme. Mais je n’y avais passé que quelques jours, et j’en étais revenue un peu frustrée. Ce mariage était donc une occasion en or pour retrouver une ville qui m’avait beaucoup plu ! Autant dire que je n’ai pas hésité longtemps pour prendre mon billet !» Alors, quand Fiona aime quelque chose, rien ne l’arrête. Pas même les 13 heures d’avion qui séparent la Suisse de la capitale argentine, avion qu’au demeurant elle aime beaucoup. Mieux encore : la jeune femme qui a le contact facile, profite du trajet pour faire des rencontres et papoter avec son entourage, d’autant qu’elle parle parfaitement l’espagnol. Sitôt arrivée à Buenos Aires, la voilà même qui partage son taxi avec des voyageurs rencontrés dans l’avion, et qui rejoint le petit appartement qu’elle avait pris soin de réserver par internet. L’accueil y est chaleureux, la logeuse sympathique et avenante. Deux jours plus tard, le temps de récupérer de la fatigue du voyage et du décalage horaire, Fiona est sur le pied de guerre. « J’ai passé mes premiers jours à faire des repérages dans le quartier, et à m’y promener, histoire de prendre mes marques, raconte-t-elle. Je passais mes soirées avec les amis qui m’avaient invitée à leur mariage, et j’ai fêté Noël et le Nouvel An en leur compagnie ». Cours de tango Hyperactive et décidée, passionnée de danses latines – sa maman est Colombienne -, Fiona ne perd pas de temps, ni pour faire ce qu’elle aime, ni pour rencontrer des gens. Très vite, elle s’inscrit à… une école de tango pour y apprendre les rudiments de cette célèbre danse typiquement argentine. Le reste de ses journées, elle le passe à découvrir les différents quartiers de la ville, à pied ou en bus touristique, tandis que le soir venu, elle fait la fête et danse la salsa et le tango avec ses nouveaux amis, dont une jeune Française, rencontrée durant un des cours. Buenos Aires est en effet une ville très agréable, dotée de nombreux espaces verts et dont l’architecture n’est pas sans familiarité avec ce que l’on a ici en Europe. Les Argentins en revanche, sont beaucoup plus chaleureux que sous nos latitudes. « Ce qui est super dans ce pays, c’est que les gens y nouent très facilement des liens, alors qu’en Suisse, tout y est beaucoup plus formel. Là-bas, comme partout en Amérique latine d’ailleurs, l’accueil y est agréable, les gens sont très chaleureux et vous adoptent très vite. Les contacts que l’on s’y fait sont sincères et durables ». Fiona découvre en outre le très touristique quartier de La Boca qui abrite la célèbre rue Caminito, connue pour ses façades multicolores, chaque couleur représentant une des vagues d’immigration qu’a connues la ville. « Ce qui m’a le plus marquée dans cette rue, se souvient la jeune femme, c’est un extraordinaire café-librairie, aménagé dans une ancienne salle de théâtre. Je l’ai beaucoup apprécié, car ce lieu extraordinaire dégage une ambiance unique ». Delta du Tigre L’autre point marquant du séjour a été la visite de la petite ville de Tigre, sur le delta éponyme, située entre Buenos Aires et la frontière avec l’Uruguay. « Avec une des amies rencontrées là-bas, nous en avons fait le tour en bateau, et c’était franchement magnifique !» Après près de deux semaines de rencontres et de découverte, arrive enfin, avec la fin du séjour, l’heure de la cérémonie de mariage, à l’origine du voyage. Bilingue, en français et en espagnol, la cérémonie religieuse a lieu à 20 heures à l’église, moment émouvant ou Fiona a lu, dans les deux langues, un texte de son cru. Superbe, la mariée fait forte impression et les convives se déplacent ensuite pour un magnifique apéritif en plein air, suivi d’un repas au restaurant. « Non seulement il y avait de la viande comme c’est bien sûr d’usage en Argentine, mais on a aussi proposé du chocolat suisse, pour donner une petite touche helvétique à l’événement , sourit encore Fiona. C’était très sympathique et bon enfant ! On a énormément dansé, et en bout de nuit, vers 3-4 heures du matin, on nous a même distribué des accessoires de déguisement, histoire de rigoler un peu ! » Retour en Suisse A peine la nuit terminée - il est 6 heures du matin -, la jeune femme a tout juste le temps de prendre congé de ses hôtes, de filer prendre une douche et boucler sa valise, avant de rejoindre directement l’aéroport, la jeune étudiante devant rentrer en Suisse pour sa rentrée académique. « Heureusement, et contrairement à l’aller ou j’ai passé énormément de temps à discuter avec mes voisins, j’ai pu dormir durant tout le retour pour récupérer, raconte Fiona dans un grand sourire. Et c’était très bien aussi pour préparer l’adaptation au décalage horaire ». Avant de conclure : « Il n’y a aucun doute, je retournerai à Buenos Aires. Non seulement, je m’y suis fait de nombreux amis, avec lesquels je suis encore en contact aujourd’hui, mais aussi parce qu’un de mes rêves est de visiter les célèbres chutes d’Iguazu à la frontière entre le Brésil et l’Argentine. Je n’ai pas pu les voir il y a sept ans, je n’ai toujours pas réussi à aller les voir cette année, alors je me suis promis de les découvrir lors de mon troisième séjour en Argentine ! » ChA SUIVANT PRECEDENT
- Le bruit excessif peut entraîner des problèmes cardiovasculaires | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Le bruit excessif peut entraîner des problèmes cardiovasculaires 25 avril 2021 Publié le : La Journée contre le bruit a lieu ce 28 avril. L’occasion de rappeler que les nuisances sonores répétées n’affectent pas que l’audition. De nombreuses études montrent qu’elles peuvent également favoriser l’apparition de maladies cardiovasculaires. Automobiles, avions, transports publics et autres nuisances sonores urbaines sont le lot d’un grand nombre d’entre nous. Et on le sait depuis longtemps : le bruit excessif peut occasionner des pertes irrémédiables à l’ouïe, d’où d’ailleurs l’importance de l’utilisation des bouchons auditifs pour préserver celle-ci. Depuis de nombreuses années cependant, des études croissantes montrent que les nuisances sonores induisent également un risque élevé de contracter des maladies cardio-vasculaires. Pour l’ensemble de l’Europe, selon le site ecomobiliste.ch , on estime à 245’000 les cas d’affections cardio-vasculaires à mettre sur le compte du bruit routier et à 50'000 ceux de décès dus au syndrome traumatique de stress lié au bruit. Alors qu’en Suisse, une personne sur cinq est touchée par une exposition excessive au bruit routier, une étude de l'Institut tropical et de santé publique suisse TPH publiée en novembre dernier et menée entre 2000 et 2015 aux environs de l’aéroport de Zurich Kloten, a montré que le bruit nocturne des avions pouvait mener à la mort par arrêt cardiaque, même lorsque la période d'exposition est relativement courte. Sur 25'000 décès par arrêt cardiaque survenus à proximité de l'aéroport, 800 sont, selon les résultats obtenus, directement liés au bruit des avions, soit 3% des cas. Au total en Suisse, les coûts externes de la santé imputables au bruit du trafic routier, ferroviaire et de l'aviation sont estimés à environ 2,6 milliards de francs par an. Processus mal élucidé En 2019, des chercheurs de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) en France ont également mené une étude portant sur 300 personnes et a établi un lien clair entre bruit des transports et rythme cardiaque. Enfin, en Allemagne une recherche portant sur des personnes vivant à proximité de l'aéroport de Francfort, a révélé que ces dernières présentaient un risque d'accident vasculaire cérébral accru de 7 % par rapport aux personnes vivant dans des quartiers plus calmes. Le processus par lequel les nuisances sonores excessives augmenteraient le risque cardio-vasculaire n’est pas encore complètement élucidé. Il semblerait qu’une corrélation avec les mécanismes du stress – irritabilité, insomnie, libération excessive de cortisol etc. soit en cause, avec comme corollaire des phénomènes d’adaptation physiologique (augmentation de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, de la glycémie) qui, sous l’effet de la répétition des expositions, évolueraient sur un mode chronique. Journée contre le bruit le 28 avril 2021 : www.bruit.ch/2021 SUIVANT PRECEDENT
- Week-end participatif à Villars | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Week-end participatif à Villars 6 juin 2018 Publié le : Bilan positif pour l’ALPC qui a regroupé 234 personnes lors d’un des week-ends biannuels d’apprentissage et de perfectionnement du LPC à Villars. Les 5 et 6 mai derniers, pas moins de 234 personnes se sont rassemblées lors du week-end d’apprentissage et de perfectionnement du LPC qui a eu lieu à l’Eurotel de Villars. Le comité de l'ALPC (Association suisse pour les Langues Parlées Complétées) a organisé bénévolement ce séminaire. « Les personnes s'inscrivent pour suivre des cours en LPC selon leur niveau, tandis que d'autres proposent leur aide bénévole en tant que formateur, animateur, gardiennage, activités ludiques et sportives », détaille Evelyne Jordan, responsable du secrétariat de l’ALPC. L’objectif d’une telle rencontre réside dans l’opportunité d’offrir aux personnes sourdes et malentendantes de tous âges, enfants et parents confondus, l’apprentissage et le perfectionnement du code LPC. « Lors de cette dernière édition, nous avons mis en place, en plus du code français majoritaire, un groupe de code anglais et deux groupes de code allemand. Les enfants déficients auditifs ont également bénéficié de l’enseignement du décodage LPC, qui me paraît très important. Cette approche leur permet de mieux pouvoir comprendre leur codeuse en classe », précise le responsable du Team Valais, Christophe Darioly. Les futures codeuses en fin de formation, lesquelles vont passer leurs examens en juin, ont eu l’occasion de parfaire leur fluidité et leur vitesse. Pour les petits, des plages animation sont à chaque fois organisées afin d’enrichir leur curiosité. Cuisine, billard, sports en salle, jeux de société, bricolages, piscine, informatique, zumba et percussions étaient au programme. « Nous avons créé pour la première fois une chasse au trésor numérique à travers la station de Villars, avec l’aide du téléphone portable. « Les enfants dès 5 ans ont beaucoup apprécié, tandis que les plus petits étaient pris en charge à la garderie. Il faut aussi relever le travail toujours excellent réalisé par le personnel de l’hôtel, aux petits soins tant des hôtes que des organisateurs », ajoute Christophe Darioly. Durant l’assemblée générale de l’ALPC le samedi soir, les enfants visionnaient deux films projetés. « J’encourage vivement les familles avec des enfants déficients auditifs ou sourds à participer et découvrir le LPC à travers ces week-ends biannuels, qui constituent un moment d’échanges et de partages », conclut la présidente Sonja Musy. L’ALPC, active depuis 1983, a mis en place une série de formations et stages d’été. Le prochain stage d’été se déroulera du 5 au 11 août à Charmey. De plus, des groupes régionaux de pratique, des activités et des sorties, des week-ends et des sorties pour la jeunesse JLPC de 18 à 25 ans, participent au développement de chacun. Si besoin, des informations utiles et pertinentes à télécharger sont à disposition. Dans le même esprit, des contacts réguliers avec les organisations étrangères confirment que les bénévoles tendent vers les mêmes objectifs. Avis aux amateurs, la prochaine édition se déroulera les 17 et 18 novembre 2018. Inscriptions en ligne dès octobre sur : www.alpc.ch . forom écoute au rendez-vous Les membres de la fondation forom écoute, notamment à travers son magazine « aux écoutes », encouragent vivement ces rencontres régulières et y participent volontiers, comme Anne Grassi, chargée de projet, toujours présente au rendez-vous. Pour cette édition, elle était accompagnée de l’apprentie de commerce en 1e année, Kelly Santos Da Costa. « J’ai pu découvrir une présentation du rôle de l’ALPC, puis j’ai rejoint des groupes de débutants au codage très encourageants. Au niveau relationnel, j’ai vécu une intense interaction avec une jeune fille sourde, même si c’était compliqué ». SUIVANT PRECEDENT
- Aux écoutes, près d’un siècle au service des malentendants romands | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Aux écoutes, près d’un siècle au service des malentendants romands 30 novembre 2016 Publié le : Fondé en 1924 avec la foi et le dévouement des pionniers décidés à faire bouger les choses, aux écoutes a connu une vie riche, passionnée et passionnante. Au moment où il s’apprête à privilégier la publication sur internet, retour sur 92 ans d’engagement au service des malentendants romands. Pour qui se livre à une plongée dans les archives du magazine – l’ensemble de la collection est disponible dans les bureaux de forom écoute ! -, l’aventure est une plongée historique passionnante. A plus d’un titre, car l’histoire de votre journal est intimement liée à celle de la Suisse romande bien sûr, mais aussi aux évolutions respectives du monde de la malaudition et… de la presse. Une histoire riche, diverse et multiple que nous vous racontons brièvement ici, au moment ou aux écoutes s’apprête à connaître un nouveau tournant décisif pour, en phase avec l’époque actuelle, basculer dans le monde du numérique. « Organe de ralliement » Tout commence en fait il y a presque un siècle, en 1924, plus exactement en octobre 1924, lorsque paraît le premier numéro du magazine, en noir et blanc évidemment, et intitulé « Aux Ecoutes ! », émanation de la Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité (SRLS). Le sous-titre de la nouvelle publication sonne déjà comme un programme : « Organe de ralliement pour les personnes d’ouïe faible, leurs amis et les associations qui se consacrent à la lutte contre les effets de la surdité ». Ainsi, et d’emblée, le journal se définit avec une fibre militante en plaçant la vie des amicales romandes et la protection des intérêts des malentendants au sommet de ses priorités. La parution est bimestrielle, et l’abonnement annuel est de… 4 francs. Quoique modeste, le premier numéro du magazine est déjà extrêmement bien conçu, avec un éditorial, un conte d’Alfred de Musset, un historique du « mouvement en faveur des sourds en Suisse », une chronique médicale, des échos des amicales et un courrier des lecteurs. Autant dire que le petit nouveau est fort complet puisqu’il compte même une page de… publicité ! Le contenu du premier éditorial est en outre édifiant : « Aucun journal n’est particulièrement adapté aux sourds, c’est à dire ne leur parle le langage de la compréhension en leur donnant les encouragements nécessaires ; ne les entretient de leurs peines ou de leurs espoirs ; ne les met en garde contre les dangers d’un isolement trop prolongé » , déplore ainsi l’éditorialiste pour expliquer les raisons qui ont conduit au lancement d’un journal spécifiquement dédié aux malentendants romands. Fridette Amsler Sa fondatrice est Fridette Amsler, de Vevey et pionnière de la SRLS. Née en 1894, elle subit les premiers effets de la perte auditive dans son enfance déjà, perte qui va considérablement s’aggraver à l’orée de l’âge adulte. Très vite, la jeune femme décidément bien déterminée et visionnaire, comprend les enjeux sociaux de la perte auditive, et cherche des moyens de redonner confiance et courage aux « handicapés de l’ouïe » à une époque où les prothèses auditives sont inexistantes. Elle fonde alors - nous sommes en 1922 - la première amicale des sourds et promeut activement la lecture labiale dont elle deviendra d’ailleurs une excellente enseignante. Elle crée même le premier service destiné à faire connaître aux malentendants les ancêtres des premiers appareils auditifs – on les appelait « cornets acoustiques » -, pourchassant sans relâche les nombreux charlatans qui sévissaient à l’époque et organisant des séances de démonstration dans de nombreuses villes romandes. Pendant 25 ans, jusqu’en 1949, elle portera à bout de bras la revue aux écoutes, dont elle s’occupera, avec exigence et compétence, à la fois de la rédaction et de l’administration. Sous son impulsion, aux écoutes deviendra même en 1931, soit 7 ans après sa fondation, l’organe officiel de la SRLS. « Servir. S’il est un mot qui s’applique à la tâche de Melle Amsler et qui caractérise son dévouement, c’est celui-ci, résumera ainsi son successeur M. Loosli, au moment de son décès à la fin des années 50. Jusqu’au dernier moment, elle a voulu servir. Elle a voulu voir et corriger encore les épreuves du numéro qui devait paraître deux jours avant sa fin. Elle a été l’âme de cette publication qu’elle a marquée de son empreinte intelligente et généreuse ». Intelligent et généreux Et effectivement. Aux écoutes dans ses vingt premières années, est déjà intelligent et généreux. Il aborde avec une modestie et une tolérance qui n’empêchent pas une grande pertinence, les grandes problématiques de la vie des malentendants. Il prend, comme on peut le lire dans un numéro de 1934, « soin de sa robe et de chacune de ses pages (…) avec coquetterie et sollicitude pour que le contenu soit varié et plaise à des lecteurs de mentalités différentes » . Les malentendants sont mis à contribution pour rédiger des articles, des voyages sont organisés pour les abonnés, un fonds pour solliciter des dons afin de financer des abonnements est créé, alors que sont déjà récurrentes les préoccupations financières inhérentes à tout journal « à but non lucratif ». En 1944, un éditorial se félicite même que le journal ait « tenu le coup », évitant le « sort commun à tant d’autres ». Et puis, la lecture des noms qui émaillent les comités de rédaction successifs du magazine, malentendants, médecins, bénévoles, est riche en enseignements, garante de sa qualité rédactionnelle. Entre autres noms, on peut ainsi retrouver ceux des Dr Curchod et Fath de Lausanne, de Melle Moreillon également de Lausanne, du Dr Morard de Fribourg, de Jacques Vuilleumier de Tramelan, de M. Junod de Genève, de Marc Jaccard du Locle, de Melle Gerhard de Château-d’Oex, de M. Mouchet de Neuchâtel, plus récemment de Lilia Pellet, etc. Pendant près de 90 ans, tant de bonnes fées se sont penchées sur le berceau du bébé et ont contribué à le faire grandir puis prospérer au service des malentendants, qu’il serait bien difficile de citer tous leurs noms. Hommage leur soit rendu ici. Comme dans tout journal, il y a également des lettres anonymes, que le comité de rédaction rejette fermement au nom d’une éthique sourcilleuse, des erratums, des mises en garde et des jeux. Pour ne paraître que tous les deux mois, aux écoutes est complet, responsable, varié et proche de ses lecteurs, qui le plébiscitent et sont toujours très sensibles aux mots d’encouragements qu’on peut, à chaque édition, y lire : en 1975, l’éditorial du magazine, sensible à la difficile réalité des malentendants, réitère son crédo avec force et sagesse : « aux écoutes vous dit : courage, confiance, nous ne sommes jamais seuls. Nous avons besoin les uns des autres. Accepter son infirmité, regarder tout ce que l’on possède encore, n’est-ce pas un privilège ? » . Bien des femmes et des hommes se sont donc dévoués pour aux écoutes et pour la cause des malentendants. Si les humains partent, leur œuvre reste. Aux écoutes a donc perduré et duré au fur et à mesure des décennies, sans jamais perdre ni son âme, ni sa vocation. Son aspect en revanche a bien souvent changé, et à l’instar du tournant qu’il s’apprête à prendre bientôt, il a toujours su s’adapter à son époque, se renouveler tout en restant fidèle à sa mission, grâce à ses comités de rédactions successifs. La couleur est progressivement introduite en bichromie bien sûr, puis en multichromie, les polices de caractère évoluent, les publicités et les petites annonces s’étoffent, la couverture change et subit régulièrement des rafraîchissements, avec des photographies qui à chaque fois contribuent à le rajeunir. Le prix de l’abonnement, toujours modeste pour demeurer accessible au plus grand nombre, s’adapte à l’inflation, il passe à 6 francs en 1963, puis à 10 francs dans les années 70, 20 francs en 1983, 25 francs dans les années 90. Les problématiques abordées évoluent également avec les questions économiques et financières qui sont de plus en plus souvent abordées au fur et à mesure que se développent les assurances sociales. Tournant majeur Avec le tournant du siècle à l’aube des années 2000, aux écoutes connaît un changement majeur : la SLRS dont il est l’organe officiel, change de statut et se transforme en une toute jeune fondation, forom écoute. « Hervé Hoffmann, qui est à ce moment-là devenu le directeur de la fondation, a engagé un profond changement du magazine, un peu moins tourné vers la vie des amicales, même si celle-ci a continué à être amplement traitée, et plus vers des thématiques globales des malentendants, techniques, sociales, économiques », raconte Anne Grassi employée de la fondation depuis de longues années. En 2010, sous la houlette de Jean-Pierre Mathys, aux écoutes s’agrandit littéralement et change de format et de maquette pour s’éloigner encore un peu plus du modèle amicalien et devenir un magazine de plus grandes dimensions, complètement en couleurs, moderne et complet, dédié à l’information autour de la surdité, de ses conséquences, de ses prises en charges et de son coût social et psychique pour le malentendant. Des témoignages et des reportages y sont introduits en grand nombre. « Nous allons donner aussi souvent que possible, la parole aux malentendants, aux associations et aux amicales disséminées aux quatre coins de la Romandie, en donnant également un maximum d’informations sur l’actualité de la malaudition » , écrit ainsi son rédacteur en chef Jean-Pierre Mathys, dans son éditorial de janvier 2010. Un changement graphique et éditorial évident, très bien accueilli par les lecteurs, et qui s’inscrit dans la continuité des engagements pris par le journal depuis sa fondation quelque 90 ans plus tôt. « Vaillants et utiles » Trait d’union presque centenaire entre forom écoute et les malentendants, aux écoutes s’apprête donc aujourd’hui à vivre un nouveau changement de son histoire, en s’adaptant aux évolutions technologiques. Le papier s’efface désormais et, par la magie du numérique et de l’informatique, laisse la place à de nouveaux supports résolument modernes : ordinateurs, tablettes, smartphones... Mais si les supports évoluent, la vocation reste la même, puisque ses fidèles lecteurs continueront à y trouver le contenu qui fait depuis si longtemps son succès, mélange de proximité, de témoignages et d’informations utiles à leur quotidien. Sur internet, et avec une caisse de résonnance démultipliée grâce au web, aux écoutes continuera ainsi à fournir aux malentendants et selon les propos de Fridette Amster dans le premier numéro paru en 1924, « les moyens d’être vaillants et utiles ». SUIVANT PRECEDENT
- Le cinéma pour tous | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Le cinéma pour tous 27 septembre 2018 Publié le : Regards Neufs poursuit ses activités pour rendre accessible la culture cinématographique aux personnes souffrant d’une déficience visuelle ou auditive. Géré par l'association Base-Court créée en 1999, Regards Neufs a trouvé son public au fil des ans. Initialement, cette plateforme est dédiée uniquement à la programmation de films courts suisses et internationaux. Depuis 8 ans, elle propose également des longs métrages avec audiodescription en salle et sous-titrage. Elle promeut ainsi l’accès à la culture cinématographique aux personnes déficientes visuelle ou auditive. En 2015, la fondation forom écoute publiait un article à ce sujet. Le point aujourd’hui, deux ans après l’entrée en scène de l’application Greta en Suisse et la formation d’audiodescripteurs romands. Regards Neufs propose des films sous-titrés dans différentes salles de cinémas romandes depuis 2010. Dans un premier temps, cette prestation était offerte aux personnes malvoyantes ; l’offre s’est ensuite étendue à Genève et Martigny dédiée aux personnes sourdes et malentendantes. Celle-ci restait tout de même restreinte, car elle concernait quasi exclusivement les personnes en situation de handicap visuel ou auditif ; l’audiodescription était audible dans la salle et le sous-titrage présent à l’écran. L’audiodescription des longs métrages documentaires et de fiction financés par l’Office fédéral de la culture étant obligatoire, une formation d’audiodescripteur professionnel a été donnée en 2016 et 2017. Depuis deux ans, l’association prend son essor au niveau national, grâce aux applications Greta (audiodescription) et Starks (sous-titrage). Dès lors, trois nouveaux films par mois sont proposés à leur sortie en salle, ainsi que dans le cadre de festivals. Greta deux en un A l’origine, l’application mobile Greta permettait d’accéder uniquement à l’audiodescription et Starks au sous-titrage dans toutes les salles suisses lors des séances tout public. Le téléphone se synchronise automatiquement à la bande son du film sans connexion wifi. L’audiodescription est audible dans un simple casque branché au smartphone et la lecture du sous-titrage s’effectue sur l’écran. Depuis 2018, ces deux applications sont regroupées sur l’application Greta. Il suffit de choisir si l’on souhaite accéder à l’audiodescription ou au sous-titrage lors de la première connexion. La lecture du sous-titrage pour les personnes sourdes et malentendantes sera encore améliorée avec la sortie prochaine de lunettes connectées. Au service de la sensibilisation Depuis 2014, Regards Neufs organise des ateliers de sensibilisation à l’audiodescription dans des classes primaires. L’objectif est de rendre attentives les personnes valides aux questions du handicap et à l’importance de l’accessibilité de la culture au plus grand nombre. Les élèves écrivent eux-mêmes l’audiodescription d’un court métrage avec le concours d’une pédagogue formée. Cette démarche leur permet de se mettre dans la peau d’une personne aveugle ou malvoyante en situation de projection, afin de décrire de la manière la plus pertinente les actions et les éléments nécessaires à la bonne compréhension du film. La recherche du mot juste pour une description précise et respectant l’esprit de l’auteur implique un travail rigoureux de la langue. Suite à l’écriture, les élèves interprètent et enregistrent leur audiodescription dans un studio son ; une occasion de travailler l’interprétation et la diction. Un making-of et un DVD édité complètent ce dispositif. Ils présentent ensuite le fruit de leur travail durant une séance publique en salle de cinéma. Elle aura lieu le samedi 13 octobre à la Cinémathèque Suisse à 11h. Le Génie de la boîte de raviolis de Claude Barras sera projeté avec l’audiodescription réalisée par les élèves. Leur travail sera également visible le même jour à la Bibliothèque d’Yverdon. Entre 10h30 et 11h30, Bruno Quiblier, directeur de Base-Court y présentera le film et le travail de sensibilisation réalisé par Regards Neufs. Droit d’écoute Si depuis 2016 l’audiodescription fait partie des exigences de l’Office Fédéral de la culture auprès de producteurs de films par le biais d’une ordonnance, les sous-titrages pour personnes sourdes n’ont pas l’obligation d’être produits. Il reste encore du travail pour que le public sourd et malentendant ait accès à un plus grand nombre de films. Les milieux du handicap visuel, notamment la Fédération Suisse des Aveugles, se sont fortement mobilisés pour que la production d’audiodescriptions progresse tant à la télévision qu’au sein de la production cinématographique helvétique. Alors que la création de sous-titres est bien moins chère, le cadre légal ne spécifie rien en la matière. Regards Neufs encourage les associations qui représentent les intérêts du public touché par un handicap auditif à se mobiliser pour obtenir que les films suisses soient également sous-titrés lors de leur sortie en salle. Elle poursuit ses efforts dans le but de voir la loi évoluer. Bouillon de culture Regards Neufs collabore tout au long de l’année avec des festivals de films tels que Visions du réel, Le Festival de Locarno, le GIFF à Genève ou encore le Festival du Film de Zurich. Durant sa 14ème édition qui se déroule du 27 septembre au 7 octobre 2018, Regards Neufs y propose deux films avec audiodescription et sous-titrage en allemand : Les ailes du désir de Wim Wenders et Wolkenbruch de Michael Steiner. « Nous intervenons également sur invitation d’autres institutions culturelles, dont la Biennale Out of the Box, le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou le CHUV, afin de faire mieux connaître les méthodes d’accessibilité du cinéma pour les personnes touchées par un handicap », précise l’équipe de Base-Court. Pour les projections en festival et les sorties de films en salle ou toute autre activité, les informations sont disponibles sur le site : http://www.regards-neufs.ch/ [border-around color="blue"]A voir et à entendre Samedi 13 octobre 2018 Projection : Le Génie de la boîte de raviolis de Claude Barras, Cinémathèque Suisse à 11h. Présentation : résultats du travail des élèves de classes primaires de l’Atelier de sensibilisation à l’audiodescription, Bibliothèque d’Yverdon-les Bains de 10h30 à 11h30. Présentation : film et travail de sensibilisation réalisé par Regards Neufs, avec le directeur de Base-Court, Bruno Quiblier.[/border-around] Copyright : Base-Court 1 Application mobile Greta, mode d’emploi. Audiodescription et sous-titrage avec les contenus disponibles au même endroit. Lors de la première connexion, choisir la version souhaitée des films dans les cinémas. L'utilisation de l'application et son interface restent inchangées : même identifiant et accès au catalogue des audiodescriptions ou sous-titres disponibles. Pour installer la dernière mise à jour de Greta, télécharger la nouvelle application sur App Store ou Google Play et choisir l'option audiodescription ou sous-titrage lors de la première utilisation. 2 sans légende SUIVANT PRECEDENT
- La Confédération rend hommage aux bénévoles | FoRom Ecoute
Retour au Magazine La Confédération rend hommage aux bénévoles 21 juin 2017 Publié le : À l’invitation de la présidente de la Confédération Doris Leuthard, du président du Conseil national Jürg Stahl et du président du Conseil des États Ivo Bischofberger, une centaine de représentants du travail bénévole se sont rencontrés le 17 juin dernier à Berne pour un échange de vues. Près d’un quart de la population suisse s’engage bénévolement dans des associations et des organisations. Un des secteurs qui en profite est le sport, a relevé le président du Conseil national Jürg Stahl : « Sans le soutien des bénévoles, la Suisse ne disposerait pas d’une offre pour le sport populaire et des manifestations sportives de grande et de moindre envergure ne pourraient pas être organisées, ce que l’on ne saurait assez souvent rappeler. » Le président du Conseil des États Ivo Bischofberger a pour sa part estimé qu’une « société ne pouvait tout simplement pas se passer du travail bénévole. Celui-ci le rend toutefois bien à l’individu : celui qui s’engage pour le bien de la collectivité est plus heureux et plus satisfait dans la vie. » La présidente de la Confédération Doris Leuthard a ajouté que l’État pouvait certes organiser et établir des règles, mais que « l’État ne peut pas prescrire la solidarité. » Le professeur Markus Freitag, politologue à l’Université de Berne, a enfin précisé que du travail bénévole était également fourni en dehors des associations et des organisations. Selon les chiffres de l’Observatoire du bénévolat Suisse, près de 40 pour cent des Suisses aident leur prochain ou fournissent des soins. 700 millions d'heures par an « En Suisse, les bénévoles effectuent environ 700 millions d’heures de travail par an » estime Markus Freitag. Si cette tradition du travail non rémunéré est certes profondément ancrée en Suisse, la disposition au bénévolat est en recul en raison de l’évolution des mentalités, de la nouvelle répartition des rôles au sein de la famille et des contraintes professionnelles accrues à l’époque de la mondialisation et de la numérisation. Il devient notamment plus difficile de trouver des volontaires pour occuper des fonctions politiques selon le principe de milice. Selon Markus Freitag, il conviendrait de contrer cette évolution par une éducation civique ciblée afin de mieux sensibiliser la population à l’importance du principe de milice, par une valorisation de nos institutions et par des incitations accrues. Dans plusieurs ateliers, des questions telles que la reconnaissance et la meilleure visibilité du bénévolat ont été abordées. Les participants ont en outre profité de l’occasion pour discuter et agrandir leurs réseaux. Dans le débat public final, les instruments permettant d’améliorer la reconnaissance du bénévolat par la société et l’économie ont notamment été évoqués. Le président du Conseil des États Ivo Bischofberger, le professeur Markus Freitag, Erwin Grossenbacher, président de la Fédération suisse de gymnastique, Annemarie Huber-Hotz, présidente de la Croix-Rouge suisse, et Monika Rühl, directrice d’economiesuisse ont participé à ce débat. Source Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, Berne. SUIVANT PRECEDENT
- A Genève, un projet de loi prévoit des exceptions au port du masque anti-covid | FoRom Ecoute
Retour au Magazine A Genève, un projet de loi prévoit des exceptions au port du masque anti-covid 23 septembre 2020 Publié le : Un projet de loi modifiant la loi genevoise sur la santé prévoit des exceptions et des dérogations au port du masque sanitaire dans le cas où des personnes sourdes ou malentendantes seraient concernées. C’est clairement une première cantonale. A la fin du mois d’août dernier, des députés du Grand Conseil, le parlement genevois, déposaient un projet de loi inédit. Pour la première fois en effet depuis le début de l’épidémie de covid 19, un article de loi (art. 122A du projet PL 12761 ) mentionne explicitement les besoins des malentendants et sourds, en prévoyant une dérogation claire au retrait du masque de protection anti-coronavirus: « Il est autorisé de retirer le masque, peut-on y lire dans son alinéa b, dans la mesure où il est nécessaire de communiquer avec une personne sourde, malentendante ou une personne qui pour des raisons particulières, notamment médicales, ne peut pas communiquer correctement avec une personne portant un masque » . Un cadre légal bienvenu et susceptible d’éviter une mésaventure comme celle qu’a connue il y a quelques semaines et toujours à Genève, Marine Barrot . Alertée par de nombreuses associations de malentendants, et via la FéGAPH (la Fédération Genevoise des Associations de Personnes Handicapées et de leurs proches) dont elle assure la présidence, la députée verte Marjorie de Chastonay accompagnée du socialiste Cyril Mizrahi, également très impliqué dans les problématiques liées au handicap, ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Double objectif « L’objectif de ce projet de loi est double, explique-t-elle. D’abord assurer le respect des minorités, en particulier ici des personnes sourdes et malentendantes, pour lesquelles, le retrait du masque de protection de leur interlocuteur représente un besoin fondamental afin qu’elles puissent communiquer ». Et d’ajouter : « L’autre axe bien sûr est de fournir un cadre légal aux décisions prises jusqu’à présent par le Conseil d’Etat genevois en matière de port du masque pour que le parlement puisse jouer de sa marge de manœuvre afin d’organiser les exceptions » Car c’est en effet bel et bien via un simple arrêté et non une loi et donc sans contrôle parlementaire, que le conseiller d’état genevois en charge de la santé, Mauro Poggia reprenant d’ailleurs en cela les recommandations de l’Office fédéral de la Santé publique , a pu organiser le port du masque dans son canton, tout en rendant possibles des exceptions dans le cas où des personnes en situation de handicap ou présentant un certificat médical étaient concernées. Quelques semaines Discuté en séance plénière au Grand conseil genevois, le projet de loi n’a pas pu réunir de majorité, pour des raisons qui n’ont d’ailleurs rien à voir avec la problématique des malentendants. Le projet a néanmoins pu être renvoyé à la Commission de la Santé du parlement qui devrait à son tour le renvoyer après travaux, en séance plénière. « Tout cela devrait prendra encore quelques semaines, pronostique Marjorie de Chastonay. La peur du covid est en train de s’apaiser peu à peu et j’espère qu’on devrait pouvoir arriver à en débattre sereinement. Mais il reste un grand travail pour qu’un compromis puisse être trouvé et que les élus du peuple retrouvent leur mot à dire ». SUIVANT PRECEDENT
- Les dangers des baladeurs numériques | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Les dangers des baladeurs numériques 16 janvier 2010 Publié le : Ipod, lecteurs mp3, radios numériques… Si la plupart des usagers font une utilisation très raisonnée de ces nouveaux appareils, un certain nombre de jeunes ont tendance à les écouter trop fort et trop longtemps. Avec des risques évidents de perte d’audition. Le point sur cette problématique, thème principal de la 13ème Journée Nationale de l’Audition qui aura lieu le 11 mars prochain. Qui, un jour, ne s’est jamais senti importuné, dans un tram, un bus, un avion ou un train, par ces jeunes et moins jeunes, qui, le baladeur numérique vissé sur les oreilles, inondaient leur entourage de leurs décibels intempestifs ? « Ce n’est pas possible, s’exclame, exaspérée, une vieille dame croisée dans le train Genève-Fribourg. J’entends leur musique à plus d’un mètre de distance. Comment font-ils, avec un tel bruit, pour ne pas devenir sourds ? » Ipod, lecteurs mp3, émetteurs radio incorporés au téléphone portable… Depuis quelques années, les baladeurs numériques connaissent un succès foudroyant. Pratiques, discrets avec leurs petites oreillettes, dotés d’une très grande autonomie d’écoute et d’une capacité quasi-infinie de stockage –jusqu’à un millier de chansons ! -, ils marquent la consécration de la musique « nomade » au point que les jeunes en sont littéralement fous. « Nous n’en avons jamais vendu autant, plusieurs dizaines par jour, constate le chef de rayon d’un grand magasin multimédia de Lausanne. Les jeunes se les arrachent, d’autant que, de plus en plus, ces petits bijoux font l’objet d’une véritable offensive marketing. C’est non seulement un moyen d’écouter de la musique, mais aussi une façon d’être résolument branché, même pour les moins jeunes ! » Ventes record Remplaçants du bon vieil et encombrant walkman, désormais rejeté aux oubliettes du multimédia moderne, les baladeurs numériques atteignent désormais des niveaux impressionnants de miniaturisation et ont en outre l’incontestable avantage de diffuser un son de très haute qualité. Résultat : en Europe, une centaine de millions de personnes en utiliseraient quotidiennement, tandis qu’en Suisse, les ventes affichent des records. Avec un risque non négligeable : celui d’altérer temporairement ou définitivement les capacités d’audition de ceux qui les utilisent. Depuis quelques années en effet, de nombreuses études attirent l’attention des consommateurs sur les dangers liés à l’utilisation des baladeurs numériques. Ainsi dès 2006, une association américaine mettait en garde le public sur le fait que la moitié des adolescents américains présentaient des problèmes d’audition, problèmes essentiellement attribués à ces appareils. En 2007, une étude britannique concluait que plus de deux tiers des adolescents utilisant les baladeurs s’exposaient à des problèmes prématurés d’audition en raison d’un son trop fort. Côté européen, c’est le Comité scientifique des risques sanitaires émergents de la Commission européenne (CSREN) qui estimait, dans une récente évaluation, que « 5 à 10% des propriétaires de baladeurs risquent des pertes auditives irréversibles » en cas d’utilisation inappropriée de leur appareil. Médecin spécialiste en ORL au CHUV, Raphaël Maire se veut néanmoins rassurant : « Je n’ai quasiment jamais eu de patients consultant pour des troubles auditifs suite à l’utilisation de lecteurs mp3. Très honnêtement, s’ils sont utilisés correctement, il n’y a pas de risques avec ces baladeurs. La plupart sont plombés pour être limités à une puissance maximale de 100 décibels et il ne faut pas hésiter à consulter les données du fabricant pour trouver cette puissance limite. En fait, beaucoup de gens croient que les jeunes écoutent trop fort la musique. En réalité, c’est simplement une impression liée au fait que la plupart des écouteurs sont juste posés sur les oreilles, si bien qu’il y a une perte de son qui diffuse aux alentours ». Niveau raisonnable Un « diagnostic » rassurant, corroboré par les résultats d’une étude de la compagnie d’assurances SUVA qui, en 2007, a mesuré le niveau sonore préféré de 450 adolescents à Zurich, à Ftan en Engadine et à Payerne, avec des résultats sans appel : « Les appareils portatifs munis d'écouteurs, peut-on y lire, sont moins dangereux pour l'ouïe qu'on ne le craignait », puisque la très grande majorité des jeunes écoutaient la musique à un niveau très raisonnable, de l’ordre de 80 décibels, loin du plafond théorique des 100 décibels. Pour rassurants qu’ils soient, ces constats ne doivent néanmoins pas pour autant occulter certains faits synonymes de danger pour une minorité d’usagers : la même étude relève ainsi qu’environ « 7% des utilisateurs d'appareils à restituer de la musique (baladeurs, mp3, etc.) exposent leurs oreilles à une charge sonore continue pouvant engendrer des lésions de l'ouïe ». Plus inquiétant encore, la même SUVA a testé en 2006 les niveaux sonores de divers baladeurs commercialisés en Suisse. Avec un résultat alarmant : un grand nombre d’entre eux, munis de leurs écouteurs d’origine, atteignaient le volume maximal de 103 décibels, soit une intensité sonore… deux fois supérieure à la norme de 100 décibels admise en Suisse et en Europe. Appareils « débridés » Mais il y a pire. Nombre de jeunes, « accros » aux sons excessifs, écoutent de la musique avec des écouteurs ou des casques différents de ceux livrés par les fabricants et qui, dotés d’une plus grande sensibilité, sont capables d’amplifier le son de l’appareil de 6 à 10 décibels supplémentaires. « C’est vrai, admet mezzo voce notre vendeur lausannois. Beaucoup de jeunes viennent acheter de nouvelles paires d’oreillettes, estimant que les produits de série sont bas de gamme. En général, ces nouvelles paires sont bien plus sensibles et augmentent l’intensité sonore! » Mieux encore : en surfant sur le net, il est tout à fait possible de « débrider » son baladeur numérique en téléchargeant le plus simplement du monde, la version américaine des logiciels qui le font fonctionner, et qui autorise des plafonds d’intensité nettement supérieurs. De fait, un certain nombre de jeunes en Suisse, une minorité, écoutent quotidiennement de la musique avec un son très proche ou même franchement supérieur aux fatidiques 100 décibels. Avec des conséquences évidentes en termes d’audition. « Il n’y a pas de danger spécifique au fait que le son soit d’origine numérique, précise le Dr Raphaël Maire, spécialiste en ORL. Ce qui est dangereux pour l’audition, ce sont en fait les hautes fréquences, quelle que soit la nature ou l’appareil à l’origine du son». Effet cumulatif En cas de traumatisme sonore, ce sont en fait les petites cellules ciliées de l’oreille interne – la cochlée – qui sont altérées. Capables en temps normal de transformer la vibration mécanique du son en influx nerveux acheminé ensuite au cerveau qui interprète alors le son entendu, elles perdent cette aptitude sous l’effet du vieillissement ou de bruits excessifs, entraînant une baisse d’audition. Conséquence : pour éviter ces graves pertes d’acuité auditive, dont certaines sont malheureusement irréversibles, le mieux est d’avoir une utilisation raisonnée des baladeurs, en tenant compte d’un effet de balance entre intensité sonore et durée d’exposition. Eminent spécialiste audio, le professeur Garstecki qui exerce en Louisiane, aux Etats-Unis, propose ainsi une règle facile à retenir, celle des 60-60 : écouter son baladeur avec une intensité de 60 décibels pour une durée maximale de 60 minutes par jour permet de préserver efficacement son audition. « Il y a un effet cumulatif, confirme le Dr Maire. Plus on écoute fort, et moins on doit écouter longtemps. Ce qu’il faut, c’est donc faire une gestion intelligente de l’exposition. Ainsi, avec une intensité de 80 décibels, qui correspond à un niveau normal d’écoute, on peut écouter sans problème plusieurs heures par semaine. D’une manière générale, il faut utiliser son baladeur avec un volume d’écoute confortable et faire de larges pauses dans le courant de la journée. C’est le meilleur moyen d’éviter les perturbations ! » Charaf Abdessemed et Jean-Pierre Mathys SUIVANT PRECEDENT