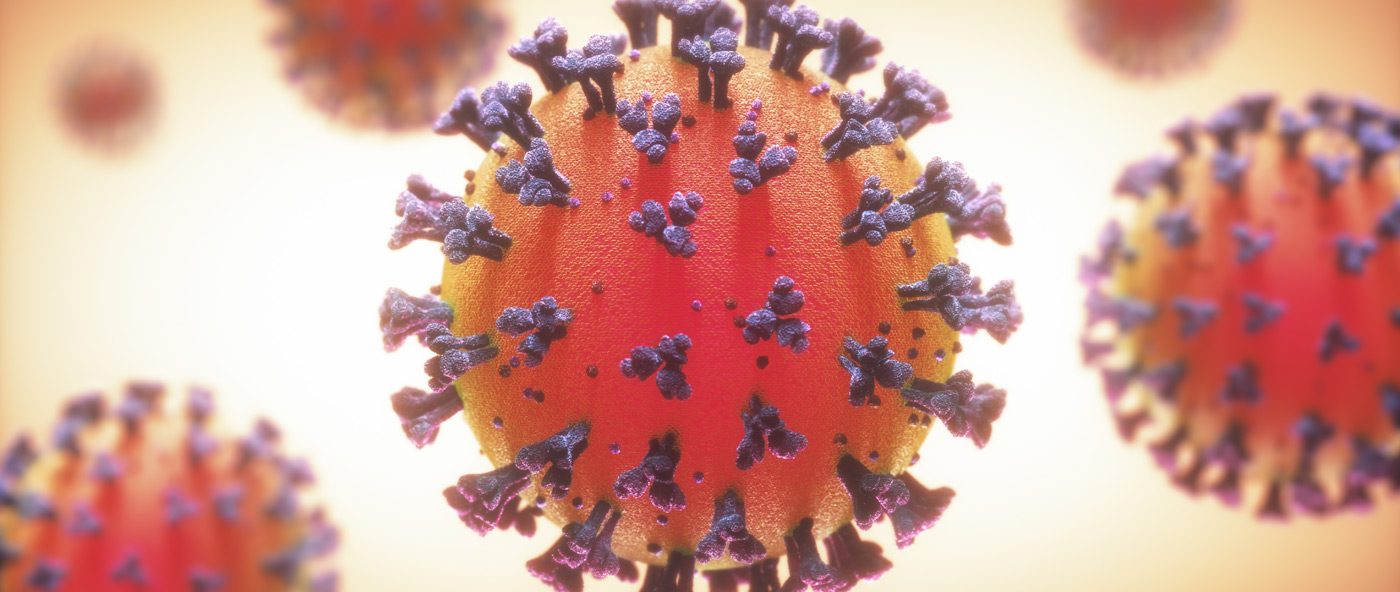2475 résultats
- Harmonie Rochat : « On m’appelle la campagnarde ! » | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Harmonie Rochat : « On m’appelle la campagnarde ! » 15 juillet 2014 Publié le : Une vraie fille de la campagne, et très fière de l’être ! Âgée de 16 ans, Harmonie Rochat la bien-prénommée a grandi dans sa ferme familiale à Mauraz, dans le canton de Vaud. Rencontre avec une jeune malentendante épanouie qui a les pieds bien sur terre et le cœur… dans sa famille ! Tout d’abord, d’où vous vient ce magnifique prénom ? En fait, mon nom de famille est très courant. Donc mes parents ont souhaité que nous ayons tous des prénoms originaux, d’où le « Harmonie », et en français pour qu’il sonne bien (rires) ! Depuis quand êtes-vous malentendante ? C’est un petit peu compliqué ! En fait, vers l’âge de 12 ans, j’ai contracté une méchante pneumonie, et quasiment du jour au lendemain, j’ai perdu l’ouïe, une expérience très angoissante et très traumatisante pour moi et pour toute ma famille ! Le médecin qui m’a examinée, m’a dit qu’il fallait attendre un peu et que ça allait revenir… Et ? Eh bien, ça n’est jamais revenu ! Deux mois après, nous avons consulté un ORL, qui nous a annoncé que j’avais une importante perte auditive au niveau des deux oreilles, et que c’était définitif ! Et c’est à ce moment-là qu’on a pris conscience que mes soucis d’audition dataient en fait d’avant la pneumonie. Comme on le dit dans ma famille, j’ai commencé à faire preuve d’humour dès lors que j’ai été appareillée ! C’est bien la preuve que tout ne tournait pas rond avant (rires) ! En dehors de l’humour, les appareils ont-ils changé quelque chose au niveau de l’école ? Oui, clairement, avant j’étais plutôt solitaire, je parlais peu, j’avais de la peine à m’intégrer ! Avec les appareils, mes notes se sont améliorées, même si, au niveau scolaire, j’ai dû suivre la filière VSO (Voie secondaire à options, ndlr) et que j’ai terminée en juin 2013 ! C’est d’ailleurs à ce moment-là que vous avez reçu le Prix aux élèves malentendants décerné par forom écoute ! Oui et c’est mon prof qui me l’a annoncé, en me proposant de me le remettre devant tout le monde lors des promotions ! J’étais vraiment contente ! Et aujourd’hui, où en êtes-vous de vos études ? Comme je n’avais pas réussi à intégrer la VSG (Voie secondaire générale, ndlr), je fais actuellement un raccordement pour y arriver. Je suis très contente d’avoir la possibilité de rattraper le retard dû à la malaudition ! Et ensuite ? J’habite une ferme et j’adore les animaux, d’ailleurs à l’école, on m’appelait « la campagnarde » ou « la bucheronne » (rires). Alors petite, je voulais devenir vétérinaire… Mais un stage m’en a dissuadée : je n’aime vraiment pas voir les animaux souffrir ! Comme je n’ai pas envie de faire le gymnase, je me destine à devenir assistante médicale. Mais ce n’est vraiment pas facile de trouver une place d’apprentissage dans la région ! Au pire, il y a aussi l’école d’agriculture de Marcelin, à Morges ! Que faites-vous, en dehors de l’école ? D’abord, je participe à la vie de la ferme en aidant mon père, et j’adore ça, même si ça prend pas mal de temps! D’ailleurs si mon grand frère ne s’y destinait pas, j’aurais adoré en reprendre l’exploitation plus tard ! Sinon, je sors, je fais du théâtre, etc… Je voyage peu, en dehors des vacances avec ma famille en Espagne. Au fond, je me sens bien dans ma vie, dans ma ferme, et dans ma famille à laquelle je suis très attachée. Je suis une fille de la terre et j’aime ça ! Propos recueillis par Charaf Abdessemed SUIVANT PRECEDENT
- Genève: Une association au service des malentendants | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Genève: Une association au service des malentendants 16 mars 2015 Publié le : Fondée dans les années 20, l’Association Genevoise des Malentendants (AGM), qui au départ n’était qu’une amicale, est dirigée depuis l’année dernière par le Dr Pierre Liard, président et par Yolande Bosshard, vice-présidente. Rencontre avec un tandem déterminé et à la bonne entente manifeste. Comment vous êtes-vous retrouvés à la tête de l’AGM ? PL : J’ai une première fois fait partie du comité de l’association dans les années 80. Puis dans les années 2000, j’en ai même occupé la vice-présidence, malgré mes activités de médecin ORL. L’année dernière, quand le président sortant a souhaité passer la main après plusieurs années de présidence, le comité s’est tourné vers moi. Retraité, j’ai dit oui, mais à la condition expresse que Yolande Bosshard devienne la vice-présidente (rires) ! YB : Nous nous connaissons depuis très longtemps et nous nous entendons très bien. Il était donc normal que je me joigne à Pierre ! Le statut d’association est très important pour vous… Oui, car nous ne sommes pas une amicale ! Pour nous, il ne s’agit pas seulement d’offrir des occasions de rencontres pour les malentendants, mais bel et bien de mettre des prestations très concrètes à leur service. Quel type de prestations offrez-vous ? L’action de notre service social, particulièrement actif, est pour nous primordiale. Les personnes souffrant de surdité sont très précarisées, elles ont donc besoin d’un conseil et d’un soutien particulier. L’association emploie 4 personnes dont trois assistants sociaux qui reçoivent les malentendants pour tenter de répondre au mieux à leurs besoins, qu’il s’agisse de leur vie quotidienne ou professionnelle. En outre, une conseillère en aides auditives se consacre à des visites dans les EMS afin d’aider les malentendants âgés à régler et gérer leurs appareils auditifs, une prestation rendue indispensable depuis que la 2ème expertise de contrôle pratiquée par l’ORL a été supprimée par l’OFAS. Quelles autres services assurez-vous ? Chaque jeudi, Yolande Bosshard assiste au colloque de notre personnel afin de faire le lien avec le comité de l’association. En outre, nous adressons dix fois par an à nos membres une newsletter contenant des informations liées à la malentendance. Enfin, pour mieux vérifier qu’ils répondent à leurs besoins, les malentendants peuvent venir dans nos locaux tester divers appareils téléphoniques avant d’en faire l’acquisition. Comment est financée l’AGM ? Essentiellement par Pro Infirmis avec laquelle nous sommes liés par un contrat de prestations, ce qui au passage nous impose une lourde tâche administrative. Nous sommes également soutenus par la Ville, certaines communes genevoises, ainsi que des fondations qui nous aident de manière régulière. Le principal enjeu est de garantir notre financement, qui n’est de loin pas acquis, puisque par exemple, Pro Infirmis a, cette année, diminué son allocation de 20%. Le défi est d’arriver à maintenir, voire d’augmenter, nos prestations de service social, alors que nous sommes clairement de plus en plus sollicités. Le nouveau régime de remboursement forfaitaire des appareils auditifs conduit de plus en plus de personnes à s’adresser à nous ! Et pour être complets, nous obtenons parfois des financements, mais très ponctuels et liés à des actions précises et limitées dans le temps. Combien de membres compte l’AGM ? Environ 200, un chiffre relativement stable malgré quelques fluctuations. En réalité, ce qui change, c’est que nos membres sont de plus en plus âgés. Cette évolution est dans l’air du temps, car en dehors des prestations et en raison de la nature même de ce handicap invisible, il est difficile d’offrir aux malentendants des prestations efficaces à 100%. Même l’appareillage ne résout pas tout, puisqu’un malentendant appareillé reste un malentendant ! Bref, tout cela fait que l’on a plus de mal à recruter des jeunes, qui souvent, attendent des réponses immédiates et concrètes ! Quels sont vos projets pour l’avenir ? Pérenniser coûte que coûte nos prestations ! Et une chose est sûre : si notre service social venait à disparaître, cela coûterait plus cher à la Ville et au canton de Genève que ce que nous leur coûtons aujourd’hui ! Nous devons également mieux faire connaître l’AGM et ses projets et continuer à soutenir le personnel de notre association, qui est très dynamique et motivé. En outre, nous projetons d’éditer un fascicule destiné aux malentendants qui résumera les principales problématiques qui les concernent, de la dimension psychologique de ce handicap, aux questions d’adaptation professionnelle, en passant par la famille, l’intégration scolaire etc. Propos recueillis par Charaf Abdessemed SUIVANT PRECEDENT
- Berne : Un Palais fédéral accessible aux malentendants | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Berne : Un Palais fédéral accessible aux malentendants 12 janvier 2013 Publié le : Depuis 2008, l’édifice historique où siègent les chambres fédérales est accessible aux malentendants, via des boucles magnétiques et des installations sans fil. Pour l’architecte et expert biennois Max Meyer, qui a ausculté l’ensemble de l’infrastructure, le résultat est très satisfaisant. C’était en novembre 2008, il y a un peu plus de quatre ans. Après 36 mois de travaux, le Palais du Parlement fédéral, à Berne était inauguré officiellement, après que grues et échafaudages aient été remisés au placard. Il faut dire que l’édifice, centenaire, avait bien besoin d’une cure de rajeunissement. Et après le «Bernerhof» et l'aile ouest, c’était au tour du Palais du Parlement proprement dit de subir d’importants travaux. Le résultat a été à la hauteur des attentes, et les modifications nombreuses, puisqu’il s’agissait, selon le communiqué officiel, « d’offrir aux membres de l'Assemblée fédérale un environnement de travail représentatif et moderne ». Grande innovation, de nouveaux ascenseurs et rampes d’escaliers, répondant « aux exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées », ont en outre été mis en place. Heureusement, les malentendants n’ont pas été oubliés dans l’opération et, dans la panoplie des nouveautés, figuraient de nombreuses installations à leur intention. Des infrastructures spécifiques qui ont coûté, selon les estimations fournies par Marius Perler, chef des constructions à l’Office fédéral des constructions et de la logistique, environ 90'000 francs, une paille devant les… 103 millions qui ont été alignés pour l’ensemble des travaux de rénovation. Motion Il faut dire que l’on partait de rien, ou si peu, c'est-à-dire, dans les salles du Conseil National et du Conseil des Etats, de prises pour écouteurs sur les pupitres des parlementaires et sur toutes les places des tribunes ouvertes au public. En 2002, constatant que les « installations techniques du Palais du Parlement et la configuration du bâtiment (limitaient) fortement les possibilités d’utilisation de ce dernier par les malentendants », le Conseiller national bernois Rudolf Joder déposait une motion intitulée « Rendre le Palais fédéral utilisable par les malentendants », demandant, en particulier, l’installation de boucles magnétiques. Dans sa réponse, le Conseil fédéral s’est aussitôt déclaré prêt à entrer en matière et à faire examiner la « possibilité de faire procéder à des améliorations de nature architecturale et technique en faveur des malentendants ». Résultat: les installations à l’intention des déficients auditifs ont été intégrées au projet global de restructuration et assainissement du bâtiment parlementaire, mis en œuvre en 2006-2008, et inauguré il y a quatre ans. Dans l’intervalle, en 2007, c’est un autre parlementaire, Marc Frédéric Suter qui préside aujourd’hui Intégration Handicap , la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés, qui revient à la charge, par le biais d’une question au Conseil fédéral, demandant encore une fois l’installation de boucles magnétiques. « Je suis moi-même handicapé et me suis occupé des intérêts des personnes handicapées pendant 16 ans au Conseil national, se souvient-il. A l’époque, personne n’arrivait à me dire si des installations étaient prévues ou pas, d’où ma question ». Et de rappeler, un brin philosophe: « c’est la nature humaine, ce qu’on ne réalise pas soi-même, ce qu’on ne vit pas soi-même, n’existe pas. D’ailleurs, quand je suis arrivé pour la première fois au Palais fédéral, j’ai dû entrer comme un container, par une porte secondaire, car il n’y avait pas d’accès pour les personnes handicapées. » Solution sur mesure Toujours est- il qu’en 2008, est enfin livré un Palais entièrement rénové et modernisé, et doté d’équipements modernes pour les personnes malentendantes: désormais, « le bâtiment du Parlement dispose d’installations pour les malentendants dans les deux salles du parlement, sur toutes les tribunes des visiteurs et dans toutes les salles de conférences des commissions, explique ainsi Daniel Scheidegger, des Services du Parlement. Nous avons mis en place une solution sur mesure, qui consiste en l’installation de boucles magnétiques, de boucles magnétiques individuelles mais aussi d’installations sans fil sur la base d’émetteurs infrarouge ». Ces installations ont d’ailleurs été évaluées et testées par la commission « Boucles magnétiques » de forom écoute, et figurent sur la liste des lieux équipés, publiée et régulièrement mise à jour sur le site internet www.ecoute.ch . Spécialiste des questions techniques pour malentendants, l’architecte biennois Max Meyer connaît bien lui aussi les installations mises en place au niveau du Palais fédéral. En 2009, il a publié sur mandat de l’association suisse alémanique Sonos, un ouvrage intitulé « Construire pour les malentendants » et qui s’est fondée sur l’exemple de la restauration du Parlement fédéral. Satisfaisant « Le résultat final est très satisfaisant, observe-t-il. Au final, il y a un accès complet et total pour les personnes malentendantes, ce qui n’était pas évident quand on tient compte des contraintes architecturales de l’édifice, mais aussi des paramètres de sécurité et de confidentialité, importants dans un tel lieu. Bien sûr, des améliorations sont toujours possibles, en particulier dans les grandes salles. Mais dans les salles historiques, il sera difficile de faire mieux, en raison de l’absorption et de la réverbération des sons ». ChA SUIVANT PRECEDENT
- Habitat: Construire pour des malentendants | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Habitat: Construire pour des malentendants 15 juillet 2015 Publié le : Le saviez-vous ? Tout comme on peut concevoir des habitations ou des bâtiments publics spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes souffrant de troubles visuels, il est également tout à fait possible d’adapter les constructions aux sourds et malentendants. «Ce l a f a it tr ente ans que nous pa rl ons d ’ a r ch it ec t u r e adap t ée aux pe r sonnes en f au t eu il r ou l an t e t qu i n z e an s que l a con str uc ti on san s ob st ac l es pou r l es aveug l es e t m a l voyan t s es t un t hè m e . La construction pour les malentendants et sourds, elle a jusqu’ici été négligée », constate Joe Manser, directeur du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés, fondé en 1981 et dont le siège est à Zurich. « Il y a donc un g r and r e t a r d à r a ttr ape r e t une l acune m an if es t e , qu’il est important de combler ». Une lacune d’autant plus inexplicable que la Suisse compte presque un million de malentendants et sourds et que ce nombre ne cesse de croître, en raison notamment du vieillissement constant de la population. Directives techniques Pourtant, les malentendants, aussi bien que les personnes atteintes d‘une surdité acquise ou innée, sont confrontés à de nombreux obstacles architecturaux et techniques qui représentent pour eux, un handicap supplémentaire en matière d‘autonomie et de communication. Alors comment, sur le plan architectural, peut-on adapter une construction au handicap de personnes souffrant de déficience auditive ? Un ouvrage dénommé « La construction adaptée aux malentendants et sourds », publié en mai dernier par le Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés, avec l’appui entre autres partenaires, de forom écoute, détaille les directives techniques à respecter pour atteindre cet objectif. Ces directives sont fondées en partie sur la mise en application d’un concept novateur, intitulé « principe des deux sens », selon lequel il faut construire de manière à ce que les facultés altérées d’un sens, puissent être compensées par un autre sens. C’est d’ailleurs ce principe qui veut que, par exemple dans un ascenseur, les informations acoustiques doivent également être transmises par des messages visuels, la vue venant ainsi compenser la perte auditive. Compensation De fait, ce que le malentendant ne peut pas comprendre par l’ouïe, il le percevra donc par la vue, en compensation, ou même par le toucher, par exemple en percevant l’impulsion d'ouverture (vibrations matérielles) d’une porte, générée par une télécommande. Ecrans, projecteurs, moniteurs, alarmes visuelles, pictogrammes, éclairage optimal, organisation spatiale des lieux, vitrage des ascenseurs représentent ainsi un échantillon, parmi bien d’autres, des mesures qui peuvent être retenues par les concepteurs de bâtiments. L’autre grand axe de construction est bien entendu le respect de normes acoustiques qui permettent d’améliorer l’intelligibilité de la parole (élimination de bruits perturbateurs, utilisation de revêtements phonoabsorbants, etc.), sans compter l’installation dans les locaux, de boucles magnétiques ainsi que de dispositifs d‘écoute spécifiquement destinées aux porteurs d’appareils auditifs ou d’implants cochléaires. ChA [zone]Un outil pour les architectes et les décideurs Forte d’une trentaine de pages, la brochure « La construction adaptée aux malentendants et sourds – Exigences architecturales et techniques », a été publiée en mai dernier par le Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés, sous la direction des architectes Angelo Clerici et Joe Manser. Editée avec le soutien de la Confédération, de la Fédération Suisse des Sourds, de Sonos, de Pro Audito Suisse et bien entendu de forom écoute, la brochure est destinée aux architectes, aux maîtres d’ouvrage et aux autorités en charge des constructions pour les aider à mettre en pratique l’égalité de traitement pour les handicapés exigée par la Lhand, la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées. Les directives qui y sont présentées se basent ainsi sur la norme «SIA 500 Constructions sans obstacle» qui reflète l’état actuel de la technique et définit les exigences minimales pour la construction sans obstacles en Suisse. Les principales recommandations de cet ouvrage ont d’ailleurs été présentées le 7 mai dernier au cours d’une journée d’études qui s’est tenue à l’Université de Lausanne, en présence d’Anne Grassi, représentante de forom écoute. La brochure peut être commandée gratuitement sur le site www.construction-adaptee.ch . Forom écoute a également édité une brochure intitulée « Boucles magnétiques, où les trouver, leur utilisation, leur maintenance », disponible sur simple demande auprès du secrétariat au 021.614.60.50.[/zone] [zone]Six exigences minimales Contrairement à une idée préconçue, les malentendants, les personnes atteintes d‘une surdité acquise et les sourds de naissance sont à l’instar d’autres handicapés, confrontés à de nombreux obstacles architecturaux et techniques. Si on veut leur garantir une qualité de vie équivalente au reste de la population, il y a lieu de satisfaire aux six exigences suivantes en matière de constructions et d’équipements adaptés aux personnes atteintes d’un handicap auditif: Structure spatiale des constructions et des équipements aisément identifiable, afin de faciliter l’orientation et d’accroître la sécurité, étant donné qu’une diminution de l’acuité auditive peut gêner l’orientation spatiale. Visualisation des informations acoustiques selon le principe des deux sens. Bonnes conditions d’éclairage pour la communication fondée sur le contact visuel (gestuelle, mimique, lecture labiale). Bonnes conditions acoustiques pour la communication orale. Installations de sonorisation permettant une bonne compréhension de la parole. Installations d'écoute pour porteurs d'appareils auditifs et pour porteurs d‘implants.[/zone] SUIVANT PRECEDENT
- Kaleab Girma: « libre et autonome » | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Kaleab Girma: « libre et autonome » 15 novembre 2011 Publié le : Suisse d’origine éthiopienne, né à Zurich, Kaleab Girma est malentendant profond et vient de terminer sa scolarité à l’Institut Saint-Joseph, école spécialisée pour les sourds et malentendants. Sa réussite, ce Fribourgeois d’adoption, aîné d’une famille de trois enfants, la doit à sa volonté et au soutien sans faille d’une maman aussi attentionnée que déterminée. Vous avez terminé votre scolarité et venez de recevoir le Prix aux élèves malentendants… J’en suis très content. C’est une reconnaissance et un véritable encouragement, car suivre une scolarité quand on est comme moi malentendant profond est un véritable parcours du combattant. Comment êtes vous devenu malentendant ? A l’âge de 2 ans, j’ai contracté une méchante méningite avec une très forte fièvre qui a duré 2 mois. J’ai perdu l’ouïe à ce moment là, et j’ai même eu des séquelles motrices au bras et à la jambe… On a essayé ensuite de m’appareiller pendant une année, mais malheureusement cela n’a rien donné. Les médecins ont même évoqué l’option de me placer un implant, mais là-aussi ils ont dû renoncer ! J’avais pourtant beaucoup d’espoir. Aujourd’hui, comment communiquez-vous ? La lecture labiale m’est très difficile. Je me base donc essentiellement sur la langue des signes que j’ai apprise à l’Institut Saint-Joseph de Fribourg. Mais c’est vrai que d’une manière générale pour moi, il est difficile de communiquer avec les personnes bien-entendantes, car celles-ci, dans la très grande majorité des cas, ne maîtrisent pas la langue des signes. Comment envisagez-vous la suite de votre parcours scolaire ? Je viens de terminer ma scolarité à l’Institut Saint-Joseph. J’ai cherché un peu partout des stages ou des places d’apprentissage et malgré mes efforts et l’aide de mon entourage, je n’ai pas réussi à trouver de point de chute. J’ai reçu de nombreuses réponses négatives, y compris de grandes entreprises comme Migros et Coop. Finalement, la fondation Effata (ndlr: fondation dont la mission est de contribuer à l’épanouissement et à l'intégration sociale et économique des sourds ou malentendants, à Forel Lavaux, VD), m’a accepté. J’ai passé des tests, pour savoir si je vais faire de la cuisine, de la mécanique ou de la menuiserie. J’attends les résultats. Et si vous aviez vraiment le choix, que souhaiteriez-vous vraiment faire ? Incontestablement de la mécanique. Depuis tout petit, je rêve de conduire des voitures, de les démonter et remonter. J’aime la liberté qu’elles procurent. D’ailleurs, à court terme, j’espère passer mon permis de conduire… En dehors de la mécanique, avez-vous d’autres passions ? Le football ! J’adore ce sport. Mais je n’ai pas trouvé d’endroit à Fribourg pour en faire. En revanche à Lausanne, j’ai fait la connaissance d’un groupe de sourds et je me réjouis de bientôt jouer avec eux ! Et puis, j’adore regarder la télévision. Je comprends très bien ce qui s’y passe, rien qu’en regardant les images, même sans langue des signes ! Comment vous voyez-vous dans dix ans ? Vivant seul ! Pour moi, il est très important d’être libre et autonome. Aujourd’hui, je prépare mon avenir, j’ai encore besoin de ma famille, de ma mère qui fait beaucoup pour moi et me soutient pour tout. Mais un jour, lorsque j’aurais un travail, lorsque ma vie sera bien organisée, je vivrai seul. Avant pourquoi pas, de rencontrer quelqu’un et fonder une famille… Propos recueillis par Charaf Abdessemed SUIVANT PRECEDENT
- Pro Senectute lance une campagne pour l’audition des seniors | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Pro Senectute lance une campagne pour l’audition des seniors 8 novembre 2016 Publié le : Pro Senectute lance une campagne de sensibilisation intitulée « Entendez-vous la vie ? » pour inciter les seniors à pratiquer des tests d’audition. En Suisse, quelque 450 000 personnes de plus de 65 ans souffrent d’une perte d’audition. De nos jours, les personnes âgées souhaitent rester autonomes et vivre chez elles le plus longtemps possible. Mais pour ce faire, il est important qu’elles possèdent une bonne ouïe. Or les statistiques relatives au port d’appareils auditifs en Suisse montrent que 46% des plus de 65 ans n’entreprennent rien pour combattre leur perte d’audition. Pro Senectute estime qu’un retraité sur six souffrant de surdité a un appareil auditif. En d’autres termes, 380000 seniors ne font rien ou presque contre leur perte auditive. Plus grave encore : il s’écoule en moyenne sept à dix ans entre le moment où ils soupçonnent pour la première fois un problème et la décision de se soumettre à un test, un gaspillage de temps précieux. Car plus l’on repousse le traitement de la perte d’audition, plus il est difficile d’adapter correctement les appareils auditifs. Avec le temps, le cerveau perd en effet sa capacité à percevoir les signaux acoustiques et ne parvient plus à reconnaître les bruits. Afin de mieux sensibiliser les seniors à cette problématique, Pro Senectute a décidé de lancer la campagne « Entendez-vous la vie ? ». « Considérant que les pertes d’audition sont des phénomènes normaux liés à l’âge, de nombreux seniors ne font rien pour se soigner et ne portent que sporadiquement, voire jamais, leur appareil auditif », déplore Werner Schärer, directeur de Pro Senectute Suisse. Et de poursuivre : « C’est précisément sur ce point que notre campagne nationale de sensibilisation entend mettre l’accent. Car bien entendre améliore la qualité de vie. Nous voulons donc inciter les seniors à se soumettre le plus tôt possible à un test d’audition » Chargé par Pro Senectute d’examiner les études actuelles consacrées à la surdité des personnes âgées, le centre de compétence interdisciplinaire sur la vieillesse (IKOA) de la Haute école des sciences appliquées de Saint-Gall a montré que sur le plan physique, les pertes d’audition pouvaient provoquer un stress permanent et des symptômes tels qu’une élévation de la pression artérielle chez les seniors. On constate également que les seniors malentendants sont plus souvent victimes de chutes. Du point de vue psychique enfin, la surdité peut être associée à un sentiment de perte, d’angoisse et de dépression. Souvent, les malentendants se replient sur eux-mêmes, fatigués des quiproquos incessants et de la nécessité de toujours demander aux interlocuteurs de répéter leurs propos lorsqu’ils tentent de communiquer. Un guide, du matériel de sensibilisation et des conseils pratiques sont disponibles sur le site www.prosenectute.ch/entendre . SUIVANT PRECEDENT
- Malentendants dans un monde d’entendants : quelles stratégies ? | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Malentendants dans un monde d’entendants : quelles stratégies ? 15 mai 2016 Publié le : Comment lorsque l’on est malentendant, trouver des stratégies, imaginer des passerelles pour réussir sa vie professionnelle et personnelle, dans un monde conçu par et pour les entendants ? C’est la passionnante question à laquelle tentera de répondre la Journée à thème organisée par forom écoute le 11 juin prochain à Lausanne. Olivier Jeannel, malentendant, chef d’entreprise et fondateur d’une startup prometteuse, Pierre Cole, médecin psychiatre aux Hôpitaux Universitaires de Genève, spécialisé dans le monde de la malentendance, Cathy-Jill Barraud, directrice de la fondation IPT-Vaud (Intégration Pour Tous) et Elisabeth Barillé, écrivain-journaliste malentendante viendront ainsi partager leur expérience, leur vécu et leur vision de cette problématique cruciale pour tous les malentendants. Nous vous les présentons ci-dessous. Olivier Jeannel : « deux clés pour réussir : la formation et l’acceptation de son handicap » Âgé de 35 ans, Olivier Jeannel souffre d’une surdité bilatérale sévère depuis son plus jeune âge. Né à Hollywood, diplômé de l’Université de Berkeley, ce franco-américain a réussi un parcours scolaire et professionnel sans faute. Il est en outre le fondateur et créateur de Roger Voice, une application pour smartphones qui permet aux sourds et malentendants de téléphoner. Depuis quand êtes-vous malentendant ? A peu près depuis l’âge de deux ans, des suites d’une fièvre dont l’origine n’est pas connue. Résultat : j’ai aujourd’hui une perte bilatérale profonde de 80%. Mais je suis appareillé depuis l’âge de 3 ans à peu près. Vous êtes né et avez grandi aux Etats-Unis. Quel parcours un malentendant peut-il faire là-bas ? J’ai suivi ma scolarité à l’école publique, en scolarité intégrée comme cela se fait aux Etats-Unis. Cela veut dire que les enfants handicapés sont toujours en école « normale », car on veut favoriser la mixité. Avez-vous bénéficié d’un appui scolaire ? Une orthophoniste m’était assignée. Elle expliquait tout aux profs, et pendant toute la scolarité, elle me suivait une ou deux fois par semaine pour des cours particuliers et m’expliquer ainsi les expressions, les mots que je ne comprenais pas. Elle m’aidait aussi pour certains devoirs de classe, etc. En fait, c’était l’idéal pour moi. Et vous n’avez pas subi de discriminations, de tracasseries ? Oh si, les enfants peuvent être cruels ! Mais personne n’est épargné et on finit par se dire que les enfants sont bêtes et que c’est dommage pour eux. Ça forge le caractère, mais surtout, j’avais la chance d’avoir des amis, des profs attentifs, et de nombreux frères et sœurs. A votre avis, quelle est la plus grande difficulté qui empêche aujourd’hui un sourd ou un malentendant de réussir dans la vie ? Pour moi, le facteur clé, c’est l’éducation. Celle qui encourage la lecture et l’écriture, qui crée des passerelles dans la communication et l’apprentissage du savoir. Quand j’ai appris qu’il y a des taux très bas d’écriture et lecture chez les sourds, cela a été un choc car j’imaginais que ce serait l‘inverse, que les sourds seraient les champions. L’autre facteur, c’est bien entendu les messages envoyés par les parents, les éducateurs et aussi la société en termes d’emploi et d’opportunités. Pour tous les enfants, handicapés ou non, l’accompagnement, l’écoute, le soutien jouent toujours un rôle déterminant. Il faut juste beaucoup plus de patience pour les enfants handicapés. En quoi votre éducation à l’américaine a-t-elle joué un rôle dans la réussite de votre parcours ? Aux USA, on encourage les gens à se prendre en charge, à ne pas dépendre des autres. On donne aux jeunes les outils, les moyens pour apprendre et travailler. Du coup, cela change tout dès le départ, car on se dit « Il va falloir me former !». Par la suite, une fois la scolarité réussie, on a confiance en soi et on est beaucoup plus libre dans ses choix de vie et de carrière. Mais bien entendu, tous les enfants handicapés ne réussissent pas de la même manière. Cela dépend du handicap, de leur état d’esprit… Le degré de handicap joue-t-il un rôle selon vous ? A mon avis, c’est le degré d’adaptation et d’acceptation qui compte, plus que le degré du handicap proprement dit ! Vous arrivez en France en 2002. Comment les choses s’y sont-elles déroulées ? J’ai eu de la chance, je suis venu en France sur invitation de Sciences Po Paris qui ouvrait ses portes aux étrangers, dans le but d’accroitre sa renommée. J’ai ensuite voulu me lancer dans l’entrepreneuriat, mais c’était difficile à l’époque en France. Le choc du monde du travail français m‘a plus amusé que frustré, il y avait encore des gens qui fumaient leur cigarette au bureau en 2006 ! Mais depuis, les choses se sont bien améliorées en matière d’intégration professionnelle des personnes handicapées. Il y a des « missions handicap » dans tous les grands groupes et de plus en plus de personnes handicapées rejoignent les entreprises. Propos recueillis par Charaf Abdessemed [zone]Une application sur mesure pour sourds et malentendants Olivier Jeannel est le fondateur et créateur de Roger Voice, une application smartphone qui permet aux sourds et malentendants de téléphoner. Lancé en 2013, le projet a pu devenir une réalité grâce au crowdfunding qui lui a permis de lever quelques dizaines de milliers de francs et de lancer l’application. Roger Voice est une application que l’on télécharge sur son smartphone, comme Skype ou Viber, etc. L’utilisateur sourd ou malentendant lance son appel et dès que l’interlocuteur répond, sa parole est retranscrite automatiquement et instantanément sur l’écran du téléphone. La conversation est donc littéralement lue et la personne sourde ou malentendante peut répondre soit à l’oral, soit également par écrit. « Avec les sms et autres logiciels de messagerie, téléphoner peut paraître « vieux », mais la réalité c’est que nombre de professionnels ne sont joignables que par téléphone , explique Olivier Jeannel, qui a travaillé de longues années dans les télécommunications. C’est comme ça qu’est née l’idée de Roger Voice, disponible d’ailleurs en plusieurs langues » . Aujourd’hui, l’application connaît un véritable succès : elle a été téléchargée plus de 5500 fois et compte 1300 utilisateurs actifs, avec 200 abonnés qui ont recours au forfait mensuel demandé, allant de 2,5 à 25 francs selon les prestations. L’application est disponible en Suisse.[/zone] Cathy-Jill Barraud : « lever les préjugés pour intégrer les personnes handicapées » Directrice de la Fondation IPT Vaud (Intégration pour tous) , Cathy-Jill Barraud œuvre depuis de nombreuses années à l’intégration professionnelle des personnes souffrant d’un handicap. Le crédo de son institution ? Travailler avec « la culture du possible ». Est-il plus difficile pour une personne souffrant dans sa santé de réussir son intégration professionnelle ? Oui, forcément, car il est évident que ceux qui souffrent d’un handicap doivent toujours consentir un effort supplémentaire ! Quel est votre objectif, avec ce type de public ? Chez IPT Vaud, la moyenne d’âge des personnes que nous prenons en charge est de 40-45 ans, et souvent en situation de reconversion professionnelle en raison d’un handicap ou d’un problème de santé. Notre crédo, c’est d’essayer de travailler sur ce qu’on appelle la « culture du possible », c’est-à-dire, quoi qu’il arrive, de regarder les ressources de la personne pour travailler avec elle sur ce qu’il est possible de faire. Souvent, dans le cadre d’une réinsertion professionnelle liée au handicap, il s’agit pour nous, quand c’est possible bien sûr, d’aider la personne à trouver un nouvel environnement où le handicap ne pose pas de problème. Vous traitez donc chaque cas de manière particulière ? Absolument. Chaque personne a son parcours, ses particularités, ses ressources, ses difficultés, etc. Parfois, des personnes qui ont des profils similaires ne vont pas se comporter de la même manière dans leur démarche de réinsertion. Quel est selon vous le paramètre le plus important pour réussir une intégration professionnelle ? Sans conteste, le degré de motivation de la personne, un critère qui selon moi passe même avant le degré de limitation de sa santé ou de ses capacités. La qualité et l’implication de l’environnement familial jouent également un rôle. Au final, certaines personnes handicapées parviennent à fonctionner avec leurs limites et savent se faire apprécier au travail. D’autres malgré un handicap moins important, ont plus de mal à avancer, et cumulent des problématiques diverses dont le trouble auditif fait aussi parti. Souvent, il peut également y avoir une composante psychique qui complique l’insertion professionnelle. Que faites-vous dans ce cas ? Notre mission n’est pas une mission de soin. Néanmoins, nous avons une psychologue qui gère un module de gestion du changement, qui permet entre autres, de travailler sur les émotions et d’essayer de développer une autre attitude vis à vis de son handicap. Qu’est-ce qu’une stratégie d’insertion réussie selon vous ? C’est à la personne elle-même d’identifier où elle en est, et où elle désire aller. Ensuite, nous voyons comment faire ce travail ensemble. Ainsi, même si nous rencontrons beaucoup d’attentes, notre rôle est de soutenir la personne dans sa démarche d’intégration, avec notre réseau d’entreprises, notre connaissance du marché du travail, etc. Mais l’essentiel du travail revient à la personne elle-même, bien sûr. Comment se comporte le marché du travail vis-à-vis de la question du handicap ? Je dirais que le marché du travail est plutôt ouvert, et je sens même une certaine bienveillance par rapport à cette question ! Bien sûr, certaines entreprises ne peuvent s’adapter pour accueillir tous les profils de handicap et il faut comprendre leur réalité, même s’il est vrai que parfois, la méconnaissance du handicap peut leur faire peur. C’est notre travail d’accompagner aussi bien les personnes en intégration que les entreprises à mieux se connaître pour lever les craintes. Les stages que nous proposons sont d’ailleurs un outil très précieux pour cela. Et cela se passe-t-il bien ? Oui, car en général et quels que soient les soucis de santé, si la personne parvient à faire correctement son travail, il n’y plus de problème. Le handicap peut même d’ailleurs parfois être un avantage. Je me rappelle d’une personne sourde que nous avions placée à la Poste et qui était hyper-efficace dans son travail car elle n’était pas sans cesse dérangée par le bruit. Quand elle a quitté son travail, la Poste nous a appelés pour nous informer qu’elle pouvait réserver ce poste à une nouvelle personne souffrant du même handicap ! Y a-t-il une spécificité du handicap auditif dans l’intégration professionnelle ? Souvent, les personnes sourdes ou malentendantes ont le sentiment d’être mises de côté, en raison de l’incompréhension qui peut régner entre les deux mondes. Et c’est normal, car il s’agit d’un handicap qui touche avant tout à la communication. Quel conseil donneriez-vous à un malentendant en recherche d’emploi ? Celui que je donne à tout le monde : ne pas envoyer de CV, mais aller sur place pour se présenter. Il n’y a pas de meilleure manière de lever les préjugés que de rencontrer une personne ! Propos recueillis par Charaf Abdessemed [zone]Plus de 40 ans au service de l’intégration professionnelle Une intégration réussie sur le marché de l’emploi profite non seulement à la personne qui retrouve l’estime d’elle-même, une place dans la société et un revenu, mais également à l’entreprise qui recrute une force de travail compétente et, plus largement, à la société qui renforce ainsi sa cohésion et progresse dans l’esprit de solidarité, tout en diminuant ses charges sociales. Fondée en 1972 sous l’impulsion d’entrepreneurs visionnaires, IPT est l'un des pionniers et spécialistes de la réinsertion professionnelle des personnes en difficulté face au marché du travail ou atteintes dans leur santé. D’utilité publique et sans but lucratif, cette fondation privée est active sur le plan national. Chaque année, quelque 2’500 personnes sont ainsi accompagnées dans une prise en charge individualisée vers un retour à l’emploi rapide et durable. [/zone] Pierre Cole : « la surdité est une maladie de la communication » Le docteur Pierre Cole interviendra lors de la Journée à Thème du 11 juin prochain. Entretien avec un psychiatre qui a développé une véritable expertise sur la déficience auditive et pour lequel il n’y a pas de « spécificité psychiatrique » liée à la surdité. Comment en êtes-vous venu, en tant que psychiatre, à vous intéresser aux problèmes liés à la déficience auditive ? Quand j’étais étudiant en médecine, on m’a demandé de m’intéresser à la reconnaissance musicale et faciale des émotions chez les personnes implantées cochléaires. Cela m’a permis de voir que les troubles auditifs étaient un sujet peu étudié en psychiatrie. Ce qui m’a frappé à ce moment-là, c’est que l’audition touche intimement à la question de la communication. Or cette dernière est au centre de mon travail en tant que psychiatre… Quelles sont les difficultés que rencontrent les malentendants dans leurs parcours social et professionnels ? Il n’y a pas de réponse unique. Car en fait, les difficultés interviennent en fonction de la manière dont les personnes sont atteintes et en fonction du type de surdité dont elles souffrent. Selon que les surdités soient progressives, ou qu’elles surviennent brusquement, selon qu’elles aient une cause décelable ou qu’elles surviennent en lien avec un évènement traumatique, ou encore qu’elles s’inscrivent dans une composante familiale, l’impact ne sera évidemment pas le même. De fait, une multitude de facteurs interviennent dans les difficultés que les malentendants peuvent rencontrer. Peut-on identifier cependant des points communs dans les difficultés rencontrées ? Oui : les questions liées à la communication, celles liées au deuil que l’on doit faire quant à un certain nombre d’activités sociales sont bien sûr des points communs. Vous soignez de nombreux malentendants et sourds dans votre consultation. Sont-ils plus vulnérables à certaines maladies que les normo-entendants ? A mon avis, le fait d’être malentendant n’est pas quelque chose de spécifique et on retrouve pour les malentendants les mêmes problématiques que pour les personnes entendantes. C’est un point de vue personnel, car la question de la spécificité des psychopathologies liées à la surdité agite de longue date le monde académique. Y a-t-il des pathologiques plus fréquentes chez les malentendants ? A mon sens non, on retrouve chez eux au premier plan les mêmes pathologies qui affectent la population générale, c’est à dire les troubles de l’humeur dépressifs, les troubles anxieux, les troubles de l’adaptation. Dans le cas des malentendants, la maladie peut néanmoins induire une dépréciation de soi, une vision négative des choses et une focalisation plus importante sur l’impact de l’audition dans la vie de tous les jours. Souvent, ce que l’on interprète chez le malentendant comme étant une dépression ou un repli sur soi n’est en réalité rien d’autre qu’un problème d’adaptation aux difficultés dans la communication. Selon moi, la malentendance est en premier lieu une maladie de la communication, au delà de la vision purement médicalisé du point de vue ORL. L’insertion dans la vie sociale et professionnelle reste une question cruciale à laquelle se heurtent de nombreux malentendants… Bien sûr, il y a un certain nombre de facteurs qui font que leur parcours peut être bien plus compliqué que pour les autres. Mais, et au fond, c’est une question universelle qui nous concerne tous, l’essentiel c’est le regard que l’on peut porter sur son handicap, les difficultés que l’on rencontre, et sur le monde en général. Comme pour tout le monde, il est bien plus facile de se focaliser sur ce que l’on n’a pas, que de voir ce qui est encore possible. La question est donc d’apprendre à tirer partie de son handicap, de mettre en perspective avec humour les difficultés du quotidien, sachant d’ailleurs que chacun d’entre nous a un handicap dans la vie. Ainsi, une de mes collègues qui a des soucis d’audition de longue date, a dû se résoudre à porter un appareil auditif. Elle est arrivée en disant : « j’ai une annonce à vous faire, il y a un nouveau collaborateur dans le service ! » C’était une manière drôle et intelligente d’annoncer la nouvelle, tout en prenant du recul. Quel rôle peut jouer l’entourage dans la vie d’un malentendant ? Bien sûr, le soutien familial permet de mieux vivre les choses, selon que l’entourage tient compte ou pas du handicap de la personne. Et dans certains moments plus difficiles, ce soutien peut même être déterminant. La compréhension, l’humour et un regard décalé au sein d’une famille rendent ainsi une adaptation bien plus facile ! A l’inverse, les choses peuvent beaucoup se compliquer si l’on ressent de l’incompréhension autour de soi. Le degré de perte auditive peut-il être un facteur de pronostic de la future insertion professionnelle d’une personne malentendante ? Selon mon expérience, je n’ai pas le sentiment qu’il y ait un lien entre les deux. D’autant qu’il y a bien d’autres facteurs : la famille bien sûr, mais la vision que le malentendant a de lui-même, les expériences personnelles de rejet qu’il a vécues ou pas. Pour moi, la question fondamentale est de savoir si la personne a réussi à acquérir une identité propre au sein de laquelle elle peut se retrouver. L’enjeu est donc d’apprendre à se situer par rapport aux autres. Encore une fois, c’est une question qui se pose à chacun d’entre nous, et plus particulièrement à ceux qui estiment souffrir d’une différence. Quels conseils pourriez-vous donner afin d’aider un malentendant à accomplir son parcours ? C’est compliqué de donner un conseil (rires) ! Ce qui est important pour celui qui éprouve des difficultés, c’est de travailler à reconstruire la manière dont il voit la vie, mais aussi ses propres faiblesses, ses capacités, ses forces. Lorsqu’on souffre d’un déficit, il y a des choses qu’on ne peut pas changer, comme retrouver son audition, retrouver toutes ses capacités sociales. A l’inverse, il a aussi des choses sur lesquelles on peut agir. Tout l’art est de trouver l’équilibre entre ce que l’on doit accepter et ce que l’on peut changer. D’ailleurs, le trouble auditif peut parfois être une force dans le travail, si on sait l’amener avec humour. Le trouble auditif peut donc être une richesse… Oui, bien sûr, mais c’est à la personne elle-même de trouver ce qui fait cette richesse ! Que vous ont appris les sourds et malentendants ? J’ai pu voir les difficultés qu’ils rencontrent mais aussi l’étendue de leurs ressources et la diversité des manières dont on peut se construire dans notre monde. Ils m’ont montré les capacités qu’a l’humain de changer et de grandir. [zone]Un intérêt ancien pour la déficience auditive Le docteur Pierre Cole est un des rares psychiatres dans le monde francophone à s’être intéressé de près aux questions de surdité. Il est actuellement Chef de clinique aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Dès 2009, il est stagiaire à l’hôpital Sainte-Anne de Paris, au Pôle «Surdité et souffrances psychiques» et obtient ensuite en 2011, à l’Université René Descartes de Paris, un Diplôme d’Université en Surdité et Santé mentale. Il est en outre l’auteur de nombreuses publications scientifiques sur la problématique spécifique de la santé mentale et de la déficience auditive.[/zone] Elisabeth Barillé, « L’oreille d’or » Entendre, mais d’une seule oreille. Ne pas entendre comme il faudrait, donc, à l’école, en société, chez soi, mais entendre autre chose, souvent, entendre mieux, parfois. Dans « L’oreille d’or » un récit intime récemment publié aux éditions Grasset, Elisabeth Barillé évoque son handicap invisible, malédiction et trésor, qui l’isole mais lui accorde aussi le droit d’être absente, le droit à la rêverie, au retrait, à la rétention, voire au refus. « Merci mon oreille morte. En me poussant à fuir tout ce qui fait groupe, la surdité m’a condamnée à l’aventure de la profondeur… » Dans cet émouvant témoignage, la romancière revient sur son parcours de silence : sa vie d’enfant un peu à part, les refuges inventés, les accidents et les rencontres… De l’imperfection subie au « filon d’or pur », Elisabeth Barillé traverse l’histoire littéraire et musicale, dans une réflexion presque spirituelle. Née en 1960 à Paris d’un père français et d’une mère russe, Elisabeth Barillé est l’auteure de plusieurs romans, récits et biographies, parmi lesquels, chez Gallimard, Corps de jeune fille (1986), Exaucez-nous (1999, Prix de la Fondation de France), A ses pieds (2006). Et chez Grasset : Une légende russe (2012) et Un amour à l’aube (2014). SUIVANT PRECEDENT
- De (bonnes) nouvelles de l'AI pour les jeunes en formation | FoRom Ecoute
Retour au Magazine De (bonnes) nouvelles de l'AI pour les jeunes en formation 3 décembre 2016 Publié le : Bonne nouvelle pour les jeunes qui bénéficient de l'AI: dès aujourd’hui, annonce l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la formation professionnelle élémentaire octroyée aux jeunes assurés handicapés par l’assurance-invalidité dure en principe deux ans. Ainsi, l’AI adapte sa pratique à un récent arrêt du Tribunal fédéral. Jusqu’à présent, elle accordait généralement une année de formation, puis une année supplémentaire lorsqu’il apparaissait que la formation avait de bonnes chances de déboucher sur une amélioration des perspectives de travail de l’assuré dans le marché primaire de l’emploi. Étant donné qu’il n’était souvent pas possible de constater à l’issue de ces deux ans une réadaptation ayant une incidence sur la rente, l’AI limitait, dans un premier temps, l’octroi de ces formations à un an et décidait d’une prolongation éventuelle sur la base d’un bilan établi vers la fin de la première année et attestant de bonnes chances de capacités de gain futures sur le marché primaire du travail. Dans ces cas seulement, les formations étaient prolongées d’une deuxième année. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) abroge la lettre circulaire avec effet immédiat. Autrement dit, pour toutes les situations nouvelles ou en cours, le principe est désormais que la formation élémentaire de l’AI et les formations pratiques INSOS durent deux ans. Les conditions d’octroi seront vérifiées pour chaque cas en fonction des considérations de l’arrêt du Tribunal fédéral. SUIVANT PRECEDENT
- Des cellules souches et une imprimante 3D pour fabriquer… une oreille ! | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Des cellules souches et une imprimante 3D pour fabriquer… une oreille ! 12 juillet 2022 Publié le : En juin dernier, une équipe américaine a mis au point et testé la greffe d’un implant d'oreille imprimé à partir de cellules humaines. Un grand espoir pour celles et ceux qui souffrent de malformation congénitale du pavillon. C’est un véritable exploit, encore impensable il y a quelques années. Le mois dernier, une équipe médicale américaine a annoncé avoir pour la première fois, greffé un implant d’oreille humaine. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel implant, puisque la nouvelle oreille a été créée à partir des cellules de la patiente soignée et façonnée à l’aide… d’une imprimante 3D. Cette nouvelle technique s’adresse aux personnes souffrant de microtie, une malformation de naissance qui touche un enfant sur environ 15000 naissances. La microtie est une malformation congénitale de l'oreille externe, observée le plus souvent chez les garçons, survenant de manière sporadique ou héréditaire et qui se caractérise par un pavillon atrophié, et fréquemment associée à une perte auditive. Depuis très longtemps, de multiples techniques chirurgicales ont été développées dans le but de recréer la forme tridimensionnelle complexe du pavillon de l’oreille chez ces patients avec des résultats esthétiques divers. Radicalement nouvelle L’approche développée aux Etats-Unis, encore expérimentale, est radicalement nouvelle, puisqu’il s’agit de réaliser une empreinte 3D de l'autre oreille pleinement développée du patient, puis de collecter des cellules du cartilage de son oreille. Celles-ci sont ensuite mises en culture pour en obtenir une quantité suffisante, avant d’être mélangées à un hydrogel de collagène, utilisé pour imprimer le futur implant, et qui sera ensuite entouré par une coque imprimée et biodégradable destinée à le soutenir. Au fil du temps, l’implant devrait être absorbé par le corps du patient et l'oreille greffée est supposée à terme développer l'aspect et le toucher d'une oreille naturelle. « En tant que médecin ayant traité des milliers d’enfants atteints de microtie à travers le pays et le monde, je suis enthousiasmé par cette technologie et ce qu’elle pourrait signifier pour les patients et leurs familles », a déclaré Arturo Bonilla, chirurgien et fondateur d’un institut spécialisé dans le traitement de cette malformation, à San Antonio, au Texas. A l’avenir, 3DBio, la société à l’origine de cette avancée, souhaite développer des implants pour des formes plus sévères de microtie. Les implants imprimés en 3D pourraient également être utilisés pour d’autres affections impliquant du cartilage, notamment des défauts ou des blessures au nez, des reconstructions mammaires ou un ménisque endommagé au genou. SUIVANT PRECEDENT
- Elvire Egger: « Dédramatiser pour bien vivre » | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Elvire Egger: « Dédramatiser pour bien vivre » 18 juillet 2013 Publié le : Atypique et bien dégourdie, la Jurassienne Elvire Egger l’est certainement ! En première année d’université, cette malentendante de naissance espère devenir un jour climatologue. Ce qui n’empêche pas cette passionnée d’environnement de pratiquer à ses heures perdues… la flûte traversière. Et sans ses appareils, s’il vous plait ! Vous êtes en 1ère année d’université et avez reçu le Prix aux élèves malentendants en juin 2012… J’ai trouvé ça très gentil ! D’ailleurs, j’ai été très surprise quand le Principal m’a annoncé cette nouvelle… Et j’ai aussitôt accepté qu’il en parle publiquement lors de la remise des diplômes, car c’est une belle façon de montrer que ce n’est pas parce qu’on a un problème qu’on ne parvient pas à faire ce qu’on veut ! Depuis quand êtes-vous malentendante ? Depuis la naissance. Très tôt, j’ai montré des difficultés à parler, et ma maman s’est aperçue qu’il y avait un problème, dont on ignore exactement la cause… Peut-être est-ce d’origine génétique, même si je suis la seule dans la famille à être malentendante ! Êtes-vous appareillée ? Oui, bien sûr, j’ai été appareillée très tôt, ce qui m’a permis de suivre une scolarité normale depuis mon plus jeune âge. Avez-vous eu besoin d’une aide quelconque, comme une codeuse-interprète par exemple ? Non, car j’entends bien avec mes appareils. Mais bien sûr, j’ai toujours prévenu mes enseignants, qui veillaient alors à parler fort, à bien articuler… Après l’école obligatoire, j’ai d’ailleurs fait une maturité gymnasiale à la Chaux-de-Fonds. Au fond, la déficience auditive ne m’a posé aucun problème en termes de scolarité. D’ailleurs, je le vis très bien et, le plus souvent, j’oublie même que j’ai des appareils ! A vous entendre, cela a été facile… Je suis consciente que certains ont de la difficulté à s'adapter mais moi je n'en ai pas eu. En fait, cela a été facile de m'adapter car mes parents n'ont jamais dramatisé à propos de mon handicap. Et surtout à l'âge où j'ai été appareillée (école enfantine-première année obligatoire), on ne se rend pas vraiment compte de la différence… Et avec vos amis ? Ils oublient que je suis malentendante (rires) ! Et quand je le leur rappelle, ils sont toujours surpris… Pourtant, quand ils faisaient trop de bruit en classe, je ne me gênais pas pour leur rappeler de se calmer afin que je puisse entendre. Je dis franchement les choses ! Depuis septembre dernier, vous êtes désormais à l’Uni. Comment cela se passe-t-il ? A l’Uni, on est dans l’anonymat, car c’est grand ! Et on prend une claque, car c’est très différent du lycée, et aussi très exigeant au niveau intellectuel. Heureusement, les profs utilisent quasi-systématiquement un micro, donc je n’ai pas de problème pour suivre. En revanche, si j’oublie mes appareils, je n’ai plus qu’à rentrer à la maison ! (rires) Quelles études avez-vous choisies ? Je suis en 1ère année de bachelor environnement, car les questions de durabilité m’ont toujours passionnée. Il est probable que par la suite, je fasse un master à Genève. Mon but, c’est de devenir climatologue. Avec 8 mois de recul, la fac, c’est comment ? Pas facile. Comme pour la plupart des nouveaux étudiants, mes notes sont assez moyennes, mais pour une première expérience, c’est pas mal ! On verra bien par la suite, mais c’est sûr, il faut beaucoup travailler ! Vous reste-t-il du temps pour vous distraire, en dehors des études ? Pas beaucoup ! Mais quand, le week-end, je rentre chez moi dans le Jura, je revois mes amis et je joue de la flûte traversière, que je pratique depuis 8 ans. D’ailleurs, pour jouer, je ne mets jamais mes appareils auditifs, car dans ce cas je n’aime pas le son de ma flûte… Et puis, j’écoute beaucoup de musique, et même si ça surprend par rapport à la flûte traversière, j’adore le rock, le metal… Propos recueillis par Charaf Abdessemed SUIVANT PRECEDENT
- Thomas Betschart : « Lève-toi et marche ! » | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Thomas Betschart : « Lève-toi et marche ! » 15 janvier 2015 Publié le : Né il y a 28 ans à Genève, Thomas Betschart vit depuis 4 ans à Lausanne. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce sourd profond implanté a toujours su ce qu’il voulait, et ne craint pas les difficultés. La preuve ? Il vient de s’installer comme graphiste et graveur indépendant, un audacieux pari sur l’avenir. Depuis combien de temps êtes-vous malentendant ? Je suis sourd profond de naissance, pour une raison inconnue, même si je dis parfois que je suis malentendant, car les gens ne font pas la différence. Êtes-vous appareillé ? Jusqu’à l’âge de 13 ans, j’ai porté des prothèses auditives. Puis, lorsque cette technologie s’est généralisée, on m’a posé un implant cochléaire, ce qui a bien amélioré la situation. Avant cela, j’étais bien moins réactif au bruit. Où avez-vous suivi votre scolarité ? Au début, j’ai fréquenté une école pour sourds, à Genève où je suis né et où j’ai grandi, en même temps que je commençais une école normale, selon le souhait de mes parents. Mes parents ne souhaitaient pas que je sois trop isolé dans un milieu pour sourds. Et comment se sont déroulées vos études ? J’ai bénéficié de la présence d’une codeuse-interprète LPC pour mes cours. Tout s’est donc bien passé la plupart du temps, même si parfois, à l’école, j’étais considéré comme quelqu’un de différent, puisque je ne rentrais pas dans le moule (rires) ! Et qu’avez-vous fait après votre scolarité obligatoire ? Depuis tout petit, je suis passionné de bande dessinée. La bande dessinée m’a d’ailleurs beaucoup apporté dans l’apprentissage des subtilités du français. Alors pour trouver un compromis, j’ai suivi un apprentissage en graphisme, le métier qui me rapprochait le plus de la BD. Cet apprentissage a-t-il été facile ? Oui et non. Là encore, l’apport des codeuses-interprètes a été déterminant. Mais ce qui est difficile, c’est de devoir toujours courir à droite et à gauche pour obtenir les informations dont on a besoin. Et là, la codeuse ne suffit pas, d’autant que mes collègues étudiants ne faisaient pas vraiment preuve d’esprit de solidarité, ce qui est légitime d’ailleurs, dans le sens où c’était à moi de communiquer mes besoins ! Heureusement, en tant que fils unique, j’ai très tôt appris à compter sur moi-même ! Vous obtenez votre diplôme de graphiste en 2005. Que faites-vous ensuite ? J’ai suivi pendant trois ans une autre formation dans une HES à Genève, cette fois en communication visuelle (rires). Ensuite, après avoir suivi de nombreux stages dans des entreprises, qui en général utilisent les stagiaires comme bouche-trous, j’ai fini par décrocher un contrat de graphiste en 2013, dans le canton de Vaud. Ce n’est pas rien, car en Suisse romande, chaque année 80 à 100 nouveaux graphistes arrivent sur le marché! Et comment s’est passée cette première expérience professionnelle ? Bien, si ce n’est qu’au bout de quelques temps, j’ai été licencié, hélas pour des raisons économiques. Ma surdité n’a joué aucun rôle dans ce dénouement. Que faites-vous alors pour rebondir ? J’ai décidé de me mettre à mon compte, comme indépendant. Cela correspond à mon caractère, de ne pas être dirigé, de faire les choses par moi-même et de pouvoir prendre des initiatives. Toute ma vie, qu’elle soit professionnelle ou sociale, j’ai toujours dû prendre des initiatives, pendant que les autres avançaient tranquillement. J’ai interprété cette citation de la Bible, « Lève-toi et marche », comme une invitation à faire les choses par moi-même. Et comment cela se passe-t-il ? Pas mal, même s’il faut beaucoup prospecter. Mais je ne regrette pas et j’entends bien continuer dans cette voie, même si, pour joindre les deux bouts, j’exerce aussi, toujours comme indépendant d’ailleurs, le métier de graveur sur étiquettes. J’ai très tôt appris à faire des compromis ! www.betscharthomas.ch Propos recueillis par Charaf Abdessemed SUIVANT PRECEDENT
- Formateur et formatrice de langue des signes | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Formateur et formatrice de langue des signes 29 septembre 2018 Publié le : Le troisième volet de la formation de formateur/formatrice de langue des signes est en cours. Elle permet de se professionnaliser et d’acquérir les compétences nécessaires. Depuis une trentaine d’années, la Suisse promeut un mouvement de professionnalisation des fonctions de formatrices ou formateurs d’adultes, ainsi que de spécialisation, avec l’apparition d’une offre de formation spécifique pour les formateurs-trices de langues ou en alphabétisation. En partenariat avec la Fédération Suisse des Sourds, l’Unité de formation continue de la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne propose une formation spécifique à l’enseignement de la langue des signes qui permettra au participant-e-s d’obtenir une qualification reconnue. Explications avec le Professeur associé HES, Daniel Lambelet. Le mouvement de professionnalisation et de spécialisation des fonctions de formatrices ou formateurs d’adultes va de pair avec l’acquisition d’un diplôme. « Dans ce contexte, il est important que les professionnel-les qui accompagnent des adultes provenant d’horizons variés dans l’apprentissage de la langue des signes bénéficient également d’une formation continue professionnalisante ». Pour améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d’une perte auditive, les formateurs et formatrices de langue des signes contribuent à les faire accepter et respecter davantage, et à ce qu’elles puissent obtenir l'égalité des droits et des chances, et l’intégration sociale. « Alors que la Fédération Suisse des Sourds défend la langue des signes et sa culture et encourage ainsi la socialisation linguistique bilingue, elle soutient également cette formation et collabore activement ». Les diplômés sont habilités à dispenser des cours de langue des signes pour adultes de manière indépendante, ayant acquis ses bases de la linguistique et sa sociologie et approfondi leurs connaissances de la culture sourde. « Ils apprennent également à communiquer avec des groupes hétérogènes et à consolider leurs compétences de communication avec des participants adultes. « La difficulté que certaines personnes sourdes rencontrent encore à trouver une insertion professionnelle épanouissante, malgré leur qualification, leur engagement au travail, etc est connue. La perspective de pouvoir devenir formatrice ou formateur de langue des signes ouvre pour certaines d’entre elles un horizon stimulant ». Du côté des étudiants, cette formation leur permet de concevoir des modèles de planification, organiser, communiquer, élaborer, donner des cours et les évaluer. Ils sont également en mesure de percevoir les processus complexes des groupes d'étude, de les analyser, d'intervenir de manière adéquate et de soutenir les apprenant-e-s dans leur processus concret de formation et d'apprentissage. Témoignage Noha El Sadawy étudie cette voie et partage ses impressions. Son intérêt porte sur la pédagogie et la linguistique. « Cette formation m'intéresse beaucoup, le contact humain est direct, ce qui nous permet de mieux comprendre et de pouvoir poser des questions sans gêne ». Elle a auparavant suivi diverses formations sur plusieurs années avec l’aide d’un interprète, semées de moments difficiles et d’autres enrichissants. Noha a récemment fait son diplôme de CAS en médiation culturelle auprès de l’ESSP et était la seule personne subissant des déficientes auditives. « Il y a eu des problèmes avec l'AI, qui refusait de payer les frais d'interprétariat pour me permettre de poursuivre mes études. Après trois mois, j'ai dû m’arranger avec les interprètes bénévoles sans lesquels je n’aurais pas pu suivre ces cours, que je continue avec grand intérêt ». Et d’ajouter : « il me paraît important que nous puissions participer aux cours avec les formateurs/formatrices, directement en langue des signes. Nous nous regroupons et échangeons beaucoup ». L'aspect social est enrichi par la découverte de la communauté sourde et malentendante, les enseignants/enseignantes évoquent des exemples liés à elle. « J'encourage l’intégration de cette formation équivalente à celle des étudiants entendants ; il est juste de pouvoir étudier comme eux ». La fondation forom écoute reviendra sur cette formation au terme des examens en 2020 et au moment des prochaines inscriptions. www.eesp.ch © Marc Magnin SUIVANT PRECEDENT
- Mélanie Fernandes Paiva : « Je ne lâche jamais rien ! » | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Mélanie Fernandes Paiva : « Je ne lâche jamais rien ! » 15 janvier 2016 Publié le : Âgée de 18 ans, Suisse et Portugaise, Mélanie Fernandes Paiva est fribourgeoise. Atteinte d’une bilatérale surdité sévère, la jeune femme fait preuve d’une force de caractère impressionnante, malgré de nombreux soucis de santé. Retour sur un étonnant parcours qui la conduit aujourd’hui à devenir assistante en pharmacie. Vous venez de terminer votre scolarité obligatoire, et vous avez reçu, en juin dernier, le Prix aux élèves malentendants décerné par forom écoute… Mais, oui et j’ai trouvé ça vraiment chouette parce que c’est un joli cadeau. C’est une reconnaissance que les autres n’ont pas ! Depuis quand êtes vous malentendante ? En fait, ma surdité est liée à une maladie que j’ai depuis la naissance. A cause d’elle, j’ai une perte auditive sévère liée à un problème d’osselets au niveau des deux oreilles ! Très tôt, mes parents ont découvert que je ne mangeais pas suffisamment et que j’avais de nombreux autres symptômes. Tout cela a conduit à la découverte de la surdité, j’avais 3 ans, et cela a été un vrai choc pour eux. A quel âge avez-vous été appareillé ? Assez tard, vers 5 ans. Quand ma maman me parlait depuis la cuisine, j’allais vers elle, je montais sur une chaise et je lui disais : « Regarde-moi ! ». Là, ils ont compris qu’il fallait faire quelque chose (rires) ! C’est mon caractère : quand j’ai besoin de quelque chose, je le dis clairement ! En tout cas, vous entendez et parlez parfaitement, au point qu’on ne se doute même pas de vos problèmes d’audition… Oui, mais cela n’a pas été facile et il a fallu beaucoup travailler, en particulier avec une logopédiste, pour rattraper le retard de langage que j’avais. Comment s’est déroulée votre scolarité ? Jusqu’à la 3ème Primaire, j’étais dans une école ordinaire, ici à Fribourg. Mais cela a été très difficile pour moi. A cause des tracasseries des autres enfants, mais aussi à cause d’une enseignante qui me discriminait à cause de mon handicap et mes origines, me plaçait au fond de la classe et ne me prêtait aucune attention ! Heureusement, le directeur m’a soutenue, j’ai changé de prof et ça a été bien mieux. Après la 3ème Primaire, vous intégrez l’Institut pour enfants sourds de Fribourg. Pourquoi ? Pendant quelques temps, j’ai suivi en fait les deux écoles, ordinaire et pour sourds. Ensuite en effet, j’intègre complètement l’Institut Saint-Joseph où j’ai d’ailleurs appris parfaitement la langue des signes. En fait, je voulais surtout rencontrer des gens comme moi, capables de me comprendre ! Mais après quelques années, et malgré ce que j’avais enduré dans une école ordinaire, j’ai fini par y retourner quand même ! Ah bon ? Pourquoi cette décision ? Parce qu’à Saint-Joseph, le rythme d’apprentissage était un peu trop lent pour moi, même si tout le reste était très bien. Ensuite, en juin 2015, je termine ma scolarité obligatoire dans une école normale. Et il m’a fallu énormément de travail et de volonté pour ne pas décrocher et obtenir ce résultat, en travaillant tous les soirs pour récupérer ce que j’avais perdu dans la journée à cause de mon audition. Au final avec ce parcours, j’ai vraiment une double culture, de sourds et d’entendants ! N’avez-vous jamais été découragée ? Bien sûr, mais c’est mon caractère, je ne lâche jamais rien. Heureusement, ma famille m’a beaucoup soutenue, mon grand frère pour les devoirs et ma maman, qui à chaque fois me dis toujours : « ce n’est rien, tu va y arriver, tu en es capable ! » Que faites-vous depuis la rentrée du mois de septembre ? Un apprentissage d’assistante en pharmacie, ici à Fribourg. Depuis toute petite, quand j’allais acheter des médicaments, j’ai toujours été attirée par ces dames si accueillantes qui s’occupent si bien des patients ! Cela a t-il été facile de trouver un apprentissage ? Non, alors là vraiment pas du tout ! J’ai envoyé au total plus de 200 lettres pour décrocher quelque chose. Après les 50 premiers refus, j’avais même décidé de faire une année supplémentaire au cycle d’orientation, pour améliorer mes compétences et augmenter mes chances ! Et comment se passe votre apprentissage ? Très bien. Ils m’ont tout de suite dit que mon handicap ne les dérangeait pas et qu’il ne se remarquait d’ailleurs même pas… J’ai de bonnes relations avec mes collègues et ma patronne, et j’ai même des clients sourds qui viennent désormais vers moi pour obtenir leurs médicaments ou des conseils (rires) ! Et puis, en plus de la langue des signes, je parle français, portugais, anglais et j’ai des bases en allemand, ça aide ! Et comment se déroulent vos cours d’apprentissage ? C’est vraiment dur, avec 18 heures de cours par semaine et beaucoup de travail ! Il faut intégrer des mots nouveaux en relation avec le métier, se concentrer sur des enseignants qui parlent 4 heures d’affilée. Non ce n’est vraiment pas facile, c’est très fatiguant, mais je m’accroche. Je l’ai dit, malgré les difficultés, je ne lâche rien, même si je connais mes limites ! Propos recueillis par Charaf Abdessemed SUIVANT PRECEDENT
- Et si l’on parlait de la souffrance psychique des malentendants ? | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Et si l’on parlait de la souffrance psychique des malentendants ? 15 novembre 2014 Publié le : On le subodorait depuis longtemps, mais une vaste étude américaine vient de le prouver : bien plus que les autres, les malentendants sont sujets aux dépressions. En cause, l’isolement et les difficultés de communication qui rendent la vie collective si difficile. « La perte auditive est une très grande souffrance. Mais une souffrance méconnue et pas ou peu reconnue, comme s’il y avait un tabou autour. C’est pour cette raison que je trouve important de témoigner. Car personne ne peut imaginer à quel point les malentendants souffrent ». Pour Ginny Siegrist, malentendante et vice-présidente de forom écoute, cette souffrance est « multifactorielle ». « Tout y concourt, explique-t-elle avec véhémence. Le fait de toujours se battre pour communiquer, les acouphènes souvent insupportables, le si difficile deuil de tant d’activités, la vulnérabilité face aux pannes des appareils auditifs, etc. Alors oui, à la longue, on s’épuise, et il est facile de sombrer dans la déprime, dans un monde qui fait de la performance une valeur cardinale et où les malentendants, surtout les plus âgés, n’ont pas toujours l’impression de trouver leur place ! » Epuisement Cette souffrance, Sara*, âgée d’une vingtaine d’années, l’exprime d’une autre façon, mais de manière tout aussi explicite. Elle qui, après une expérience professionnelle particulièrement éprouvante, dans laquelle on a même pris soin de ne pas tenir compte de son handicap auditif, a fini par craquer. « On tient, on tient, et puis un jour, on n’arrive même plus à se lever, raconte-t-elle. On n’a même plus envie de rien : on est tout simplement épuisé, on se sent nul, plus bon à rien » . Le diagnostic a été immédiat : burn-out. « En fait, nous n’aimons pas montrer que nous sommes différents. Du coup, au lieu que les gens s’adaptent eux aussi à nous, c’est nous qui devons faire tout le boulot, tous les efforts. Alors moi, à la fin de mes journées, j’étais franchement sur les genoux. En plus je me dévalorisais, je me disais tout le temps que je n’aurais jamais de petit ami, à cause de ma surdité. Tout ça était épuisant !!! » Pour emblématiques qu’ils soient, ces témoignages, reflètent-ils une réalité généralisable ? En clair, les malentendants sont-ils plus particulièrement vulnérables face à la dépression ? Et plus précisément : leur souffrance est-elle légitime, eux qui si souvent ont l’impression d’être incompris et d’agacer leur entourage ? A ces deux questions, la réponse est clairement oui. Ainsi, une récente étude américaine, menée à grande et échelle et dont les résultats ont été rendus publics en mars dernier, vient démontrer ce que l’on subodorait depuis longtemps (voir encadré) : pour les chercheurs qui ont mené l’étude, plus de 11% des personnes ayant une déficience auditive se sentaient déprimés, contre simplement 5% chez les personnes dotées d’une parfaite capacité auditive, un écart statistique qui peut sembler faible mais qui, en réalité, est particulièrement concluant. Facteurs multiples Encore très peu étudiés, les facteurs qui expliquent cet état de fait sont multiples. En premier lieu, la difficulté, qu’il s’agisse de malaudition ou de tout autre handicap, d’assumer sa différence vis à vis d’une normalité supposée. « Quand on me parlait, je répondais à côté », se souvient encore Ginny. « Et moi je pensais, en culpabilisant : les gens doivent se dire que je ne suis pas normale ! » Car l’autre facteur explicatif, et cette fois si spécifique au trouble auditif, est que celui-ci touche à ce qui est au cœur de l’humain : l’aptitude à la communication, la capacité à comprendre et à être compris. « La cécité sépare les gens des choses, la surdité les sépare des gens », témoignait ainsi très joliment la célèbre écrivaine américaine Helen Keller, elle-même sourde et aveugle et qui en connaissait un rayon en matière de handicap. « La surdité a énormément joué sur mon isolement », ajoute encore Sara. « Le fait d’être souvent mise à l’écart, ou de suivre les discussions avec un décalage. Alors même avec la meilleure volonté du monde, on baisse les bras, et on se dit à quoi bon, cela ne sert à rien ! » Cercle vicieux S’installe alors, avec le renoncement et le sentiment de ne pas être compris, y compris par le cercle des proches, un cercle vicieux qui peut mener un malentendant à la dépression. Surtout s’il s’y ajoute d’autres vulnérabilités, comme l’âge, l’absence de famille ou de proches, ou encore les difficultés professionnelles, si stressantes. Et puis, au-delà de cet isolement si préjudiciable, d’autres éléments, liés aux troubles auditifs entrent également en ligne de compte. Les vertiges bien sûr, et ces terribles acouphènes qui sans relâche empoisonnent le quotidien de nombre de malentendants, au point de les épuiser (lire notre dossier dans le numéro 56 du magazine aux écoutes ). « En ce qui me concerne, conclut Ginny, les acouphènes ont beaucoup contribué à me fragiliser. Il est vraiment important d’apprendre à vivre avec ses acouphènes et ses problèmes auditifs, sinon on est foutu. Pour ma part, j’ai développé des stratégies pour aller mieux, en faisant beaucoup de promenades en forêt ou en m’investissant dans la vie associative. Et puis la peinture et la photographie m’ont énormément aidée ! ». * prénom fictif. ChA [zone]Une étude aux résultats explicites Publiée aux Etats-Unis en mars dernier dans le célèbre JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery , l’étude, intitulée « Hearing impairment associate with depression in USA adults » a établi un lien clair entre troubles auditifs et dépression. Réalisée dans le cadre d’une enquête nationale sur la santé et la nutrition aux Etats-Unis, portant sur plus de 18'000 adultes représentatifs de la population américaine, elle a abouti à des conclusions très explicites : ainsi, alors que seuls 5% des adultes ayant une capacité auditive excellente se disaient déprimés, cette proportion passait à 7% de ceux qui avaient une « bonne » capacité auditive et 11,4% de ceux qui souffraient d’une déficience auditive importante. En outre, il est clairement apparu que c’est dans le groupe des femmes de plus de 70 ans et atteintes de déficit auditif modéré que la dépression était la plus fréquente, avec un risque quadruplé ! D’ailleurs, tous niveaux de déficience auditive confondus, près de 15% des femmes de tous âges avouaient se sentir déprimées, contre 9% seulement des hommes. Etonnamment, les personnes sourdes qui ont participé à l’enquête semblent épargnées par la dépression, seuls 0,06% d’entre elles admettant en souffrir.[/zone] [zone]Une problématique peu étudiée Faut-il y voir la réelle expression d’un tabou social et médical ? Toujours est-il que la question de la dépression et plus généralement de la santé mentale des personnes souffrant de déficience auditive a été très peu étudiée. Ainsi, en Suisse romande, en dehors du psychiatre Pierre Cole des Hôpitaux Universitaires de Genève (lire l’interview ci-contre), il semble qu’aucun médecin ne se soit penché sur cette question, les services de presse des autres institutions hospitalo-universitaires romandes avouant ne disposer d’aucun expert sur le sujet. Si les ressources semblent un peu plus abondantes ailleurs en Europe ou aux Etats-Unis, la situation n’y est néanmoins guère brillante, très peu d’études sur le sujet étant disponibles, en dehors de quelques études dont l’impact est limité. La première, effectuée au Pays-Bas en 2009 (Ear and Hearin, Lippincott Williams & Wilkins), sous la forme d’un sondage portant sur 1511 personnes âgées de 18 à 70 ans, a établi que le risque de dépression grave augmente de cinq pour cent par dB de perte d'acuité auditive par individu, les jeunes étant plus sévèrement touchés par ce risque que les personnes âgées. L’autre recherche, publiée en 2013 dans le JAMA internal Medicine , a conclu « qu’une diminution de l’audition accélère jusqu’à +41% l’apparition de troubles cognitifs témoignant de l’apparition d’une démence ».[/zone] [zone]« Ce qui est fondamental, c’est de reconnaître la souffrance ! » Chef de clinique aux Hôpitaux Universitaires de Genève, le docteur Pierre Cole est psychiatre, auteur de nombreux travaux consacrés aux rapports entre santé mentale et troubles auditifs. Y-a-t-un lien entre dépression et troubles de l’audition ? Personnellement, j’utiliserais le mot souffrance psychique plutôt que celui de dépression, qui désigne une entité très spécifique. En plus, la notion de souffrance psychique est moins stigmatisante car elle renvoie plutôt à la normalité qu’au pathologique. Dans ce cas, les malentendants éprouvent-ils plus de souffrance que les autres ? C’est certain ! Au quotidien, et en raison de l’isolement et de l’incompréhension qu’ils rencontrent, ils sont plus exposés à des situations qui génèrent de la souffrance. D’autant qu’avec la miniaturisation des appareils auditifs, le handicap auditif devient encore plus invisible ! Mais selon le type de surdité, les situations sont très différentes. Ceux qui souffrent d’une surdité dite pré-linguale (celles survenues avant l’apprentissage du langage, ndlr) et qui utilisent la langue des signes, ne se positionnent pas comme handicapés. Ils ont une culture propre et forment une communauté où rien dans leur environnement ne vient leur rappeler leur déficit. Ils souffrent donc différemment, ils ne doivent cependant pas faire le deuil de l’audition puisqu’ils n’en n’ont pas une perception de manque. En clair, la souffrance est plutôt l’apanage des malentendants ? Disons que la souffrance est différente, mais ceux qui souffrent de surdité post-linguale doivent faire un deuil et donc acquérir un rôle nouveau où tout n’est plus possible de la même manière sans pour autant tout s’interdire. Qu’il s’agisse d’une surdité brusque, avec un deuil très violent, ou d’une surdité d’installation progressive, qu’il faut peu à peu accepter et à laquelle il faut s’adapter au quotidien! Que peut-on faire face à cette souffrance ? D’abord, et c’est fondamental, la reconnaître. Aujourd’hui, on tente parfois de faire comme si elle n’existait pas. Or pouvoir entendre cette souffrance, la reconnaître et la normaliser, cela permet à la personne de pouvoir évoluer dans son processus de deuil. Pourquoi la souffrance des personnes malentendantes est-elle si peu reconnue ? C’est une vraie question. C’est vrai, elle est peu reconnue, dans la mesure où on ne dispose que de peu de moyens pour accueillir ces personnes ! En général, les difficultés des malentendants restent cantonnées à l’ORL, qui très souvent, considère qu’une fois la personne appareillée, le problème est réglé ! Dans leur prise en charge, il serait bon que l’on pense à leur dire qu’on a le droit et qu’il est normal d’être mal et de souffrir en raison des problèmes auditifs. Car la clé est là : un malentendant doit comprendre que sa souffrance est normale, mais qu’il existe des solutions pour mieux la vivre. Que peut-on faire de plus pour moins souffrir ? Comprendre qu’on peut faire face à une perte, mais que l’on n’a pas pour autant tout perdu ! Les troubles auditifs empêchent ou compliquent certaines choses, c’est incontestable, mais ils n’empêchent pas tout. Par exemple, il n’y aucune raison de renoncer à la piscine, alors que de nombreux malentendants le font. L’enjeu, c’est de se construire un nouvel espace dans lequel on peut évoluer, moyennant un certain nombre d’aménagements. Ce n’est bien sûr pas facile, mais c’est faisable ! A partir de quand faut-il avoir recours à l’aide d’un spécialiste ? En tant que psychiatre, tout mon travail est de normaliser le plus possible la souffrance de chaque individu dans ce qu’il peut vivre. Mais lorsque la tristesse est intense, que l’isolement est important et que l’on commence à avoir des idées de mort, il faut consulter. Propos recueillis par Charaf Abdessemed[/zone] [zone]Si proches et si lointains… En matière de reconnaissance de la souffrance psychique éprouvée par les personnes souffrant de troubles auditifs, nul doute que les proches des malentendants sont au premier plan. Car c’est avec eux que la question de la communication et de son altération se pose en premier. En outre, c’est bel et bien au sein du cercle familial que les premiers signes d’isolement de la personne malentendante se font sentir. « Avec les proches, le dialogue est très important », observe le docteur Pierre Cole. « Mais il doit se faire dans le respect d’une certaine temporalité du processus de deuil que traverse la personne malentendante, car souvent, les proches, consciemment ou pas, ne veulent pas voir le handicap qui s’installe, trop lourd. Et souvent, il n’est pas rare qu’ils tentent de forcer ce processus de deuil». Un processus destiné à mener le malentendant du déni vers l’acceptation de sa perte auditive, mais qui peut être parfois très long et durer de longues années. Avec, dans l’intervalle, son lot d’incompréhension, de lassitude et parfois d’agressivité exprimés de part et d’autres. De fait, il existe également, en écho à celle des malentendants, une souffrance au sein des familles, qui elle également, est rarement entendue ou reconnue.[/zone] SUIVANT PRECEDENT
- Lausanne : Conviviale journée des amicales romandes… | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Lausanne : Conviviale journée des amicales romandes… 15 septembre 2014 Publié le : Quand le truculent Richard Vuille, président de l’Amicale des sourds et malentendants de Lausanne organise un événement, on peut être sûr que c’est dans la bonne humeur et la convivialité. Inutile donc de préciser que les amicaliens qui se sont retrouvés le 13 septembre dernier, pour la traditionnelle rencontre annuelle des amicales romandes, ont passé une journée exceptionnelle. C’est à un double événement que les malentendants ont été conviés, en ce samedi 13 septembre. D’abord, la traditionnelle rencontre annuelle des amicales romandes, mais aussi le 90ème anniversaire de l’Amicale des sourds et malentendants de Lausanne et environs, fondée le… 22 janvier 1924 ! « C’est un plaisir de fêter à la fois notre anniversaire et d’accueillir nos amis des autres amicales » , se réjouit le truculent président de l’amicale lausannoise, Richard Vuille, d’excellente humeur comme à son habitude. « 90 ans, c’est tout de même quelque chose pour une association, qui est avec celle de Genève, la plus vieille des amicales romandes de malentendants. Et dans ce cadre, pour nous, ce qui compte avant tout, c’est le partage et la convivialité ! » [caption id="attachment_1372" align="alignnone" width="300"] Le Municipal Lausannois Marc Vuilleumier, Michèle Bruttin et Richard Vuille[/caption] Partage et convivialité ont incontestablement été au rendez-vous dès 9h15 à la salle des cantons de la gare CFF de Lausanne, puisqu’une bonne centaine d’amicaliens en provenance d’un peu partout (Fribourg, Jura, la Chaux-de-Fonds, Morges, Genève, mais aussi Pontarlier en France voisine) se sont retrouvés autour d’un sympathique café-croissant d’accueil. Après l’allocution de bienvenue prononcée par Richard Vuille, qui a tenu à rendre hommage à la présence d’André Capt, doyen, du haut de ses 95 printemps, de l’amicale de Lausanne, ce fut ensuite au tour du Municipal Marc Vuilleumier, au nom de la Ville de Lausanne, de prendre la parole. « Faire des ponts entre les différences » « Faire des ponts entre les différences, telle est la vocation des associations », a ainsi lancé le magistrat. « Entre jeunes et moins jeunes, entre pauvres et moins pauvres, mais aussi entre handicapés et valides, car les associations participent à une politique générale d’intégration qui permet d’apprendre à vivre ensemble et à nous connaître malgré nos différences ! » [caption id="attachment_1371" align="alignnone" width="225"] Andre Capt, le doyen[/caption] Un souci de l’autre qui a conduit l’édile à rendre un hommage appuyé à la présence des Jurassiens français de Pontarlier, qui lui ont répondu par une très belle ovation. Il faut dire aussi que Marc Vuilleumier, et il a tenu à le rappeler publiquement, est également particulièrement sensible à la question du handicap, lui qui souffre notoirement d’un gros problème de vue. Ce fut ensuite au tour de Michèle Bruttin, présidente de forom écoute, de rendre hommage aux amicaliens et de remercier Richard Vuille pour son accueil exceptionnel et la qualité de l’organisation de la journée de rencontre. Car en dépit de sa bonhomie, Richard Vuille, ancien sergent tout de même, a fait preuve, d’ailleurs brillamment secondé par sa très vigilante vice-présidente, d’un sens de l’organisation quasi-militaire, le déroulé de la journée étant minutieusement minuté. « Vous savez, avoue-t-il sur le ton de la confidence, organiser tout cela va assez vite : trouver une salle, des moyens de transport, etc. Ce qui est plus long et plus délicat au fond, c’est d’acheminer l’information auprès de tous les membres et de collecter leurs réponses ! » Veuf depuis quelques années, sans frères ni sœurs, l’homme qui déborde d’enthousiasme, donne de son temps avec beaucoup de générosité : « je n’ai plus de famille et mes amicaliens, sont donc un peu mes chéris ! Il est tout à fait normal que je leur rende ce qu’ils me donnent ». Une fois la partie officielle terminée, les invités se sont rendus en bus spécial des transports lausannois (Richard Vuille est un ancien de la maison !), jusqu’au restaurant du Port de Paudex. « Au départ, nous avions pensé nous y rendre tous en bateau depuis Ouchy » , explique le président de l’amicale de Lausanne. « Mais en raison des incertitudes liées au temps, en cet été plus que maussade, nous avons privilégié l’option du bus » . Port de Paudex Après un magnifique apéritif partagé dans la bonne humeur sur la terrasse du restaurant, les convives se sont retrouvés autour d’un succulent repas avec au menu, excusez du peu, saladine de rucola et artichauts aux éclats de Parmesan et suprême de poularde au thym et limoncello. Le reste de l’après midi a été consacré à une très agréable déambulation le long des berges du lac, permettant aux amicaliens, dont certains ne s’étaient pas rencontrés depuis une bonne année, de prendre des nouvelles les uns des autres. Avant de se quitter non sans se donner rendez-vous l’année prochaine, les invités ont reçu un petit cornet-souvenir, comportant non seulement des prospectus offerts par l’Office du tourisme de Lausanne, mais aussi un très sympathique message d’espoir de Richard Vuille retraçant l’extraordinaire avancée de la technologie en matière d’aide auditive depuis la fondation de l’amicale en 1924. Cerise sur le gateau, chaque convive a également reçu en souvenir de la journée, un superbe porte-clés – en série limitée - estampillé de la cathédrale de Lausanne. Une jolie manière de donner rendez-vous à tous dans 10 ans, pour le centenaire d’une belle amicale ! ChA SUIVANT PRECEDENT
- Et si le Covid-19 s’attaquait à l’audition ? | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Et si le Covid-19 s’attaquait à l’audition ? 21 août 2020 Publié le : Le Covid-19 pourrait s’attaquer aux cellules cochléaires des personnes infectées, même asymptomatiques. Une étude égyptienne menée sur vingt personnes et publiée en juin dernier semble l’indiquer. On le savait, et c’est même devenu un des principaux signaux d’alerte. L’infection par le coronavirus Covid-19 se traduit entre autres symptômes, par une perte d’odorat. Cette anosmie, réversible, est également souvent accompagnée d’une perte du sens du goût, dite agueusie. Pendant longtemps en revanche, on a pensé que l’audition des personnes malades était épargnée par le coronavirus, même si on sait de longue date que de nombreux virus sont capables d’altérer les fonctions auditives. Une récente étude égyptienne de l’Université de South Valley tend en tout cas à montrer que le covid-19 pourrait bel et bien impacter l’audition. Selon cette recherche publiée dans l'American Journal of Otolaryngology , ce seraient les cellules ciliés cochléaires qui seraient les cibles privilégiées du coronavirus, qu’il s’agisse de malades ou de personnes asymptomatiques, mais infectées. 20 cas positifs de personnes malades avec toux, maux de gorges etc. ou asymptomatiques ,ont été analysés et comparés à un groupe témoin de personnes non infectées. Afin d’éviter tout biais de détérioration de la capacité auditive liée au vieillissement, les personnes testées étaient toutes âgées de 20 à 50 ans. Performances moins bonnes La capacité auditive des deux groupes de participants à l’étude a ensuite été testée avec un résultat clair, objectivant des performances moins bonnes chez les personnes infectées asymptomatiques ou non, que chez celles du groupe test. « L’infection par le Covid 19 pourrait avoir des effets négatifs sur les cellules ciliées de la cochlée de personnes atteintes, quand bien même elles seraient asymptomatiques, indique Mohamed Wael Mustafa, l'auteur de l'étude du département d'oto-rhino-laryngologie de la faculté de médecine de Qena à l'Université South Valley. Le mécanisme de cet effet est à explorer par des recherches complémentaires » . «Les résultats de la présente étude ont également démontré que l'absence de symptômes majeurs peut masquer un impact inconnu sur les organes sensoriels délicats, comme par exemple la cochlée. » SUIVANT PRECEDENT
- Boucles magnétiques : Une technologie performante mais encore peu répandue | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Boucles magnétiques : Une technologie performante mais encore peu répandue 15 septembre 2010 Publié le : Inventées il y a plus de 50 ans, les boucles magnétiques peuvent améliorer considérablement la vie des malentendants. Pourtant, malgré leur indiscutable intérêt, elles peinent à s’imposer, particulièrement dans les lieux publics de Suisse romande. C’est l’histoire d’une technologie qui existe depuis des lustres, d’une technologie à l’efficacité avérée, mais qui, paradoxalement, peine à s’imposer, en Europe comme en Suisse, même si des progrès notables ont été observés au cours des dernières années. Inventées au milieu du 20e siècle, dans les années 50, les boucles magnétiques, qui peuvent considérablement améliorer la vie quotidienne des malentendants, sont en effet loin d’être exploitées selon leur très prometteur potentiel. Anne Grassi, responsable des boucles à forom écoute, la fondation romande des malentendants, semble avoir l’ébauche d’une explication : « Il s’agit d’une technologie invisible pour un handicap invisible, déplore-t-elle. Cela explique très probablement les difficultés que l’on observe pour favoriser leur implantation sur le terrain ! » Signal utile Mais de quoi s’agit-il exactement ? « Les boucles magnétiques sont vieilles comme Hérode, observe Stéphane Fourreau, audioprothésiste chez Oticon. Leur but est d’améliorer ce que l’on appelle dans le jargon, le rapport signal sur bruit , c'est-à-dire de faciliter la perception du signal utile ». En clair, les boucles ont surtout leur utilité lorsque, dans un espace fermé, un bruit de fond vient « parasiter », le son « utile », celui que les malentendants doivent justement capter. Dès lors, l’installation d’une boucle magnétique répond à un principe relativement simple. A partir de la source sonore que l’on veut privilégier et que l’on relie à un amplificateur, on fait courir un câble auquel on fera effectuer plusieurs boucles, plusieurs spires, tout autour du lieu où l’on souhaite amplifier le signal utile. « C’est tout simplement le principe d’une bobine magnétique, explique encore Stéphane Fourreau. Le signal audio parcourt le câble et selon son intensité et le nombre de spires, va induire un champ magnétique, d’où le nom de boucles à induction magnétique ». La suite est très simple à comprendre : les appareils auditifs dont sont équipés les malentendants agissent ensuite comme des récepteurs et vont capter le champ magnétique produit par la boucle, pour à nouveau le convertir en son audible. Résultat : pour quelques milliers de francs au maximum, il est en effet possible d’améliorer considérablement le confort d’écoute des malentendants. Meilleure compréhension « Dès lors que l’on souffre d’une perte auditive moyenne, les boucles magnétiques sont incontestablement utiles, explique Anne Grassi. Grâce à la boucle, on n’entend que l’interlocuteur, la télévision ou la radio, et rien des bruits de fond. La compréhension est vraiment meilleure, même si cela nécessite un peu d’habitude, car le son de la boucle est légèrement différent. C’est pourquoi je conseille toujours d’augmenter le volume de son appareil pour mieux entendre ». « Lorsque le cinéma Rex a été équipé d’une boucle, se souvient Jean-Michel Péclard, délégué technique à l’AVACAH, l’association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés, les malentendants qui ont pu suivre un film pour la première fois avaient les larmes aux yeux. C’était très émouvant ! » Tout serait donc parfait dans le meilleur des mondes possibles, si la pose et l’utilisation des boucles, pour simples qu’elles soient, ne nécessitaient pas une certaine rigueur. « Ceux qui posent les boucles n’ont parfois pas toujours tout compris, s’esclaffe Simone Jeannet, malentendante, membre de la commission « Boucles magnétiques » de forom écoute, et présidente de l’AMALCO, l’association des malentendants de la Côte. J’ai le souvenir d’un installateur qui avait branché des micros d’ambiance sur la boucle, ce qui va à l’encontre même du principe de base qui consiste à privilégier le son utile ! Une autre fois, on avait purement et simplement oublié de brancher… l’amplificateur ! » Astuces Autre problème : souvent, les audioprothésistes ne pensent pas à informer leurs patients de l’existence, sur leur appareil, de la fameuse position T, qui permet de se brancher sur la boucle. « Il arrive que nous ayons des doléances de la part de personnes malentendantes, remarque un installateur genevois. Lorsque l’on contrôle la boucle, on constate qu’elle fonctionne très bien, mais que les gens oublient simplement d’enclencher leur appareil en position T. » « Une fois, une dame s’est installée sur une chaise posée sur le câble lui-même, se souvient Adel Hamdan, audioprothésiste à Genève. Elle était assise dans la zone où l’intensité du champ magnétique était maximale. Elle n’était évidemment pas contente car le son qu’elle percevait était beaucoup trop fort. En fait, il y a quand même quelques astuces pour savoir se placer par rapport à une boucle magnétique ! » Résultat : « Les malentendants ne doivent pas hésiter à nous approcher pour savoir quels sont les lieux équipés d’une boucle magnétique, et pour se renseigner sur la meilleure manière de les utiliser, invite Anne Grassi de forom écoute. Nous souhaiterions qu’ils nous signalent les lieux encore à équiper et même qu’il y ait des personnes qui collaborent avec nous pour tester les boucles ! » Autre précision : jadis répandues dans les domiciles, les boucles magnétiques y ont perdu toute raison d’être. « Il y a encore une quinzaine d’années, j’installais énormément de boucles dans les domiciles des personnes malentendantes. Aujourd’hui, je n’ai plus aucune demande. Avec les avancées technologiques et les nouveaux appareils, les gens n’en ont plus besoin chez eux, constate un installateur établi à Neuchâtel ». « En revanche, tient-il à préciser, il est évident que les boucles ont un bel avenir devant elles dans tous les lieux publics ! » Loi fédérale « Bizarrement, c’est une technologie qui n’a jamais réussi à vraiment s’imposer dans les espaces publics, alors qu’elle ne coûte presque rien, fonctionne très bien, et répond aux besoins des utilisateurs, renchérit Stéphane Fourreau, audioprothésiste chez Oticon. Et pour des raisons culturelles, la Suisse alémanique, plus sensible aux questions d’ergonomie, est bien mieux équipée que la Suisse romande ! » Ce retard, qui peut aussi être imputé aux traditionnelles réticences des personnes malentendantes à assumer leur handicap et à revendiquer des installations appropriées, pourrait tout à fait se résorber dans les années à venir. Depuis 2004 en effet, la Suisse s’est dotée d’une loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées, (LHand) qui a clairement fait avancer la problématique. En outre, les nouvelles normes en vigueur depuis janvier 2009, imposent l’installation systématique de boucles magnétiques en cas d’érection de nouvelles constructions et même de mise en rénovation d’anciens bâtiments. « Toute salle publique de plus de 80 m2 doit aujourd’hui obligatoirement être équipée d’une boucle magnétique, commente Jean-Michel Péclard, de l’AVACAH. C’est une avancée considérable, car cela permet à notre association de formuler des oppositions lorsque ces normes ne sont pas respectées ! » Vieux bâtiments Seul bémol : les bâtiments anciens qui ne prévoient pas de rénovation - et ils sont nombreux en Suisse -, ne sont pas concernés par l’étendue de la nouvelle législation en vigueur, et il n’y a dans ce cas aucune obligation légale à équiper le site de boucles magnétiques. La démarche est laissée… au bon vouloir des propriétaires des lieux, qui parfois peuvent faire preuve de mauvaise volonté. « Nous rencontrons encore beaucoup de résistances, témoigne Jean-Michel Péclard. Dans un grand cinéma lausannois par exemple, nous n’avons aucun moyen de pression sur la direction, car il n’y a aucune demande de mise à l’enquête pour ce lieu. Résultat : le dossier n’avance pas depuis des années, et la situation ne risque pas d’évoluer avant un bon moment ! » Charaf Abdessemed [zone]forom écoute s’engage Depuis de nombreuses années, forom écoute s’engage activement dans la promotion des boucles magnétiques, en contribuant, jusqu’à concurrence de 1000 francs, au financement de leur acquisition et de leur installation. La fondation tient également à jour une liste non exhaustive (disponible sur le site www.ecoute.ch ), de l’ensemble des sites de Suisse romande équipés de cette technologie. Enfin, une brochure très complète intitulée « Boucles magnétiques, où les trouver, leur utilisation, leur maintenance » a été éditée et est disponible sur demande.[/zone] SUIVANT PRECEDENT
- Une professionnelle engagée au service de la perte auditive | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Une professionnelle engagée au service de la perte auditive 14 mai 2018 Publié le : Peu visible, la malentendance nécessite un accompagnement destiné à la personne touchée par ce déficit ou à ses proches. Rencontre avec la psychologue spécialiste en Psychothérapie FSP/ACP, Corinne Béran, spécialisée en surdité, LSF, LPC. Corinne Béran nous explique, à travers ces lignes, l’importance du coaching des personnes présentant cette différence à peine perceptible et déplore la pénurie de psychiatres spécialisés en surdité. Portrait d’une femme très engagée, humaniste, qui exerce sa profession depuis une quinzaine d’années, parce qu’elle était attirée par le monde de la communication autre que par la parole, au moment de ses études de psychologie. « Vu de l’extérieur, cela semble étrange de communiquer « sans rien dire », uniquement par des gestes. Le travail de la comédienne française Emmanuelle Laborit, sourde de naissance qui a reçu le Molière de la révélation théâtrale pour son rôle dans « Les enfants du silence » m’a réellement interpelé, au point de vouloir appréhender ce phénomène », explique Corinne Béran. Une méthode emphatique et individuelle Basé sur la méthode rogérienne du psychologue Carl Rogers, qui met l’accent sur la qualité de la relation entre le patient et le thérapeute agissant avec empathie, adéquation et considération positive inconditionnelle, le travail de la thérapeute consiste à accompagner individuellement des personnes sourdes, malentendantes et leurs proches, la plupart adultes. Les suivis abordent régulièrement des thématiques comme la honte, le déni, l’isolement, le besoin de s’identifier, le besoin de reconnaissance, l’acceptation de la réalité, la reconnaissance de ses limites, des barrières à faire tomber. « A posteriori, la malentandance étant à l’ordinaire inapparente, certaines personnes restent dans une attitude de déni et font illusion. Leur entourage peut croire en une normalité retrouvée à travers l’appareillage et l’oralisation. Un jour, malheureusement, lorsque les limites sont atteintes, accompagnées d’une lancinante fatigue, ils craquent parfois». Interaction Corinne Béran effectue des entretiens dans son cabinet privé lausannois avec comme support le Langage Parlé Complété, LPC, la Langue des Signes, LSF, des boucles magnétiques portables ou sans soutien à la communication. La vaudoise, âgée de 46 ans, a acquis une connaissance approfondie du réseau spécialisé en surdité professionnel et associatif. Elle collabore régulièrement avec le Service d’Aide à l’Intégration, SAI, le Service Itinérant Surdité, SIS, Pro Infirmis, Le Repuis et l’Assurance Invalidité, l’OAI. « Le financement de mon travail varie d’une personne à l’autre : l’assurance maladie complémentaire, par la personne elle-même, lors de réinsertion professionnelle l’OAI peut intervenir et finalement Pro Infirmis.». Chaque patient est différent, l’approche est personnalisée et individuelle Diplômée de l’Université de Lausanne et Genève en psychologie en 1997, Corinne Béran obtient le titre de Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP en 2015. Depuis, elle participe régulièrement à des groupes d‘Intervision en psychothérapie centrée sur la personne, d’Intervision entre psychologues travaillant dans le domaine de la surdité. Dernièrement, elle a suivi une formation sur « L’utilité de la psychopathologie pour la prise en charge thérapeutique des demandeurs d’asile - Psychose, traumatisme, dissociation et culture », organisée par l’association Appartenances. « Je suis actuellement une formation sur la Psychothérapie sensori-motrice, IRPT. C’est une approche sensorimotrice pour accompagner les personnes traumatisées ou présentant des troubles de l’attachement. Les traumas s’expriment parfois par des maladies psychosomatiques ou des réactions physiques, majeures ou plus minimes. L’objectif de cette approche thérapeutique consiste à prendre conscience de soi et de comment réagit son corps et de développer de nouveau comportement, aptitude, en travaillant le traumatisme. » Entre 1996 et 2002, la psychothérapeute a participé au cours de LSF auprès de la Fédération Suisse des Sourds et de 2004 et 2007 au cycle d’études avancées « Surdité » auprès de la haute école pédagogique, HEP. « Je participe régulièrement à des formations dans le domaine de la surdité, week-ends de formation en LPC, niveau moyen, et aux Journées de formation organisées par le Groupement romand des professionnels de la surdité, GRPS ou la Fédération suisse des sourds, FSS depuis 14 ans ». Elle a par ailleurs travaillé comme éducatrice spécialisée au Centre Jeunes Sourds à Lausanne entre 2003-2007. Suivi bifocal Corinne Béran propose également un suivi bifocal pour les parents d’enfants sourds. « Durant la période de périnatalité, nous accueillons, avec la doctoresse Hélène Veuthey, psychiatre psychothérapeute FMH, spécialisée en périnatalité, des couples en détresse qui ont besoin d’un accompagnement spécialisé en surdité, mais également en périnatalité ». Les personnes qui s’adressent à mon cabinet sont en lien avec une situation de surdité, soit des personnes sourdes de naissance, malentendantes, devenues sourdes ou présentant une perte soudaine de l’audition et parfois également des parents d’enfants sourds. Les demandes sont de tout type. Accompagnements dans le processus d’implantation cochléaire, mesure de réinsertion professionnelle, acceptation et gestion du handicap, demande de soutien suite à une dépression, un deuil, une migration, etc ». Son cabinet accueille des patients principalement domiciliés dans le canton de Vaud, mais également dans les cantons de Fribourg et Valais et parfois du Jura, Neuchâtel et Berne. Où sont les psychiatres et la relève ? En Suisse romande, on compte sur les doigts d’une main les psychothérapeutes spécialisés en surdité. Les cabinets de psychiatres connaissant ce domaine, dont les frais seraient pris en charge, n’existent pas encore. Alors qui prendra la relève ? « Il n’existe que très peu de spécialistes en surdité et le grand problème réside dans le financement. Les autorités compétentes font « la sourde oreille ». Cette problématique concerne la prise en charge de la santé en général des personnes sourdes et pas seulement de la santé mentale. « Je pense que le bon fonctionnement de certains services mis en place, comme Le Repuis, centre de formation professionnelle et sociale vaudois, est dépendant de la volonté de la Direction des centres de formation spécialisés d'engager et de former des collaborateurs avec des compétences spécifiques en lien avec les différentes surdités. Mais si ces professionnels formés quittent leur poste pour une raison ou pour une autre, que se passera-t-il ? Aucun engagement politique n’assure la pérennité de telles démarches ». Implications dans le réseau Impliquée depuis 2003, Corinne Béran participe à différentes activités associatives. Elle est membre du comité du GRPS, depuis 2015 et a repris la fonction de présidente l’année passée, elle a encadré pendant 2 ans une psychologue stagiaire, participe aux réunions entre professionnels de la surdité et a contribué à l’organisation de séminaires de formation à la surdité des collaborateurs de l’OAI de Vevey. Corinne Béran sera prochainement l’animatrice de groupes de paroles pour personnes malentendantes. Groupes de paroles pour les personnes malentendantes En collaboration avec forom écoute, avec qui elle est en lien depuis plusieurs années, Corinne Béran crée des groupes de parole pour personnes malentendantes à venir tout prochainement. « Je souhaite, à travers ce projet, leur permettre de créer des liens, de se sentir moins seul, de profiter de l’expérience de chacun pour trouver des solutions respectueuses de leurs limites ». Subventionnées en partie par l’OFAS, ces rencontres auront lieu dans son cabinet Boulevard de Grancy et les inscriptions s’effectuent directement sur le site de forom écoute. Au vu du nombre de personnes à l’AI qui paraissent intéressées, deux groupes devraient démarrer de manière bimensuelle les lundis et mardis (voir encadré ci-contre). [border-around color="blue"]Groupe de paroles pour personnes malentendantes Les rencontres bimensuelles, animées par la psychologue spécialiste en Psychothérapie FSP/ACP, Corinne Béran, spécialisée en surdité, LSF, LPC, devraient démarrer dès la rentrée 2018. Mardi 4 septembre 2018 entre 18h et 19h30, Lundi 10 septembre 2018 entre 14h et 15h30. Maximum 7 personnes par groupe. Bld de Grancy 1, 1006 Lausanne Les inscriptions s’effectuent sur www.ecoute.ch , sous la rubrique CONTACT.[/border-around] SUIVANT PRECEDENT
- Une course pour faire parler de la malentendance | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Une course pour faire parler de la malentendance 19 septembre 2018 Publié le : Pour sa 29ème édition, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, qui se déroulera du 15 au 30 mars 2019, verra une équipe suisse concourir, dont le but est de promouvoir la malentendance et la surdité. Depuis 1990 déjà, Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est réservé à la gente féminine de 18 à 71 ans, qui parcourt le pays durant neuf jours. Le concept de cette compétition automobile a pour objectif la tolérance, la solidarité et la persévérance. Ni vitesse, ni GPS n’entrent en ligne de compte ; la navigation à l’ancienne uniquement hors-piste est privilégiée. A travers l’association « Surdigaz’Elles » l’initiatrice du projet, Laure Francesconi, prépare cette course d’arrachepied, actuellement à la recherche de sponsors. Surdigaz’Elles veut médiatiser la malentendance L’objectif principal de Surdigaz’Elles est de faire parler de la malentendance et de la surdité. En aparté de son travail au sein de l’Association Romande des Enseignantes en Lecture Labiale (ARELL), Laure soutient, via des traductions, une personne sourde participant au Rallye Paris-Dakar. « L’idée m’est venue de prendre une personne malentendante comme co-pilote ; c’est évidemment compliqué. Elle devra enlever son appareil et nous préparerons des mots code pour simplifier nos échanges ». Valérie Adatte sera ainsi la première malentendante à participer à la compétition. Agée de 50 ans, elle travaille dans le domaine social depuis de nombreuses années. [caption id="attachment_4990" align="alignnone" width="225"] Les pro du pilotage posent fièrement devant le projet qui leur tient à coeur[/caption] Récemment diplômée, elle est assistante socio-éducative et collabore avec la Fondation les Castors, au Foyer de Porrentruy. Ancienne membre du Conseil de fondation de forom écoute, elle endossera son brassard. Atteinte de déficience auditive, elle a subi une opération à l’oreille gauche lui permettant d’entendre à 86%, quant à l’oreille droite, elle atteint seulement 15%. Cela n’empêche pas cette mère de trois enfants de braver certaines contraintes liées à la course et de se lancer sur la route. Au contraire, Valérie est très motivée, sensibilisée également par des situations alarmantes. « En effet, je connais une malentendante qui n’ose pas faire ses courses de peur de déranger les gens qui pourraient l’aider. D’autre part, une collaboratrice a lu un article sur notre projet et a découvert que la lecture labiale existait. C’est un comble de vivre dans ces conditions », s’exclame-t-elle. Recherche de fonds Le projet constitue 100% de bénévolat. Préparation de dossiers, déplacements afin de visiter d’éventuels sponsors, etc. « Au stade actuel, nous devons trouver CHF 40'000.- avant le 31 décembre 2018 pour le réaliser. A contrario, nous devrons reporter la compétition en 2020. Les fonds représentent les investissements pour le véhicule loué par ZZ Automobile groupe SA, la balise de sécurité détectable à 1 mètre (obligatoire), ainsi qu’un stage de 2 jours pour la prise en main du véhicule, un second de 2 jours à Avignon pour apprendre à maîtriser la navigation et un troisième de 2 jours pour la mécanique. Préparation mentale et physique « Outre des activités sportives mi-hebdomadaires, je tente de visualiser la course et m’y projette chaque jour, visite de long en large le site du Rallye, m’inspirant des témoignages et des images que je partage via les réseaux sociaux, et surtout, je concentre mentalement mes capacités pour arriver au bout de la course ». Le Rallye Aïcha des Gazelles est réputé pour la solidarité des équipes. Lorsqu’une d’elles essuie un problème, les autres doivent s’arrêter pour tenter de l'aider, sinon elles sont pénalisées sur le classement final. [caption id="attachment_4991" align="aligncenter" width="225"] Tenue appropriée pour découvrir le matériel en vue de la course[/caption] « Si la peur de l’inconnu est présente, je suis animée par ma participation au service de la malaudition qui dure depuis vingt ans et je me concentre surtout sur les fonds nécessaires à trouver ». Hors-course L’organisation humanitaire Cœur de Gazelles se déplace en caravane médicale itinérante au sud du Maroc depuis 17 ans pour donner accès aux soins aux populations les plus reculées lors de la course, Innovant, du matériel et des informations sur la malentendance et la surdité seront distribués en mars prochain. « Si un ORL ou audioprothésiste pouvait se joindre au voyage, ce serait idéal ». Au-delà de la course, Surdigaz’Elles poursuit ses efforts en Suisse romande afin de créer un fonds d’entraide pour les personnes souffrant d’une déficience auditive (moyens auxiliaires, financement, etc), car la participation de l’AI pour un appareillage est partiel, le problème persiste … Découvrez les moments forts des précédentes éditions sur : www.rallyeaichdesgazelles.com Gazelles TV est présente sur l’opération chaque année, en développant un pool images. Surdigaz’Elles, Sous la Roche Bourquin 24, 2952 Cornol laure.francesconi@arell.ch Compte Poste Délémont : IBAN CH 0900 0000 1507 9250 9 En équivalent : matériel, accessoires, fournitures… Légendes photos: 1 Valérie Adatte à gauche et Laure Fransesconi à droite découvrent un véhicule dédié au Rallye qu’elles loueront auprès de ZZ Automobiles groupe SA 2 Tenue appropriée pour découvrir le matériel en vue de la course 3 Les pro du pilotage posent fièrement devant le projet qui leur tient à coeur SUIVANT PRECEDENT
- France voisine : Journée des amicales à Pontarlier | FoRom Ecoute
Retour au Magazine France voisine : Journée des amicales à Pontarlier 15 juillet 2012 Publié le : Avec ses 400 associations pour 19'000 habitants, Pontarlier en France voisine fait preuve d’un dynamisme social, économique et culturel impressionnant. La Journée des amicales qui s’y est tenue le 23 juin dernier a été une belle occasion pour l’Association des sourds et malentendants de Pontarlier de mieux faire connaître l’exceptionnel patrimoine de sa ville. Chaque année, la Journée des amicales est une occasion unique pour nombre de malentendantes et malentendants de se retrouver pour plusieurs heures sympathiques et conviviales. Après la Chaux-de-Fonds l’année dernière, c’est la charmante petite ville de Pontarlier, en France voisine, qui a relevé le défi d’organiser et de mettre en place une journée particulièrement réussie. Le 23 juin dernier, une soixantaine de malentendants, en provenance de plusieurs amicales s’y sont en effet retrouvés dès 9 heures du matin sous un soleil radieux. « J’ai été invitée à la Chaux-de-Fonds l’an passé, raconte Pascale Roussillon, présidente de l’Association des sourds et malentendants de Pontarlier depuis quatre ans. C’est à cette occasion que nous nous sommes proposés d’accueillir la Journée 2012, et nous y travaillons depuis le mois de septembre dernier. Pour nous, c’est une superbe occasion de faire connaître Pontarlier à nos amis suisses ». 400 associations ! Il faut dire qu’entre l’Association des sourds et malentendants de Pontarlier et la Suisse romande, se vit une véritable idylle qui dure depuis longtemps. Et pour cause: l’Association a été fondée par la très énergique Marie-Marcelle Rampin, ancienne présidente de l’Amicale des malentendants de Lausanne et installée dans la ville française depuis de longues années. « Quand je suis arrivée ici, se souvient Marie-Marcelle Rampin, il n’y avait aucune association pour les malentendants. Je me suis aussitôt dit qu’il fallait faire quelque chose ». Et très vite, la nouvelle association connaît un grand succès, sous l’impulsion de sa première présidente, mais aussi grâce au légendaire engagement associatif de ses habitants, la capitale du Haut-Doubs comptant au total près de 400 associations pour… 19'000 habitants. Et pour cette Journée des amicales 2012, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’association de Pontarlier a concocté un programme très riche, organisé avec rigueur et minutie. Dès leur arrivée à 9 heures du matin, les invités ont été conviés à un chaleureux petit-déjeuner, non loin de l’Hôtel de Ville, dans les locaux du Théâtre municipal Bernard Blier, mis à disposition par la Municipalité de Pontarlier. Une Municipalité qui n’a d’ailleurs ménagé aucun effort pour faire de cette journée une véritable réussite: prêt d’une salle de projection alors même que celle-ci était déjà réservée pour la répétition d’un gala, autorisations de parking pour les cars, apéritif offert à tous les invités, etc. Distillerie Guy Dès 9 heures 30, les amicaliens se sont scindés en deux groupes, l’un qui a effectué une rapide visite guidée des hauts-lieux de la ville (église, caserne, ponts, places, statues, etc.), tandis que l’autre groupe s’est rendu à la célèbre distillerie Guy, dernière distillerie familiale de Pontarlier où se sont succédé quatre générations de distillateurs depuis 1890. Car c’est au 19ème siècle, suite à l’installation du Suisse Henri Louis Pernod, que Pontarlier s’est érigée en véritable capitale de l’absinthe, la célèbre « fée verte » qui marquera durablement de son empreinte le développement de la ville. A 11 heures précises, commença ensuite la partie la plus « protocolaire » de la journée, avec la chaleureuse allocution de bienvenue prononcée par la présidente Pascale Roussillon, suivie par celle de Gilbert Balaguer, Adjoint au maire de la ville. Ce fut ensuite au tour de Ginny Siegrist vice-présidente de forom écoute, de lire une brève déclaration en lieu et place de la présidente Michèle Bruttin, malheureusement retenue à la dernière minute pour raisons de santé. Riche patrimoine Tous les participants ont ensuite été invités à découvrir, dans la salle du Théâtre Blier, un court film de présentation de la cité du Haut-Doubs, abordant les dimensions historiques, culturelles, géographiques mais aussi économiques et architecturales de la cité. Un patrimoine d’une telle richesse, qu’il valut à la ville de se voir décerner en 2004, le très envié label « Les plus beaux détours de France ». Après une pause de midi consacrée à un délicieux repas dans le magnifique cadre de l’Hôtel-Restaurant Le Lac à Malbuisson, les convives ont ensuite terminé la journée par une visite du Larmont, au lieu-dit le Gounefay, sur les hauteurs de la capitale du Haut-Doubs, suivie d’une visite du Musée de Pontarlier. En fin de journée, ce sont des visiteurs visiblement ravis qui se sont séparés, non sans se donner rendez-vous en 2013 pour la prochaine Journée des amicales, qui sera organisée par le comité de l’amicale des malentendants de Morges et la Côte (Amalco). SUIVANT PRECEDENT