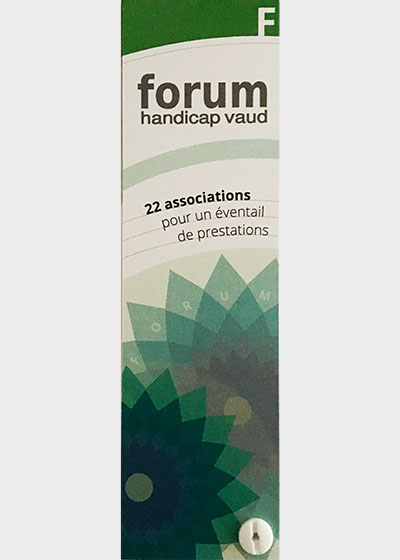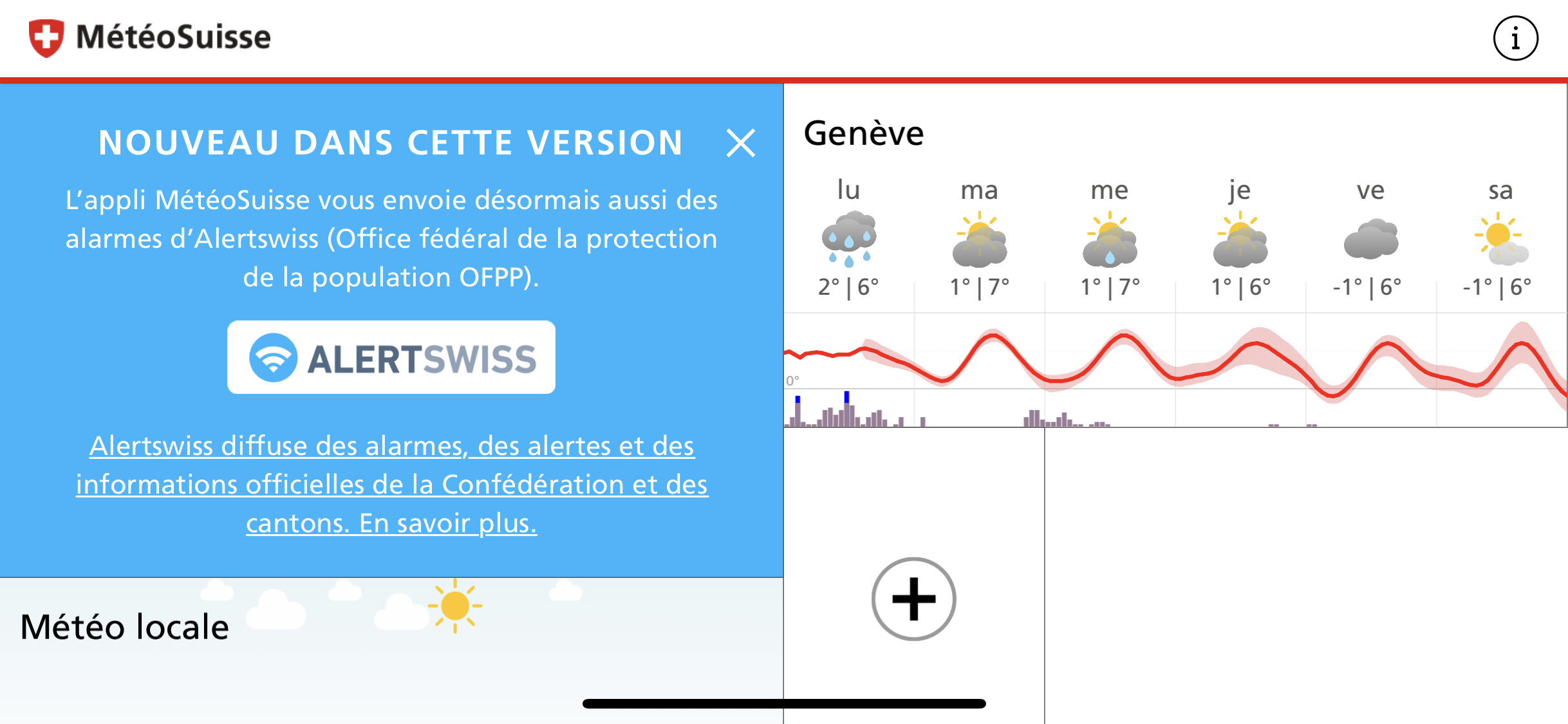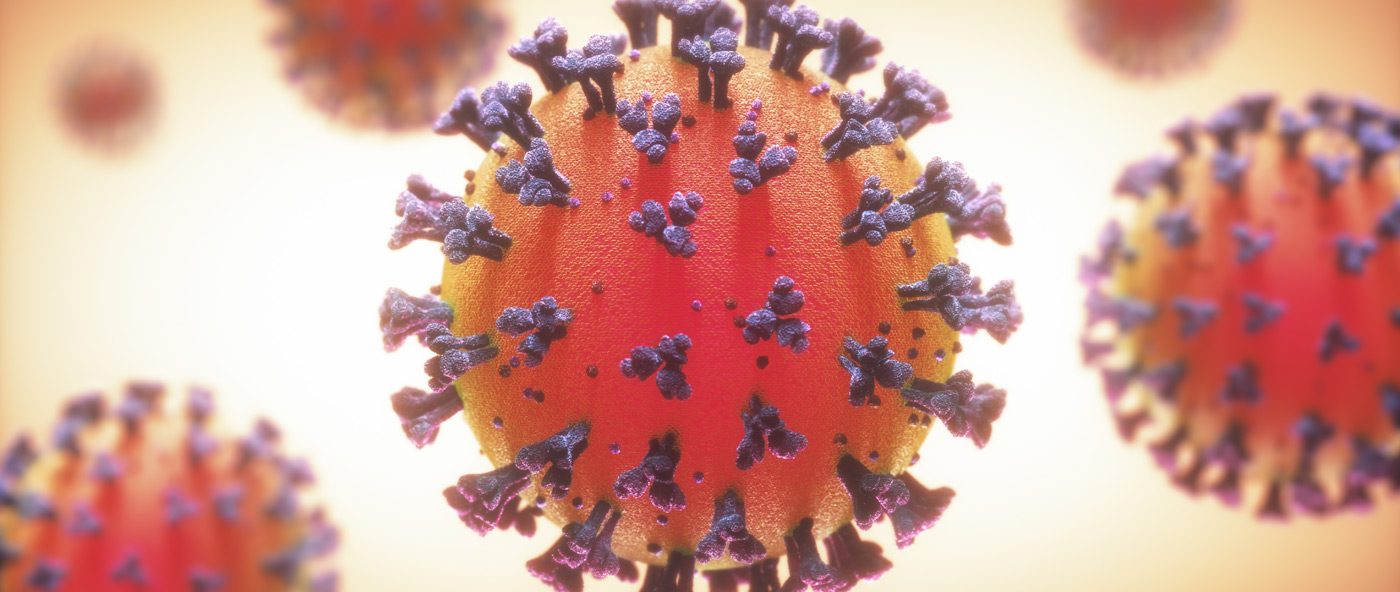2475 résultats
- Hiver blanc en Valais | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Hiver blanc en Valais 15 novembre 2010 Publié le : En Valais, chaque station et chaque village possèdent des atouts indéniables. Voici quelques-unes de nos destinations préférées, au charme authentique. L’hiver vous appartient! Evolène, l’authentique Un séjour en Valais passe forcément par le Val d’Hérens, l’une des vallées les plus sauvages et authentiques de la région. Nous avons eu le coup de foudre, avouons-le, pour Evolène, petit village d’à peine 750 âmes composé d’un entrelacs de granges, de greniers, de raccards et de chalets noircis par les ans. Au cœur de l’hiver, les toits d’ardoise ou de lause se couvrent d’un épais manteau neigeux. Le ruissellement des eaux de la Borgne berce la quiétude de ce village qui a su préserver toute son authenticité, sans pour autant ressembler à un musée en plein air. Certains habitants du coin portent encore le costume traditionnel quand ils vaquent à leurs activités. Et pas seulement pour plaire aux touristes ! Empruntez la route qui grimpe au-dessus de Villaz. Vous aurez de là-haut le plus beau panorama sur la commune – la 4e de Suisse en superficie tout de même ! -, de la Dent-Blanche jusqu’au pic d’Artsinol. Grimentz, village carte postale C’est en suivant le Val d’Anniviers que vous découvrirez le village de Grimentz, perché à 1570 m d’altitude. Le long de ses ruelles pentues, les maisons aux façades noircies par le soleil et aux toits de bardeaux semblent imbriquées les unes dans les autres. En hiver, les pilotis qui maintenaient ces anciens greniers à l’abri des rongeurs disparaissent sous une épaisse couche de neige. Grand rendez-vous de la saison froide: le marché de Noël animera les rues du village les 11 et 12 décembre prochains, dans un décor féérique. Ovronnaz: détente dans les bulles Située sur un plateau bien ensoleillé, la petite station d’Ovronnaz dispose d’un domaine skiable qui s’étend de 1400 à 2500 m d’altitude. Sentiers de randonnée ou de raquettes et pistes de fonds balisés attendent les amoureux de nature sauvage. Mais après les joies de la neige, place aux délices de l’eau bien chaude, qui effacera les courbatures et la fatigue d’une journée skis ou raquettes aux pieds. Une petite trempette dans les bassins extérieurs du magnifique centre thermal vous détendra et vous remettra en forme, pour mieux apprécier la soirée au coin du feu qui se profile à l’horizon. Imaginez: vous barbotez dans une eau à 30-35 degrés, tout en admirant un cirque exceptionnel de sommets enneigés. Si le paradis hivernal existe, c’est à cela qu’il doit ressembler… Sans voiture Vous rêvez d’air pur et de calme absolu ? La neige tombe en abondance dans la vallée de Conches, paradis des fondeurs. Les stations familiales de Riederalp et Bettmeralp, sans voitures, sont idéalement situées sur un haut plateau ensoleillé, à près de 2000 m d’altitude, en bordure du glacier d’Aletsch. Ces deux villages offrent un panorama exceptionnel sur les sommets culminant à plus de 4000 m des Alpes valaisannes, dont le Cervin et le Dom. A la nuit tombée, empruntez le chemin éclairé qui relie Riederalp à Bettmeralp: une heure de magie garantie ! Le domaine des Portes du Soleil Paradis des amateurs de neige fraîche et de sports de glisse, le domaine des Portes du Soleil, qui compte 650 km de pistes réparties sur un territoire franco-suisse regroupant 12 stations, bénéficie d’un enneigement exceptionnel de mi-novembre à fin avril. Vous n’aimez pas la monotonie ? Pas de problème, vous pourrez passer d’une piste à l’autre avec un seul et même forfait. Au total 26 pistes noires, 105 rouges, 112 bleues et 37 vertes sont à votre disposition pour vous dégourdir les jambes ! Les adeptes du snowboard auront le choix entre 9 snowparks pour peaufiner leurs figures. Les montées d’adrénaline, très peu pour vous ? Chaussez raquettes ou chaussures de marche et empruntez les sentiers balisés – 385 km en tout ! - pour partir à la découverte d’un paysage grandiose. Vous êtes plutôt bouquin, lunettes de soleil, vin chaud et chaise longue ? Pas moins de 89 restaurants vous accueillent sur les pistes. Comment s’y rendre ? En voiture, par l’autouroute A9 qui traverse la Vallée du Rhône. Jusqu’à Sion (pour le Val d’Hérens), Sierre (Val d’Anniviers) ou Brigue, au pied du Simplon, pour la Vallée de Conches. Ou encore en train. Jean-Pierre Mathys SUIVANT PRECEDENT
- Un lien entre diabète sucré et perte auditive | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Un lien entre diabète sucré et perte auditive 27 décembre 2022 Publié le : Selon l’Association américaine du diabète, les personnes souffrant de diabète sucré présentent deux fois plus de risque de présenter une perte auditive. Si le mécanisme de survenue de cette perte est mal connu, une prise en charge adéquate du diabète en limiterait les risques. Statistiquement, la présence de perte auditive est deux fois plus fréquente chez les personnes atteintes de diabète sucré (type 1 et 2) que chez celles qui ne souffrent pas de cette maladie métabolique. C’est ce que révèle une étude de l’Association américaine du diabète qui précise également que les personnes présentant un prédiabète sucré sont également concernées puisque leur taux de perte auditive est 30 % plus élevé que chez les celles dont la glycémie est normale. Reste que pour l’heure, il n’est pas encore possible de déterminer pourquoi et comment le diabète affecte l’audition. Selon l’association américaine, « il est possible que les taux élevés de glucose sanguin associés au diabète endommagent les petits vaisseaux sanguins de l'oreille interne, de la même manière que le diabète peut endommager les yeux et les reins », des organes également abondamment vascularisés par des micro-vaisseaux sanguins. Personnes âgées Et ce n’est pas tout : selon une récente étude menée à Singapour sur plus de 1800 adultes âgés de plus de 60 ans, et publiée dans la revue Clinical Otolaryngology , le diabète sucré serait un facteur de risque particulièrement élevé de survenue d'une déficience auditive au moins modérée chez les personnes âgées de plus de 70 ans. La présence de cette maladie serait dans ce cas surtout associée à une augmentation plus importante du seuil auditif dans les hautes fréquences. Si la cause de la corrélation entre perte auditive et diabète n’est pas encore clairement déterminée, une prise en charge correcte et rapide du diabète via un régime alimentaire, des antidiabétiques oraux et/ou de l’insuline, permettra une correction du taux de glycémie dans le sang, limitant ainsi aussi bien le risque de complications dégénératives que de perte auditive. SUIVANT PRECEDENT
- Déficience auditive: et si vous vous auto-dépistiez... en ligne? | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Déficience auditive: et si vous vous auto-dépistiez... en ligne? 29 mai 2017 Publié le : Le saviez vous? Les auto-dépistages de la parole dans le bruit en ligne aident à sensibiliser les jeunes à la déficience auditive suite à l’écoute de la musique. Les dépistages auditifs réguliers pour les adolescents ne se déroulent que dans quelques pays, même si plus d'un milliard d'adolescents et de jeunes adultes risquent d'endommager leur capacité auditive à cause de leurs pratiques d'écoute dangereuses selon l'Organisation mondiale de la santé. À l'adolescence, le risque de lésions auditives, y compris l'acouphène, augmente en raison de l'exposition accrue au bruit élevé, p. ex. par l'utilisation de lecteurs portatifs. Aux Pays-Bas, les auto-dépistages vocaux en ligne et en direct sont utilisés pour sensibiliser les jeunes et prévenir la déficience auditive induite par la musique. Auto-dépistage rentable Une étude coût-bénéfice néerlandaise basée sur les effets estimés des interventions préventives conclut que les tests auditifs en ligne sont un excellent moyen de réduire les coûts tout en augmentant la sensibilisation. L'auto-dépistage semble améliorer la prise de conscience du risque de déficience auditive à cause de l'exposition à un bruit et peut entraîner un changement dans le comportement de la prise de risque chez les jeunes. La seule chose nécessaire pour passer un test auditif en ligne est un environnement de mesures silencieuses et un ordinateur, une tablette ou un smartphone avec accès Internet. Programmes de dépistage auditif incomplets Dans les pays occidentaux, le dépistage auditif néonatal avec des émissions acoustiques et des techniques abrégées de réponse auditive du tronçon cérébral est en place. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 5 ans, il reçoit des examens auditifs effectués par le médecin-conseil de l'école, mais lorsque l'enfant vieillit, ces tests disparaissent. Les auto-dépistages de la parole dans le bruit en ligne pourraient prendre le relais lorsque ces tests auditifs stoppent. Si vous souhaitez tester votre audition,hear-it.org dispose d'un test auditifs en ligne gratuit . (Source: www.hear-it.org ) SUIVANT PRECEDENT
- Cinéma : des sous-titrages à la demande grâce au smartphone | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Cinéma : des sous-titrages à la demande grâce au smartphone 22 novembre 2016 Publié le : Une grande avancée pour les malentendants suisses. Il n’y aura plus besoin de choisir une séance sous-titrée pour voir son film préféré. Grâce à son smartphone et à une application gratuite et novatrice, le malentendant pourra se rendre dans le cinéma de son choix et à la séance de son choix. L’association Regards Neufs, basée à Lausanne, et dont l’objectif est de favoriser l'accès à la culture cinématographique aux personnes déficientes visuelles et auditives, annonce le lancement des applications pour téléphones portables Greta et Starks, disponibles dès maintenant au téléchargement. Ces deux applications gratuites permettent de télécharger des audiodescriptions et sous-titres d'un film du catalogue Regards Neufs (www.regards-neufs.ch ) et de se rendre dans n'importe quel cinéma de Suisse qui diffuse le film , sans contraintes d’horaire de séance, ni d’endroit spécifique. L'application de sous-titrage Starks pour téléphone portable permet de télécharger librement des sous-titres de films pour les personnes à déficience auditive qui peuvent ainsi désormais se rendre dans toutes les salles de Suisse en même temps que tout le monde, et vivre une expérience cinématographique d’une manière totalement autonome. Chaque mois, de nouveaux films accessibles seront proposés, autant en Suisse romande qu’en Suisse alémanique . Les projections mensuelles de Lausanne, Genève et Martigny, jusqu’ici proposées par l’association, ne seront donc plus programmées. Toutefois, des séances en avant-première pour personnes déficientes visuelles ou auditives seront organisées, de manière à garder un lien entre Regards Neufs et ses spectateurs. Renseignements et catalogue sur le site : www.regards-neufs.ch [zone]Principes d'utilisation Téléchargement gratuit de l’application de sous-titrage Starks sur Google Play ou App Store, à installer une seule fois sur son téléphone portable. Sur l’application, téléchargement gratuit de l’audiodescription ou du sous-titrage d’un film du catalogue Regards Neufs, à faire chez soi ou d’un endroit disposant d’une connexion Wi-fi ou 4G. En salle, une fois l’application lancée, le sous-titrage se synchronise automatiquement au film à l’aide du micro du téléphone portable, sans besoin de connexion. Le sous-titrage est quant à lui lisible grâce à une paire de lunettes StarksGLASS connectées au téléphone. La personne déficiente auditive est ainsi la seule à voir le sous-titrage à l’aide de ce moyen. [/zone] SUIVANT PRECEDENT
- Journée à thème 2017: le programme est connu et les inscriptions ouvertes! | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Journée à thème 2017: le programme est connu et les inscriptions ouvertes! 23 avril 2017 Publié le : "Proche aidant de malentendant, en quoi est-ce différent?" Telle est la problématique que la Journée à thème 2017 de forom écoute va s'atteler à traiter le 10 juin prochain au Musée Olympique de Lausanne. Le programme complet est connu (à télécharger ici) et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai ! Organisée depuis de nombreuses années la Journée à thème de forom écoute de manière générale, à toute personne intéressée et sensibilisée par les problèmes de malaudition. Elle intéressera particulièrement les personnes malentendantes, mais aussi (et surtout) leurs proches. Professionnels de l’audition et de la santé, associations et organisations sont également les bienvenus. Handicap de la communication par excellence, la malaudition ne touche pas que la personne qui en souffre. L’entourage - conjoints, frères et sœurs, descendants et ascendants - est également affecté par ce trouble sensoriel qui rend l’établissement de relations sociales et familiales difficile. Mais pas seulement. Car l’entourage est aussi directement sollicité dans la prise en charge de ce handicap invisible mais très invalidant. Il est ce que l’on appelle aujourd’hui un proche aidant, concept qui désigne « une personne de l’entourage immédiat d’un individu atteint dans sa santé et/ou dans son autonomie et qui requiert une assistance pour certaines activités de la vie quotidienne ». Seulement voilà : la déficience auditive étant un handicap singulier, peut-on également définir une singularité pour le proche aidant d’un malentendant ? Vivre dans l’entourage et contribuer à la prise en charge du handicap auditif d’un malentendant implique-t-il une réalité fondamentalement différente de celle des autres proches aidants ? Afin de traiter de cette problématique passionnante, les orateurs suivant seront nos invités: - Stéphanie Pin , cheffe d’unité du Centre d'évaluation et d'expertise en santé publique (CEESAN) et Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) de Lausanne. Ancienne responsable de programmes de prévention à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) en France, elle a contribué au développement d'un programme de promotion de la santé pour des personnes présentant des déficiences sensorielles, et a également participé à plusieurs recherches sur les besoins des proches aidants, en France et en Suisse. - Christine Burki-Kung , directrice, assistante sociale, superviseure en travail psychosocial et formatrice d’adultes de l’association Espace Proches, centre d’information et de soutien pour les proches et les proches aidants. - Anne-Claire Vonnez , cheffe de projets, responsable du « Projet ProcheConnect », plateforme de communication pour les proches aidants, Pro Infirmis. Enfin et comme à l'accoutumée une table ronde sera organisée dans l'après-midi en présence de proches de malentendants, Anne Catherine Crisinel Merz et Christophe Darioly, (ASPEDA, Association suisse de parents d’enfants déficients auditifs), Gilberto Betti, conjoint de malentendante, et Sabrina Grassi, fille de malentendante. Le programme complet peut être téléchargé ici en pdf . Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai et peuvent être effectuées: - par email à l'adresse: info@ecoute.ch - via le formulaire en ligne de forom écoute, Rubrique "Concerne" et ajouter en remarque la mention "Journée à thème 2017". - Par voie postale en remplissant le bulletin d'inscription suivant et en l'envoyant à l'adresse: forom écoute, av. Général-Guisan 117 1009 Pully. SUIVANT PRECEDENT
- 20 ans de lutte contre le bruit excessif | FoRom Ecoute
Retour au Magazine 20 ans de lutte contre le bruit excessif 14 septembre 2016 Publié le : L’ordonnance fédérale « Son et laser » (OSLa) qui régit les normes en matière d’émissions sonores a 20 ans cette année. La lutte contre le bruit excessif, en particulier durant les concerts et dans les clubs reste pourtant loin d’être gagnée. Enquête sur un phénomène qui met en danger l’audition des plus jeunes. C’est une certitude scientifique et médicale établie depuis fort longtemps. Le bruit excessif est nocif pour les oreilles. Qu’il s’agisse de concerts en salle ou en plein air, ou de baladeurs numériques, les décibels excessifs ne cessent d’occasionner des dégâts sur notre audition (lire encadré). Au point que pour beaucoup, le problème s’apparente à un véritable problème de santé publique, dont les proportions vont croissant. Pourtant, en Suisse, et depuis une vingtaine d’années, le législateur semble avoir pris conscience du phénomène. En 1996 en effet, entrait en vigueur l’Ordonnance fédérale son et laser (OSLa, révisée à deux reprises depuis) qui édicte des normes en matière d’émissions sonores. Ainsi, le maximum moyen sur une heure, est de 93 décibels, un seuil calculé à partir de données de tolérance physiologique pour une oreille humaine saine. Cette limite de 93 décibels peut être portée à 100 décibels en moyenne horaire, mais de manière exceptionnelle, sur la base d’une dérogation accordée par les autorités. Donc, après une demande officielle formulée par l’organisateur. Et - théoriquement du moins -, la loi prévoit que dans ce cas, l’organisateur de l’événement informe le public du niveau d’émissions sonores auquel il est soumis, distribue gratuitement des tampons auditifs, et aménage même des zones de récupération sonore dans lesquelles le public peut venir se mettre à l’abri du son et mettre ainsi ses oreilles au repos. D’autant qu’au-delà de deux heures d’exposition, cette limite à 100 décibels ne doit plus être dépassée, sous peine d’engendrer de sévères atteintes de l’audition. Prévention A cette législation en apparence très stricte – les clubs sont même par exemple tenus d’avoir leur propre enregistreur de décibels -, s’ajoutent d’authentiques efforts consentis en matière de prévention. Dans ce domaine, la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) a fourni un effort méritoire en termes d’information et de sensibilisation sur les méfaits du bruit excessif sur l’audition. Avec des moyens infiniment plus modestes, forom écoute, la fondation romande des malentendants, œuvre également inlassablement en ce sens depuis de nombreuses années : distribution de bouchons auditifs et de matériel de sensibilisation, mise en place d’une Roue des décibels lors de chacun des stands organisés par la fondation et destinée, sous forme ludique, à sensibiliser les plus jeunes à cette problématique importante pour leur santé auditive, etc. Seulement voilà : en dépit d’une législation en vigueur depuis deux décennies, et des initiatives consenties en termes de sensibilisation, il semble que la situation en matière de bruit excessif ne soit pas idéale. Selon une étude mandatée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), plus de 60% des clients de discothèques estiment que la musique qui y est diffusée est trop forte. En outre, ajoute l’Office, « seuls 40% des personnes qui visitent ces établissements savent que ces derniers sont tenus de mettre gratuitement à disposition de leurs clients des protections d’ouïe ». Mais il y a plus inquiétant : « en fait et à mon sens, explique un bon connaisseur des nuits genevoises, la législation fédérale est tout à fait correcte et suffisante. Le problème c’est qu’elle est exploitée au maximum de ses possibilités. Ainsi, au fil des années, j’observe que la norme, qui est de 93 décibels, est de plus en plus contournée par les organisateurs qui tendent à repousser les limites et à demander de plus en plus de dérogations pour atteindre les 100 décibels. Et dans certains cantons, ces dérogations sont plus facilement accordées que d’autres ». Polémique à Lausanne Emblématique de cette tendance, la polémique observée cet été à Lausanne, ville dont la politique en matière de lutte contre le bruit est connue pour être une des plus restrictives. Trois festivals de musique gratuits et non des moindres, ont en effet publiquement fait part de leurs doléances, se plaignant du zèle de la ville dans son application de l’ordonnance Son et Laser et demandant une dérogation au plafond des 93 décibels. Argument phare : public et même artistes bouderaient des manifestations dont le volume sonore serait trop faible. « Des artistes ont préféré ne pas venir plutôt que de devoir assumer les 93 dB au risque d’un son médiocre ou d’une amende , a ainsi expliqué une organisatrice de festival, dans le quotidien vaudois 24 heures . Nous avons dû prévoir en salle un groupe qui a joué en plein air à Genève et dans d’autres villes. » Depuis, et également en raison d’une inégalité de traitement en faveur d’une manifestation organisée par une grande multinationale, la nouvelle Municipalité de la ville a annoncé une – légère – inflexion de sa politique, s’engageant à délivrer plus fréquemment des dérogations, même si celles-ci demeureront « l’exception ». Mais le zèle lausannois, y compris en matière d’amendes délivrées en cas de dépassement des limites légales, est une singularité en Romandie. « La plupart des grandes villes romandes délivrent volontiers des dérogations pour passer à 100 décibels, explique notre connaisseur. Mais le problème n’est pas tant à ce niveau que dans les mesures prises pour faire respecter les réglementations. Les amendes ne sont pas dissuasives, et bien des villes ne disposent pas de suffisamment de personnel pour contrôler efficacement le respect de la loi ». Et de déplorer : « D’ailleurs dans la plupart des cas, la priorité des villes est en réalité plus d’éviter les nuisances et les plaintes du voisinage qui y sont liées, qu’à proprement parler veiller à la préservation de l’audition des spectateurs de concerts ». Stricte application de la loi Des spectateurs qui, malgré toutes les actions de sensibilisation, ne semblent pas toujours au fait des risques qu’ils encourent. Selon l’Office fédéral de la santé publique, plus de la moitié des 25-35 ans auraient déjà souffert de perturbations auditives. En cause, la généralisation des baladeurs numériques et des smartphones bien sûr, mais aussi le comportement de bien des jeunes, pourtant souvent informés des risques. A l’origine d’une importante recherche, le Dr Larry Roberts, de l’université canadienne de McMaster, a publié en juin dernier dans la revue Scientific Reports , une étude portant sur plus de 170 jeunes âgés de 11 à 17 ans et consacrée aux troubles précoces de l’audition. Après avoir réalisé des tests d’audition poussés et avoir interrogé les sujets, l’équipe est arrivée à la conclusion que presque tous les participants enregistraient des « habitudes d’écoute à risque » en écoutant de la musique trop forte au casque, en soirée ou en concert. En Suisse, Sarah Chiller, chercheuse à la Haute école spécialisée Kalaidos de Zurich est arrivée à une conclusion similaire. Après avoir étudié l’année dernière toute une série de salles de concerts, regroupant divers genres musicaux (classique, heavy-metal, rock, etc.), elle est parvenue à un résultat également alarmant : selon la musique écoutée, entre 4 et 61% des quelque 450 spectateurs interrogés s’équipaient de protections auditives. Un chiffre largement insuffisant et qui conduit la chercheuse à recommander d’agir plutôt en faveur d’une stricte application de la loi en vigueur que d’une sensibilisation qui ne produirait pas tous les effets attendus. Jeunes adeptes de conduites à risques, manque de rigueur constatée dans l’application de l’ordonnance Son et Laser, la boucle est bouclée, et il semble donc bien difficile de sortir de l’impasse dans laquelle la lutte contre le bruit excessif semble engagée. Un constat qui conduit à se demander si désormais, pour les organisations en charge des troubles auditifs, il ne serait pas plus efficace de réorienter leur action de sensibilisation en direction des pouvoirs publics pour les conduire à agir en faveur d’une application plus stricte et plus restrictive de l’OSLa. [zone]Le syndrome du DJ Ainsi que de nombreuses études l’attestent, les professionnels de la musique (musiciens et techniciens) sont parmi les premières victimes du bruit excessif. Un phénomène bien connu et qui les conduit, paradoxalement, à émettre eux-mêmes des sons trop forts. C’est ce que l’on appelle le syndrome du DJ, en référence au fait que nombre d’entre eux, qui s’habituent à un son excessif, augmentent insensiblement le volume au cours d’une manifestation, de manière à ce que la musique leur paraisse toujours aussi forte qu’avant. Avec évidemment, des conséquences sur l’audition des spectateurs.[/zone] [zone]Les dangers de la musique d’ambiance Nous vivons au sein de ce que l’on peut appeler une société du bruit. Car celui-ci est omniprésent, lié aux nuisances de la vie urbaine mais pas seulement. Partout, musique et radio polluent notre environnement sonore : gares, parkings, salles de sport, ascenseurs, cafés, restaurants, magasins… et même parcs et jardins publics, sont désormais envahis par une musique aussi intempestive qu’inutile. Inutile ? Voire ! Car ce fond sonore si agaçant trouve parfois sa justification dans une démarche… de marketing. Il y a près d’un siècle en effet, le musicien et compositeur français Erik Satie esquissait, en ce début d’ère industrielle triomphante, un concept qui allait faire florès, celui de la « musique d’ameublement », considérée comme un élément décoratif comme pouvaient l’être l’agencement de la lumière ou des meubles d’un lieu. Seulement voilà : très vite, ce concept est récupéré dans un logique marchande, de nombreuses études attestant que la musique de fond influence favorablement le comportement des consommateurs, dans les grandes surfaces, mais aussi dans les cafés et restaurants, où la consommation de boissons serait stimulée. Le résultat de cet incessant matraquage musical n’est pas anodin en termes d’audition. Car le son trop amplifié n’est désormais plus le seul danger pour nos oreilles. Une étude menée par des chercheurs de l’université de Harvard a ainsi démontré que le nerf acoustique soumis à un son modéré mais permanent et de longue durée, subissait des lésions de dégénérescence. « Cette étude montre que le son continu, lui aussi est nocif pour l’audition, même s’il n’est pas trop fort, car nos oreilles ne peuvent jamais se reposer, stimulées en permanence » , conclut un médecin ORL qui ajoute : « Si ces résultats venaient à se confirmer, il faudra bien s’interroger sur l’opportunité de mettre en place une législation qui n’encadrerait plus seulement le volume des émissions sonores, mais aussi leur durée, et ce même quand elles sont d’intensité très modérée ».[/zone] [zone]Pourquoi le son excessif détruit votre audition Il existe une grande variabilité individuelle face au bruit et certains gènes semblent notamment influer sur la sensibilité au traumatisme sonore. Mais il est acquis qu’une exposition excessive au bruit tant en intensité qu’en durée, occasionne des dégâts définitifs sur notre audition. Plus l'intensité et la durée d'exposition sont importantes, plus le risque d'atteinte de l'audition augmente. En cause, une destruction des cellules ciliées de l’oreille interne, dont le rôle est fondamental. Au nombre – restreint - de 3500 par oreille, celles-ci ont pour rôle de transmettre l’information sonore venue de l’extérieur, en direction du nerf auditif. Leur destruction est irréversible et il n’est pour l’heure pas possible de les régénérer.[/zone] [zone]Comment protéger son audition ? Moyennant un certain nombre de précautions, il est tout à fait possible d’apprécier un concert de musique, tout en préservant son audition : Appliquez un principe simple : plus l’intensité sonore est élevée, plus la durée de votre exposition doit être brève. N’hésitez-donc pas, si nécessaire, à vous ménager des pauses durant un concert, en veillant à ne pas dépasser les deux heures d’exposition si l’intensité sonore frise les 100 décibels. Espacez en outre l’intervalle entre les concerts auxquels vous assistez d’au moins 4-5 jours pour permettre à vos oreilles de récupérer. Équipez-vous de bouchons auditifs en mousse. Lorsque l’intensité sonore d’un concert est portée à 100 décibels, l’organisateur est tenu de les fournir gratuitement. Pour les enfants en revanche, préférez les coques anti-bruit, bien plus adaptées et efficaces. Elles ne sont malheureusement pas distribuées lors des manifestations musicales. Eloignez-vous des enceintes. Soyez attentifs aux signaux d’alerte : bourdonnements, sifflements, acouphènes, sensation d’audition atténuée sont des symptômes sans ambiguïté : ils indiquent que vos oreilles souffrent et qu’il faut rapidement les mettre à l’abri du son excessif. Le lendemain d’un concert, n’écoutez pas de musique sous quelque forme que ce soit. Votre oreille a besoin de repos, comme vos jambes après une longue journée de marche, qui elles, et à l’inverse de vos oreilles, manifestent leur fatigue, par exemple par des courbatures. Alors que nous veillons à protéger nos yeux par des lunettes anti UV au moindre éblouissement ou à la moindre lumière trop forte, nous n’accordons qu’une faible attention à nos oreilles, pourtant souvent bien plus exposées.[/zone] [zone]Le fléau du mp3 Toutes les études l’attestent : pour les jeunes, la généralisation des baladeurs numériques puis de leurs successeurs, les smartphones, qui permettent d’écouter de la musique à tout moment via des écouteurs, représentent un véritable fléau pour l’audition, en raison de la nature du son, compressé en format mp3, mais aussi en raison de l’allongement de la durée d’écoute, la numérisation permettant d’emporter des centaines d’heures d’écoute avec soi. La règle à observer est celle des 60 % - 60 minutes : il ne faut pas écouter de la musique numérique plus d'une heure à un volume supérieur à 60 % du maximum.[/zone] SUIVANT PRECEDENT
- Perte auditive liée à la prise de médicament | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Perte auditive liée à la prise de médicament 22 octobre 2018 Publié le : Le Cisplatine contre le cancer peut provoquer une déficience auditive. Des scientifiques le prouvent. Selon une étude parue début septembre dernier, des chercheurs américains soutiennent que le médicament appelé Cisplatine, destiné aux traitements de chimiothérapie contre le cancer, est toxique pour l’oreille interne et provoque une déficience auditive qui s’aggrave après chaque traitement. Le Cisplatine, kesako ? Le Cisplatine combat le cancer, utilisé par traitement de chimiothérapie. Cet antinéoplasique est un complexe métallique inorganique possédant du platine. Prescrit à environ 10 à 20% de tous les patients cancéreux, il entraîne une déficience auditive permanente chez 40 à 80% des patients adultes et au moins la moitié des enfants qui le reçoivent, ainsi que des médicaments. Pourquoi ? Les scientifiques ont mesuré et cartographié le Cisplatine dans les tissus de l'oreille interne chez la souris et chez l'homme et ont découvert que des formes s'accumulaient dans l'oreille interne. Les résultats suggèrent que l'oreille interne absorbe facilement le Cisplatine, mais que son élimination est très limitée. Dans la plupart des régions du corps, il est éliminé dans les jours ou les semaines suivant le traitement, mais dans l’oreille interne, le médicament reste beaucoup plus longtemps. Les résultats de l'étude permettent d'expliquer pourquoi le Cisplatine est si toxique pour l'oreille interne et la déficience auditive. Celle-ci peut survenir longtemps après le traitement et est plus grave chez les enfants que chez les adultes. Les scientifiques suggèrent que l'oreille interne n'est pas capable de se débarrasser de ce médicament et que les cellules de l'oreille interne, qui sont importantes pour l'audition, meurent parce qu'elles sont exposées au médicament pendant une longue période. La strie vasculaire dans la région de l'oreille interne pourrait être ciblée pour prévenir la déficience auditive suite à la prise de Cisplatine. L'équipe de recherche a trouvé la plus forte accumulation dans ces stries vasculaires. Celles-ci aident à maintenir la charge électrique positive dans le liquide de l'oreille interne que certaines cellules ont besoin de détecter. Ils ont déterminé que l'accumulation de Cisplatine dans la partie de la strie vasculaire de l'oreille interne contribuait à la déficience auditive. « Nos résultats suggèrent que si nous pouvons empêcher le Cisplatine d'entrer dans la strie vasculaire de l'oreille interne pendant le traitement, nous pourrions être en mesure de protéger les patients cancéreux de développer une déficience auditive induite par ce médicament », a annoncé Lisa L. Cunningham, Ph.D., chef de l’Institut national sur la surdité et autres troubles de la communication (NIDCD) des National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis. Informations complémentaires : www.hear-it.org . Sources:www.ncbi.nlm.nih.gov et Nature Communications. SUIVANT PRECEDENT
- MétéoSwiss va relayer les alertes d’AlertSwiss | FoRom Ecoute
Retour au Magazine MétéoSwiss va relayer les alertes d’AlertSwiss 23 mars 2021 Publié le : Désormais, l’application MétéoSwiss va relayer les messages importants d’AlertSwiss en cas d’événements graves. Une manière d’élargir l’audience de cette dernière, et d’inclure encore plus de personnes déficientes auditives, difficilement jointes via les célèbres sirènes. Pensez-donc à configurer votre téléphone. Toute la population suisse les connaît. Et pour cause, chaque année au mois de février, les sirènes d’alarme hurlent pour tester leur bon fonctionnement. En cas de situations graves en effet, la population doit pouvoir être alertée pour les autorités le plus rapidement possible. Sauf que toute une partie de la population, sourde et malentendante, échappait au dispositif. Raison pour laquelle l’application Alertswiss, téléchargeable gratuitement sur les smartphones a été mise en ligne en 2018, afin d’avertir sous forme de message « push » ceux qui ne pouvaient entendre les sirènes. Depuis peu, ce dispositif est élargi grâce à une collaboration entre l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) : désormais les notifications d’Alertswiss sont désormais carrément reprises par l’application MétéoSuisse connue pour donner les prévisions météorologiques à l’échelle de tout le pays. 20 millions de téléchargements pour MétéoSwiss L’intérêt en est évident : si l’application Alertswiss, qui permet donc depuis octobre 2018 de recevoir des notifications, touche actuellement près de 750 000 utilisatrices et utilisateurs, celle de Météo Suisse a en revanche été téléchargée près de 20 millions de fois, un chiffre énorme à l’échelle de la Suisse et qui témoigne de son exceptionnelle force de frappe. En relayant les informations d’AlertSwiss sur MétéoSuisse, l’Office fédéral de la protection de la population augmente ainsi considérablement ses capacités de diffusion de l’information d’urgence. Le tout sous réserve bien sûr que l’utilisateur ait configuré sur son application la réception des notifications. Petit détail important : les notifications des niveaux « Information » et « Alerte » continueront à être diffusées exclusivement via l’application et le site web Alertswiss, et non pas par MétéoSuisse Ces notifications sont émises par les cantons et les services de la Confédération lors d’événements moins graves et ayant un caractère moins urgent. Avec cette innovation, l’OFPP poursuit une stratégie multicanaux pour la diffusion des notifications d’Alertswiss afin de toucher la population le plus largement possible. Les principaux canaux sont le site et l’application Alertswiss ainsi que Twitter. Les cantons ont également la possibilité de diffuser les messages d’Alertswiss directement via leurs propres canaux Twitter. SUIVANT PRECEDENT
- Formateur et formatrice de langue des signes | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Formateur et formatrice de langue des signes 29 septembre 2018 Publié le : Le troisième volet de la formation de formateur/formatrice de langue des signes est en cours. Elle permet de se professionnaliser et d’acquérir les compétences nécessaires. Depuis une trentaine d’années, la Suisse promeut un mouvement de professionnalisation des fonctions de formatrices ou formateurs d’adultes, ainsi que de spécialisation, avec l’apparition d’une offre de formation spécifique pour les formateurs-trices de langues ou en alphabétisation. En partenariat avec la Fédération Suisse des Sourds, l’Unité de formation continue de la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne propose une formation spécifique à l’enseignement de la langue des signes qui permettra au participant-e-s d’obtenir une qualification reconnue. Explications avec le Professeur associé HES, Daniel Lambelet. Le mouvement de professionnalisation et de spécialisation des fonctions de formatrices ou formateurs d’adultes va de pair avec l’acquisition d’un diplôme. « Dans ce contexte, il est important que les professionnel-les qui accompagnent des adultes provenant d’horizons variés dans l’apprentissage de la langue des signes bénéficient également d’une formation continue professionnalisante ». Pour améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d’une perte auditive, les formateurs et formatrices de langue des signes contribuent à les faire accepter et respecter davantage, et à ce qu’elles puissent obtenir l'égalité des droits et des chances, et l’intégration sociale. « Alors que la Fédération Suisse des Sourds défend la langue des signes et sa culture et encourage ainsi la socialisation linguistique bilingue, elle soutient également cette formation et collabore activement ». Les diplômés sont habilités à dispenser des cours de langue des signes pour adultes de manière indépendante, ayant acquis ses bases de la linguistique et sa sociologie et approfondi leurs connaissances de la culture sourde. « Ils apprennent également à communiquer avec des groupes hétérogènes et à consolider leurs compétences de communication avec des participants adultes. « La difficulté que certaines personnes sourdes rencontrent encore à trouver une insertion professionnelle épanouissante, malgré leur qualification, leur engagement au travail, etc est connue. La perspective de pouvoir devenir formatrice ou formateur de langue des signes ouvre pour certaines d’entre elles un horizon stimulant ». Du côté des étudiants, cette formation leur permet de concevoir des modèles de planification, organiser, communiquer, élaborer, donner des cours et les évaluer. Ils sont également en mesure de percevoir les processus complexes des groupes d'étude, de les analyser, d'intervenir de manière adéquate et de soutenir les apprenant-e-s dans leur processus concret de formation et d'apprentissage. Témoignage Noha El Sadawy étudie cette voie et partage ses impressions. Son intérêt porte sur la pédagogie et la linguistique. « Cette formation m'intéresse beaucoup, le contact humain est direct, ce qui nous permet de mieux comprendre et de pouvoir poser des questions sans gêne ». Elle a auparavant suivi diverses formations sur plusieurs années avec l’aide d’un interprète, semées de moments difficiles et d’autres enrichissants. Noha a récemment fait son diplôme de CAS en médiation culturelle auprès de l’ESSP et était la seule personne subissant des déficientes auditives. « Il y a eu des problèmes avec l'AI, qui refusait de payer les frais d'interprétariat pour me permettre de poursuivre mes études. Après trois mois, j'ai dû m’arranger avec les interprètes bénévoles sans lesquels je n’aurais pas pu suivre ces cours, que je continue avec grand intérêt ». Et d’ajouter : « il me paraît important que nous puissions participer aux cours avec les formateurs/formatrices, directement en langue des signes. Nous nous regroupons et échangeons beaucoup ». L'aspect social est enrichi par la découverte de la communauté sourde et malentendante, les enseignants/enseignantes évoquent des exemples liés à elle. « J'encourage l’intégration de cette formation équivalente à celle des étudiants entendants ; il est juste de pouvoir étudier comme eux ». La fondation forom écoute reviendra sur cette formation au terme des examens en 2020 et au moment des prochaines inscriptions. www.eesp.ch © Marc Magnin SUIVANT PRECEDENT
- Mélanie Fernandes Paiva : « Je ne lâche jamais rien ! » | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Mélanie Fernandes Paiva : « Je ne lâche jamais rien ! » 15 janvier 2016 Publié le : Âgée de 18 ans, Suisse et Portugaise, Mélanie Fernandes Paiva est fribourgeoise. Atteinte d’une bilatérale surdité sévère, la jeune femme fait preuve d’une force de caractère impressionnante, malgré de nombreux soucis de santé. Retour sur un étonnant parcours qui la conduit aujourd’hui à devenir assistante en pharmacie. Vous venez de terminer votre scolarité obligatoire, et vous avez reçu, en juin dernier, le Prix aux élèves malentendants décerné par forom écoute… Mais, oui et j’ai trouvé ça vraiment chouette parce que c’est un joli cadeau. C’est une reconnaissance que les autres n’ont pas ! Depuis quand êtes vous malentendante ? En fait, ma surdité est liée à une maladie que j’ai depuis la naissance. A cause d’elle, j’ai une perte auditive sévère liée à un problème d’osselets au niveau des deux oreilles ! Très tôt, mes parents ont découvert que je ne mangeais pas suffisamment et que j’avais de nombreux autres symptômes. Tout cela a conduit à la découverte de la surdité, j’avais 3 ans, et cela a été un vrai choc pour eux. A quel âge avez-vous été appareillé ? Assez tard, vers 5 ans. Quand ma maman me parlait depuis la cuisine, j’allais vers elle, je montais sur une chaise et je lui disais : « Regarde-moi ! ». Là, ils ont compris qu’il fallait faire quelque chose (rires) ! C’est mon caractère : quand j’ai besoin de quelque chose, je le dis clairement ! En tout cas, vous entendez et parlez parfaitement, au point qu’on ne se doute même pas de vos problèmes d’audition… Oui, mais cela n’a pas été facile et il a fallu beaucoup travailler, en particulier avec une logopédiste, pour rattraper le retard de langage que j’avais. Comment s’est déroulée votre scolarité ? Jusqu’à la 3ème Primaire, j’étais dans une école ordinaire, ici à Fribourg. Mais cela a été très difficile pour moi. A cause des tracasseries des autres enfants, mais aussi à cause d’une enseignante qui me discriminait à cause de mon handicap et mes origines, me plaçait au fond de la classe et ne me prêtait aucune attention ! Heureusement, le directeur m’a soutenue, j’ai changé de prof et ça a été bien mieux. Après la 3ème Primaire, vous intégrez l’Institut pour enfants sourds de Fribourg. Pourquoi ? Pendant quelques temps, j’ai suivi en fait les deux écoles, ordinaire et pour sourds. Ensuite en effet, j’intègre complètement l’Institut Saint-Joseph où j’ai d’ailleurs appris parfaitement la langue des signes. En fait, je voulais surtout rencontrer des gens comme moi, capables de me comprendre ! Mais après quelques années, et malgré ce que j’avais enduré dans une école ordinaire, j’ai fini par y retourner quand même ! Ah bon ? Pourquoi cette décision ? Parce qu’à Saint-Joseph, le rythme d’apprentissage était un peu trop lent pour moi, même si tout le reste était très bien. Ensuite, en juin 2015, je termine ma scolarité obligatoire dans une école normale. Et il m’a fallu énormément de travail et de volonté pour ne pas décrocher et obtenir ce résultat, en travaillant tous les soirs pour récupérer ce que j’avais perdu dans la journée à cause de mon audition. Au final avec ce parcours, j’ai vraiment une double culture, de sourds et d’entendants ! N’avez-vous jamais été découragée ? Bien sûr, mais c’est mon caractère, je ne lâche jamais rien. Heureusement, ma famille m’a beaucoup soutenue, mon grand frère pour les devoirs et ma maman, qui à chaque fois me dis toujours : « ce n’est rien, tu va y arriver, tu en es capable ! » Que faites-vous depuis la rentrée du mois de septembre ? Un apprentissage d’assistante en pharmacie, ici à Fribourg. Depuis toute petite, quand j’allais acheter des médicaments, j’ai toujours été attirée par ces dames si accueillantes qui s’occupent si bien des patients ! Cela a t-il été facile de trouver un apprentissage ? Non, alors là vraiment pas du tout ! J’ai envoyé au total plus de 200 lettres pour décrocher quelque chose. Après les 50 premiers refus, j’avais même décidé de faire une année supplémentaire au cycle d’orientation, pour améliorer mes compétences et augmenter mes chances ! Et comment se passe votre apprentissage ? Très bien. Ils m’ont tout de suite dit que mon handicap ne les dérangeait pas et qu’il ne se remarquait d’ailleurs même pas… J’ai de bonnes relations avec mes collègues et ma patronne, et j’ai même des clients sourds qui viennent désormais vers moi pour obtenir leurs médicaments ou des conseils (rires) ! Et puis, en plus de la langue des signes, je parle français, portugais, anglais et j’ai des bases en allemand, ça aide ! Et comment se déroulent vos cours d’apprentissage ? C’est vraiment dur, avec 18 heures de cours par semaine et beaucoup de travail ! Il faut intégrer des mots nouveaux en relation avec le métier, se concentrer sur des enseignants qui parlent 4 heures d’affilée. Non ce n’est vraiment pas facile, c’est très fatiguant, mais je m’accroche. Je l’ai dit, malgré les difficultés, je ne lâche rien, même si je connais mes limites ! Propos recueillis par Charaf Abdessemed SUIVANT PRECEDENT
- Et si l’on parlait de la souffrance psychique des malentendants ? | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Et si l’on parlait de la souffrance psychique des malentendants ? 15 novembre 2014 Publié le : On le subodorait depuis longtemps, mais une vaste étude américaine vient de le prouver : bien plus que les autres, les malentendants sont sujets aux dépressions. En cause, l’isolement et les difficultés de communication qui rendent la vie collective si difficile. « La perte auditive est une très grande souffrance. Mais une souffrance méconnue et pas ou peu reconnue, comme s’il y avait un tabou autour. C’est pour cette raison que je trouve important de témoigner. Car personne ne peut imaginer à quel point les malentendants souffrent ». Pour Ginny Siegrist, malentendante et vice-présidente de forom écoute, cette souffrance est « multifactorielle ». « Tout y concourt, explique-t-elle avec véhémence. Le fait de toujours se battre pour communiquer, les acouphènes souvent insupportables, le si difficile deuil de tant d’activités, la vulnérabilité face aux pannes des appareils auditifs, etc. Alors oui, à la longue, on s’épuise, et il est facile de sombrer dans la déprime, dans un monde qui fait de la performance une valeur cardinale et où les malentendants, surtout les plus âgés, n’ont pas toujours l’impression de trouver leur place ! » Epuisement Cette souffrance, Sara*, âgée d’une vingtaine d’années, l’exprime d’une autre façon, mais de manière tout aussi explicite. Elle qui, après une expérience professionnelle particulièrement éprouvante, dans laquelle on a même pris soin de ne pas tenir compte de son handicap auditif, a fini par craquer. « On tient, on tient, et puis un jour, on n’arrive même plus à se lever, raconte-t-elle. On n’a même plus envie de rien : on est tout simplement épuisé, on se sent nul, plus bon à rien » . Le diagnostic a été immédiat : burn-out. « En fait, nous n’aimons pas montrer que nous sommes différents. Du coup, au lieu que les gens s’adaptent eux aussi à nous, c’est nous qui devons faire tout le boulot, tous les efforts. Alors moi, à la fin de mes journées, j’étais franchement sur les genoux. En plus je me dévalorisais, je me disais tout le temps que je n’aurais jamais de petit ami, à cause de ma surdité. Tout ça était épuisant !!! » Pour emblématiques qu’ils soient, ces témoignages, reflètent-ils une réalité généralisable ? En clair, les malentendants sont-ils plus particulièrement vulnérables face à la dépression ? Et plus précisément : leur souffrance est-elle légitime, eux qui si souvent ont l’impression d’être incompris et d’agacer leur entourage ? A ces deux questions, la réponse est clairement oui. Ainsi, une récente étude américaine, menée à grande et échelle et dont les résultats ont été rendus publics en mars dernier, vient démontrer ce que l’on subodorait depuis longtemps (voir encadré) : pour les chercheurs qui ont mené l’étude, plus de 11% des personnes ayant une déficience auditive se sentaient déprimés, contre simplement 5% chez les personnes dotées d’une parfaite capacité auditive, un écart statistique qui peut sembler faible mais qui, en réalité, est particulièrement concluant. Facteurs multiples Encore très peu étudiés, les facteurs qui expliquent cet état de fait sont multiples. En premier lieu, la difficulté, qu’il s’agisse de malaudition ou de tout autre handicap, d’assumer sa différence vis à vis d’une normalité supposée. « Quand on me parlait, je répondais à côté », se souvient encore Ginny. « Et moi je pensais, en culpabilisant : les gens doivent se dire que je ne suis pas normale ! » Car l’autre facteur explicatif, et cette fois si spécifique au trouble auditif, est que celui-ci touche à ce qui est au cœur de l’humain : l’aptitude à la communication, la capacité à comprendre et à être compris. « La cécité sépare les gens des choses, la surdité les sépare des gens », témoignait ainsi très joliment la célèbre écrivaine américaine Helen Keller, elle-même sourde et aveugle et qui en connaissait un rayon en matière de handicap. « La surdité a énormément joué sur mon isolement », ajoute encore Sara. « Le fait d’être souvent mise à l’écart, ou de suivre les discussions avec un décalage. Alors même avec la meilleure volonté du monde, on baisse les bras, et on se dit à quoi bon, cela ne sert à rien ! » Cercle vicieux S’installe alors, avec le renoncement et le sentiment de ne pas être compris, y compris par le cercle des proches, un cercle vicieux qui peut mener un malentendant à la dépression. Surtout s’il s’y ajoute d’autres vulnérabilités, comme l’âge, l’absence de famille ou de proches, ou encore les difficultés professionnelles, si stressantes. Et puis, au-delà de cet isolement si préjudiciable, d’autres éléments, liés aux troubles auditifs entrent également en ligne de compte. Les vertiges bien sûr, et ces terribles acouphènes qui sans relâche empoisonnent le quotidien de nombre de malentendants, au point de les épuiser (lire notre dossier dans le numéro 56 du magazine aux écoutes ). « En ce qui me concerne, conclut Ginny, les acouphènes ont beaucoup contribué à me fragiliser. Il est vraiment important d’apprendre à vivre avec ses acouphènes et ses problèmes auditifs, sinon on est foutu. Pour ma part, j’ai développé des stratégies pour aller mieux, en faisant beaucoup de promenades en forêt ou en m’investissant dans la vie associative. Et puis la peinture et la photographie m’ont énormément aidée ! ». * prénom fictif. ChA [zone]Une étude aux résultats explicites Publiée aux Etats-Unis en mars dernier dans le célèbre JAMA Otolaryngology Head & Neck Surgery , l’étude, intitulée « Hearing impairment associate with depression in USA adults » a établi un lien clair entre troubles auditifs et dépression. Réalisée dans le cadre d’une enquête nationale sur la santé et la nutrition aux Etats-Unis, portant sur plus de 18'000 adultes représentatifs de la population américaine, elle a abouti à des conclusions très explicites : ainsi, alors que seuls 5% des adultes ayant une capacité auditive excellente se disaient déprimés, cette proportion passait à 7% de ceux qui avaient une « bonne » capacité auditive et 11,4% de ceux qui souffraient d’une déficience auditive importante. En outre, il est clairement apparu que c’est dans le groupe des femmes de plus de 70 ans et atteintes de déficit auditif modéré que la dépression était la plus fréquente, avec un risque quadruplé ! D’ailleurs, tous niveaux de déficience auditive confondus, près de 15% des femmes de tous âges avouaient se sentir déprimées, contre 9% seulement des hommes. Etonnamment, les personnes sourdes qui ont participé à l’enquête semblent épargnées par la dépression, seuls 0,06% d’entre elles admettant en souffrir.[/zone] [zone]Une problématique peu étudiée Faut-il y voir la réelle expression d’un tabou social et médical ? Toujours est-il que la question de la dépression et plus généralement de la santé mentale des personnes souffrant de déficience auditive a été très peu étudiée. Ainsi, en Suisse romande, en dehors du psychiatre Pierre Cole des Hôpitaux Universitaires de Genève (lire l’interview ci-contre), il semble qu’aucun médecin ne se soit penché sur cette question, les services de presse des autres institutions hospitalo-universitaires romandes avouant ne disposer d’aucun expert sur le sujet. Si les ressources semblent un peu plus abondantes ailleurs en Europe ou aux Etats-Unis, la situation n’y est néanmoins guère brillante, très peu d’études sur le sujet étant disponibles, en dehors de quelques études dont l’impact est limité. La première, effectuée au Pays-Bas en 2009 (Ear and Hearin, Lippincott Williams & Wilkins), sous la forme d’un sondage portant sur 1511 personnes âgées de 18 à 70 ans, a établi que le risque de dépression grave augmente de cinq pour cent par dB de perte d'acuité auditive par individu, les jeunes étant plus sévèrement touchés par ce risque que les personnes âgées. L’autre recherche, publiée en 2013 dans le JAMA internal Medicine , a conclu « qu’une diminution de l’audition accélère jusqu’à +41% l’apparition de troubles cognitifs témoignant de l’apparition d’une démence ».[/zone] [zone]« Ce qui est fondamental, c’est de reconnaître la souffrance ! » Chef de clinique aux Hôpitaux Universitaires de Genève, le docteur Pierre Cole est psychiatre, auteur de nombreux travaux consacrés aux rapports entre santé mentale et troubles auditifs. Y-a-t-un lien entre dépression et troubles de l’audition ? Personnellement, j’utiliserais le mot souffrance psychique plutôt que celui de dépression, qui désigne une entité très spécifique. En plus, la notion de souffrance psychique est moins stigmatisante car elle renvoie plutôt à la normalité qu’au pathologique. Dans ce cas, les malentendants éprouvent-ils plus de souffrance que les autres ? C’est certain ! Au quotidien, et en raison de l’isolement et de l’incompréhension qu’ils rencontrent, ils sont plus exposés à des situations qui génèrent de la souffrance. D’autant qu’avec la miniaturisation des appareils auditifs, le handicap auditif devient encore plus invisible ! Mais selon le type de surdité, les situations sont très différentes. Ceux qui souffrent d’une surdité dite pré-linguale (celles survenues avant l’apprentissage du langage, ndlr) et qui utilisent la langue des signes, ne se positionnent pas comme handicapés. Ils ont une culture propre et forment une communauté où rien dans leur environnement ne vient leur rappeler leur déficit. Ils souffrent donc différemment, ils ne doivent cependant pas faire le deuil de l’audition puisqu’ils n’en n’ont pas une perception de manque. En clair, la souffrance est plutôt l’apanage des malentendants ? Disons que la souffrance est différente, mais ceux qui souffrent de surdité post-linguale doivent faire un deuil et donc acquérir un rôle nouveau où tout n’est plus possible de la même manière sans pour autant tout s’interdire. Qu’il s’agisse d’une surdité brusque, avec un deuil très violent, ou d’une surdité d’installation progressive, qu’il faut peu à peu accepter et à laquelle il faut s’adapter au quotidien! Que peut-on faire face à cette souffrance ? D’abord, et c’est fondamental, la reconnaître. Aujourd’hui, on tente parfois de faire comme si elle n’existait pas. Or pouvoir entendre cette souffrance, la reconnaître et la normaliser, cela permet à la personne de pouvoir évoluer dans son processus de deuil. Pourquoi la souffrance des personnes malentendantes est-elle si peu reconnue ? C’est une vraie question. C’est vrai, elle est peu reconnue, dans la mesure où on ne dispose que de peu de moyens pour accueillir ces personnes ! En général, les difficultés des malentendants restent cantonnées à l’ORL, qui très souvent, considère qu’une fois la personne appareillée, le problème est réglé ! Dans leur prise en charge, il serait bon que l’on pense à leur dire qu’on a le droit et qu’il est normal d’être mal et de souffrir en raison des problèmes auditifs. Car la clé est là : un malentendant doit comprendre que sa souffrance est normale, mais qu’il existe des solutions pour mieux la vivre. Que peut-on faire de plus pour moins souffrir ? Comprendre qu’on peut faire face à une perte, mais que l’on n’a pas pour autant tout perdu ! Les troubles auditifs empêchent ou compliquent certaines choses, c’est incontestable, mais ils n’empêchent pas tout. Par exemple, il n’y aucune raison de renoncer à la piscine, alors que de nombreux malentendants le font. L’enjeu, c’est de se construire un nouvel espace dans lequel on peut évoluer, moyennant un certain nombre d’aménagements. Ce n’est bien sûr pas facile, mais c’est faisable ! A partir de quand faut-il avoir recours à l’aide d’un spécialiste ? En tant que psychiatre, tout mon travail est de normaliser le plus possible la souffrance de chaque individu dans ce qu’il peut vivre. Mais lorsque la tristesse est intense, que l’isolement est important et que l’on commence à avoir des idées de mort, il faut consulter. Propos recueillis par Charaf Abdessemed[/zone] [zone]Si proches et si lointains… En matière de reconnaissance de la souffrance psychique éprouvée par les personnes souffrant de troubles auditifs, nul doute que les proches des malentendants sont au premier plan. Car c’est avec eux que la question de la communication et de son altération se pose en premier. En outre, c’est bel et bien au sein du cercle familial que les premiers signes d’isolement de la personne malentendante se font sentir. « Avec les proches, le dialogue est très important », observe le docteur Pierre Cole. « Mais il doit se faire dans le respect d’une certaine temporalité du processus de deuil que traverse la personne malentendante, car souvent, les proches, consciemment ou pas, ne veulent pas voir le handicap qui s’installe, trop lourd. Et souvent, il n’est pas rare qu’ils tentent de forcer ce processus de deuil». Un processus destiné à mener le malentendant du déni vers l’acceptation de sa perte auditive, mais qui peut être parfois très long et durer de longues années. Avec, dans l’intervalle, son lot d’incompréhension, de lassitude et parfois d’agressivité exprimés de part et d’autres. De fait, il existe également, en écho à celle des malentendants, une souffrance au sein des familles, qui elle également, est rarement entendue ou reconnue.[/zone] SUIVANT PRECEDENT
- Lausanne : Conviviale journée des amicales romandes… | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Lausanne : Conviviale journée des amicales romandes… 15 septembre 2014 Publié le : Quand le truculent Richard Vuille, président de l’Amicale des sourds et malentendants de Lausanne organise un événement, on peut être sûr que c’est dans la bonne humeur et la convivialité. Inutile donc de préciser que les amicaliens qui se sont retrouvés le 13 septembre dernier, pour la traditionnelle rencontre annuelle des amicales romandes, ont passé une journée exceptionnelle. C’est à un double événement que les malentendants ont été conviés, en ce samedi 13 septembre. D’abord, la traditionnelle rencontre annuelle des amicales romandes, mais aussi le 90ème anniversaire de l’Amicale des sourds et malentendants de Lausanne et environs, fondée le… 22 janvier 1924 ! « C’est un plaisir de fêter à la fois notre anniversaire et d’accueillir nos amis des autres amicales » , se réjouit le truculent président de l’amicale lausannoise, Richard Vuille, d’excellente humeur comme à son habitude. « 90 ans, c’est tout de même quelque chose pour une association, qui est avec celle de Genève, la plus vieille des amicales romandes de malentendants. Et dans ce cadre, pour nous, ce qui compte avant tout, c’est le partage et la convivialité ! » [caption id="attachment_1372" align="alignnone" width="300"] Le Municipal Lausannois Marc Vuilleumier, Michèle Bruttin et Richard Vuille[/caption] Partage et convivialité ont incontestablement été au rendez-vous dès 9h15 à la salle des cantons de la gare CFF de Lausanne, puisqu’une bonne centaine d’amicaliens en provenance d’un peu partout (Fribourg, Jura, la Chaux-de-Fonds, Morges, Genève, mais aussi Pontarlier en France voisine) se sont retrouvés autour d’un sympathique café-croissant d’accueil. Après l’allocution de bienvenue prononcée par Richard Vuille, qui a tenu à rendre hommage à la présence d’André Capt, doyen, du haut de ses 95 printemps, de l’amicale de Lausanne, ce fut ensuite au tour du Municipal Marc Vuilleumier, au nom de la Ville de Lausanne, de prendre la parole. « Faire des ponts entre les différences » « Faire des ponts entre les différences, telle est la vocation des associations », a ainsi lancé le magistrat. « Entre jeunes et moins jeunes, entre pauvres et moins pauvres, mais aussi entre handicapés et valides, car les associations participent à une politique générale d’intégration qui permet d’apprendre à vivre ensemble et à nous connaître malgré nos différences ! » [caption id="attachment_1371" align="alignnone" width="225"] Andre Capt, le doyen[/caption] Un souci de l’autre qui a conduit l’édile à rendre un hommage appuyé à la présence des Jurassiens français de Pontarlier, qui lui ont répondu par une très belle ovation. Il faut dire aussi que Marc Vuilleumier, et il a tenu à le rappeler publiquement, est également particulièrement sensible à la question du handicap, lui qui souffre notoirement d’un gros problème de vue. Ce fut ensuite au tour de Michèle Bruttin, présidente de forom écoute, de rendre hommage aux amicaliens et de remercier Richard Vuille pour son accueil exceptionnel et la qualité de l’organisation de la journée de rencontre. Car en dépit de sa bonhomie, Richard Vuille, ancien sergent tout de même, a fait preuve, d’ailleurs brillamment secondé par sa très vigilante vice-présidente, d’un sens de l’organisation quasi-militaire, le déroulé de la journée étant minutieusement minuté. « Vous savez, avoue-t-il sur le ton de la confidence, organiser tout cela va assez vite : trouver une salle, des moyens de transport, etc. Ce qui est plus long et plus délicat au fond, c’est d’acheminer l’information auprès de tous les membres et de collecter leurs réponses ! » Veuf depuis quelques années, sans frères ni sœurs, l’homme qui déborde d’enthousiasme, donne de son temps avec beaucoup de générosité : « je n’ai plus de famille et mes amicaliens, sont donc un peu mes chéris ! Il est tout à fait normal que je leur rende ce qu’ils me donnent ». Une fois la partie officielle terminée, les invités se sont rendus en bus spécial des transports lausannois (Richard Vuille est un ancien de la maison !), jusqu’au restaurant du Port de Paudex. « Au départ, nous avions pensé nous y rendre tous en bateau depuis Ouchy » , explique le président de l’amicale de Lausanne. « Mais en raison des incertitudes liées au temps, en cet été plus que maussade, nous avons privilégié l’option du bus » . Port de Paudex Après un magnifique apéritif partagé dans la bonne humeur sur la terrasse du restaurant, les convives se sont retrouvés autour d’un succulent repas avec au menu, excusez du peu, saladine de rucola et artichauts aux éclats de Parmesan et suprême de poularde au thym et limoncello. Le reste de l’après midi a été consacré à une très agréable déambulation le long des berges du lac, permettant aux amicaliens, dont certains ne s’étaient pas rencontrés depuis une bonne année, de prendre des nouvelles les uns des autres. Avant de se quitter non sans se donner rendez-vous l’année prochaine, les invités ont reçu un petit cornet-souvenir, comportant non seulement des prospectus offerts par l’Office du tourisme de Lausanne, mais aussi un très sympathique message d’espoir de Richard Vuille retraçant l’extraordinaire avancée de la technologie en matière d’aide auditive depuis la fondation de l’amicale en 1924. Cerise sur le gateau, chaque convive a également reçu en souvenir de la journée, un superbe porte-clés – en série limitée - estampillé de la cathédrale de Lausanne. Une jolie manière de donner rendez-vous à tous dans 10 ans, pour le centenaire d’une belle amicale ! ChA SUIVANT PRECEDENT
- Et si le Covid-19 s’attaquait à l’audition ? | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Et si le Covid-19 s’attaquait à l’audition ? 21 août 2020 Publié le : Le Covid-19 pourrait s’attaquer aux cellules cochléaires des personnes infectées, même asymptomatiques. Une étude égyptienne menée sur vingt personnes et publiée en juin dernier semble l’indiquer. On le savait, et c’est même devenu un des principaux signaux d’alerte. L’infection par le coronavirus Covid-19 se traduit entre autres symptômes, par une perte d’odorat. Cette anosmie, réversible, est également souvent accompagnée d’une perte du sens du goût, dite agueusie. Pendant longtemps en revanche, on a pensé que l’audition des personnes malades était épargnée par le coronavirus, même si on sait de longue date que de nombreux virus sont capables d’altérer les fonctions auditives. Une récente étude égyptienne de l’Université de South Valley tend en tout cas à montrer que le covid-19 pourrait bel et bien impacter l’audition. Selon cette recherche publiée dans l'American Journal of Otolaryngology , ce seraient les cellules ciliés cochléaires qui seraient les cibles privilégiées du coronavirus, qu’il s’agisse de malades ou de personnes asymptomatiques, mais infectées. 20 cas positifs de personnes malades avec toux, maux de gorges etc. ou asymptomatiques ,ont été analysés et comparés à un groupe témoin de personnes non infectées. Afin d’éviter tout biais de détérioration de la capacité auditive liée au vieillissement, les personnes testées étaient toutes âgées de 20 à 50 ans. Performances moins bonnes La capacité auditive des deux groupes de participants à l’étude a ensuite été testée avec un résultat clair, objectivant des performances moins bonnes chez les personnes infectées asymptomatiques ou non, que chez celles du groupe test. « L’infection par le Covid 19 pourrait avoir des effets négatifs sur les cellules ciliées de la cochlée de personnes atteintes, quand bien même elles seraient asymptomatiques, indique Mohamed Wael Mustafa, l'auteur de l'étude du département d'oto-rhino-laryngologie de la faculté de médecine de Qena à l'Université South Valley. Le mécanisme de cet effet est à explorer par des recherches complémentaires » . «Les résultats de la présente étude ont également démontré que l'absence de symptômes majeurs peut masquer un impact inconnu sur les organes sensoriels délicats, comme par exemple la cochlée. » SUIVANT PRECEDENT
- Boucles magnétiques : Une technologie performante mais encore peu répandue | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Boucles magnétiques : Une technologie performante mais encore peu répandue 15 septembre 2010 Publié le : Inventées il y a plus de 50 ans, les boucles magnétiques peuvent améliorer considérablement la vie des malentendants. Pourtant, malgré leur indiscutable intérêt, elles peinent à s’imposer, particulièrement dans les lieux publics de Suisse romande. C’est l’histoire d’une technologie qui existe depuis des lustres, d’une technologie à l’efficacité avérée, mais qui, paradoxalement, peine à s’imposer, en Europe comme en Suisse, même si des progrès notables ont été observés au cours des dernières années. Inventées au milieu du 20e siècle, dans les années 50, les boucles magnétiques, qui peuvent considérablement améliorer la vie quotidienne des malentendants, sont en effet loin d’être exploitées selon leur très prometteur potentiel. Anne Grassi, responsable des boucles à forom écoute, la fondation romande des malentendants, semble avoir l’ébauche d’une explication : « Il s’agit d’une technologie invisible pour un handicap invisible, déplore-t-elle. Cela explique très probablement les difficultés que l’on observe pour favoriser leur implantation sur le terrain ! » Signal utile Mais de quoi s’agit-il exactement ? « Les boucles magnétiques sont vieilles comme Hérode, observe Stéphane Fourreau, audioprothésiste chez Oticon. Leur but est d’améliorer ce que l’on appelle dans le jargon, le rapport signal sur bruit , c'est-à-dire de faciliter la perception du signal utile ». En clair, les boucles ont surtout leur utilité lorsque, dans un espace fermé, un bruit de fond vient « parasiter », le son « utile », celui que les malentendants doivent justement capter. Dès lors, l’installation d’une boucle magnétique répond à un principe relativement simple. A partir de la source sonore que l’on veut privilégier et que l’on relie à un amplificateur, on fait courir un câble auquel on fera effectuer plusieurs boucles, plusieurs spires, tout autour du lieu où l’on souhaite amplifier le signal utile. « C’est tout simplement le principe d’une bobine magnétique, explique encore Stéphane Fourreau. Le signal audio parcourt le câble et selon son intensité et le nombre de spires, va induire un champ magnétique, d’où le nom de boucles à induction magnétique ». La suite est très simple à comprendre : les appareils auditifs dont sont équipés les malentendants agissent ensuite comme des récepteurs et vont capter le champ magnétique produit par la boucle, pour à nouveau le convertir en son audible. Résultat : pour quelques milliers de francs au maximum, il est en effet possible d’améliorer considérablement le confort d’écoute des malentendants. Meilleure compréhension « Dès lors que l’on souffre d’une perte auditive moyenne, les boucles magnétiques sont incontestablement utiles, explique Anne Grassi. Grâce à la boucle, on n’entend que l’interlocuteur, la télévision ou la radio, et rien des bruits de fond. La compréhension est vraiment meilleure, même si cela nécessite un peu d’habitude, car le son de la boucle est légèrement différent. C’est pourquoi je conseille toujours d’augmenter le volume de son appareil pour mieux entendre ». « Lorsque le cinéma Rex a été équipé d’une boucle, se souvient Jean-Michel Péclard, délégué technique à l’AVACAH, l’association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés, les malentendants qui ont pu suivre un film pour la première fois avaient les larmes aux yeux. C’était très émouvant ! » Tout serait donc parfait dans le meilleur des mondes possibles, si la pose et l’utilisation des boucles, pour simples qu’elles soient, ne nécessitaient pas une certaine rigueur. « Ceux qui posent les boucles n’ont parfois pas toujours tout compris, s’esclaffe Simone Jeannet, malentendante, membre de la commission « Boucles magnétiques » de forom écoute, et présidente de l’AMALCO, l’association des malentendants de la Côte. J’ai le souvenir d’un installateur qui avait branché des micros d’ambiance sur la boucle, ce qui va à l’encontre même du principe de base qui consiste à privilégier le son utile ! Une autre fois, on avait purement et simplement oublié de brancher… l’amplificateur ! » Astuces Autre problème : souvent, les audioprothésistes ne pensent pas à informer leurs patients de l’existence, sur leur appareil, de la fameuse position T, qui permet de se brancher sur la boucle. « Il arrive que nous ayons des doléances de la part de personnes malentendantes, remarque un installateur genevois. Lorsque l’on contrôle la boucle, on constate qu’elle fonctionne très bien, mais que les gens oublient simplement d’enclencher leur appareil en position T. » « Une fois, une dame s’est installée sur une chaise posée sur le câble lui-même, se souvient Adel Hamdan, audioprothésiste à Genève. Elle était assise dans la zone où l’intensité du champ magnétique était maximale. Elle n’était évidemment pas contente car le son qu’elle percevait était beaucoup trop fort. En fait, il y a quand même quelques astuces pour savoir se placer par rapport à une boucle magnétique ! » Résultat : « Les malentendants ne doivent pas hésiter à nous approcher pour savoir quels sont les lieux équipés d’une boucle magnétique, et pour se renseigner sur la meilleure manière de les utiliser, invite Anne Grassi de forom écoute. Nous souhaiterions qu’ils nous signalent les lieux encore à équiper et même qu’il y ait des personnes qui collaborent avec nous pour tester les boucles ! » Autre précision : jadis répandues dans les domiciles, les boucles magnétiques y ont perdu toute raison d’être. « Il y a encore une quinzaine d’années, j’installais énormément de boucles dans les domiciles des personnes malentendantes. Aujourd’hui, je n’ai plus aucune demande. Avec les avancées technologiques et les nouveaux appareils, les gens n’en ont plus besoin chez eux, constate un installateur établi à Neuchâtel ». « En revanche, tient-il à préciser, il est évident que les boucles ont un bel avenir devant elles dans tous les lieux publics ! » Loi fédérale « Bizarrement, c’est une technologie qui n’a jamais réussi à vraiment s’imposer dans les espaces publics, alors qu’elle ne coûte presque rien, fonctionne très bien, et répond aux besoins des utilisateurs, renchérit Stéphane Fourreau, audioprothésiste chez Oticon. Et pour des raisons culturelles, la Suisse alémanique, plus sensible aux questions d’ergonomie, est bien mieux équipée que la Suisse romande ! » Ce retard, qui peut aussi être imputé aux traditionnelles réticences des personnes malentendantes à assumer leur handicap et à revendiquer des installations appropriées, pourrait tout à fait se résorber dans les années à venir. Depuis 2004 en effet, la Suisse s’est dotée d’une loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées, (LHand) qui a clairement fait avancer la problématique. En outre, les nouvelles normes en vigueur depuis janvier 2009, imposent l’installation systématique de boucles magnétiques en cas d’érection de nouvelles constructions et même de mise en rénovation d’anciens bâtiments. « Toute salle publique de plus de 80 m2 doit aujourd’hui obligatoirement être équipée d’une boucle magnétique, commente Jean-Michel Péclard, de l’AVACAH. C’est une avancée considérable, car cela permet à notre association de formuler des oppositions lorsque ces normes ne sont pas respectées ! » Vieux bâtiments Seul bémol : les bâtiments anciens qui ne prévoient pas de rénovation - et ils sont nombreux en Suisse -, ne sont pas concernés par l’étendue de la nouvelle législation en vigueur, et il n’y a dans ce cas aucune obligation légale à équiper le site de boucles magnétiques. La démarche est laissée… au bon vouloir des propriétaires des lieux, qui parfois peuvent faire preuve de mauvaise volonté. « Nous rencontrons encore beaucoup de résistances, témoigne Jean-Michel Péclard. Dans un grand cinéma lausannois par exemple, nous n’avons aucun moyen de pression sur la direction, car il n’y a aucune demande de mise à l’enquête pour ce lieu. Résultat : le dossier n’avance pas depuis des années, et la situation ne risque pas d’évoluer avant un bon moment ! » Charaf Abdessemed [zone]forom écoute s’engage Depuis de nombreuses années, forom écoute s’engage activement dans la promotion des boucles magnétiques, en contribuant, jusqu’à concurrence de 1000 francs, au financement de leur acquisition et de leur installation. La fondation tient également à jour une liste non exhaustive (disponible sur le site www.ecoute.ch ), de l’ensemble des sites de Suisse romande équipés de cette technologie. Enfin, une brochure très complète intitulée « Boucles magnétiques, où les trouver, leur utilisation, leur maintenance » a été éditée et est disponible sur demande.[/zone] SUIVANT PRECEDENT
- Une professionnelle engagée au service de la perte auditive | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Une professionnelle engagée au service de la perte auditive 14 mai 2018 Publié le : Peu visible, la malentendance nécessite un accompagnement destiné à la personne touchée par ce déficit ou à ses proches. Rencontre avec la psychologue spécialiste en Psychothérapie FSP/ACP, Corinne Béran, spécialisée en surdité, LSF, LPC. Corinne Béran nous explique, à travers ces lignes, l’importance du coaching des personnes présentant cette différence à peine perceptible et déplore la pénurie de psychiatres spécialisés en surdité. Portrait d’une femme très engagée, humaniste, qui exerce sa profession depuis une quinzaine d’années, parce qu’elle était attirée par le monde de la communication autre que par la parole, au moment de ses études de psychologie. « Vu de l’extérieur, cela semble étrange de communiquer « sans rien dire », uniquement par des gestes. Le travail de la comédienne française Emmanuelle Laborit, sourde de naissance qui a reçu le Molière de la révélation théâtrale pour son rôle dans « Les enfants du silence » m’a réellement interpelé, au point de vouloir appréhender ce phénomène », explique Corinne Béran. Une méthode emphatique et individuelle Basé sur la méthode rogérienne du psychologue Carl Rogers, qui met l’accent sur la qualité de la relation entre le patient et le thérapeute agissant avec empathie, adéquation et considération positive inconditionnelle, le travail de la thérapeute consiste à accompagner individuellement des personnes sourdes, malentendantes et leurs proches, la plupart adultes. Les suivis abordent régulièrement des thématiques comme la honte, le déni, l’isolement, le besoin de s’identifier, le besoin de reconnaissance, l’acceptation de la réalité, la reconnaissance de ses limites, des barrières à faire tomber. « A posteriori, la malentandance étant à l’ordinaire inapparente, certaines personnes restent dans une attitude de déni et font illusion. Leur entourage peut croire en une normalité retrouvée à travers l’appareillage et l’oralisation. Un jour, malheureusement, lorsque les limites sont atteintes, accompagnées d’une lancinante fatigue, ils craquent parfois». Interaction Corinne Béran effectue des entretiens dans son cabinet privé lausannois avec comme support le Langage Parlé Complété, LPC, la Langue des Signes, LSF, des boucles magnétiques portables ou sans soutien à la communication. La vaudoise, âgée de 46 ans, a acquis une connaissance approfondie du réseau spécialisé en surdité professionnel et associatif. Elle collabore régulièrement avec le Service d’Aide à l’Intégration, SAI, le Service Itinérant Surdité, SIS, Pro Infirmis, Le Repuis et l’Assurance Invalidité, l’OAI. « Le financement de mon travail varie d’une personne à l’autre : l’assurance maladie complémentaire, par la personne elle-même, lors de réinsertion professionnelle l’OAI peut intervenir et finalement Pro Infirmis.». Chaque patient est différent, l’approche est personnalisée et individuelle Diplômée de l’Université de Lausanne et Genève en psychologie en 1997, Corinne Béran obtient le titre de Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP en 2015. Depuis, elle participe régulièrement à des groupes d‘Intervision en psychothérapie centrée sur la personne, d’Intervision entre psychologues travaillant dans le domaine de la surdité. Dernièrement, elle a suivi une formation sur « L’utilité de la psychopathologie pour la prise en charge thérapeutique des demandeurs d’asile - Psychose, traumatisme, dissociation et culture », organisée par l’association Appartenances. « Je suis actuellement une formation sur la Psychothérapie sensori-motrice, IRPT. C’est une approche sensorimotrice pour accompagner les personnes traumatisées ou présentant des troubles de l’attachement. Les traumas s’expriment parfois par des maladies psychosomatiques ou des réactions physiques, majeures ou plus minimes. L’objectif de cette approche thérapeutique consiste à prendre conscience de soi et de comment réagit son corps et de développer de nouveau comportement, aptitude, en travaillant le traumatisme. » Entre 1996 et 2002, la psychothérapeute a participé au cours de LSF auprès de la Fédération Suisse des Sourds et de 2004 et 2007 au cycle d’études avancées « Surdité » auprès de la haute école pédagogique, HEP. « Je participe régulièrement à des formations dans le domaine de la surdité, week-ends de formation en LPC, niveau moyen, et aux Journées de formation organisées par le Groupement romand des professionnels de la surdité, GRPS ou la Fédération suisse des sourds, FSS depuis 14 ans ». Elle a par ailleurs travaillé comme éducatrice spécialisée au Centre Jeunes Sourds à Lausanne entre 2003-2007. Suivi bifocal Corinne Béran propose également un suivi bifocal pour les parents d’enfants sourds. « Durant la période de périnatalité, nous accueillons, avec la doctoresse Hélène Veuthey, psychiatre psychothérapeute FMH, spécialisée en périnatalité, des couples en détresse qui ont besoin d’un accompagnement spécialisé en surdité, mais également en périnatalité ». Les personnes qui s’adressent à mon cabinet sont en lien avec une situation de surdité, soit des personnes sourdes de naissance, malentendantes, devenues sourdes ou présentant une perte soudaine de l’audition et parfois également des parents d’enfants sourds. Les demandes sont de tout type. Accompagnements dans le processus d’implantation cochléaire, mesure de réinsertion professionnelle, acceptation et gestion du handicap, demande de soutien suite à une dépression, un deuil, une migration, etc ». Son cabinet accueille des patients principalement domiciliés dans le canton de Vaud, mais également dans les cantons de Fribourg et Valais et parfois du Jura, Neuchâtel et Berne. Où sont les psychiatres et la relève ? En Suisse romande, on compte sur les doigts d’une main les psychothérapeutes spécialisés en surdité. Les cabinets de psychiatres connaissant ce domaine, dont les frais seraient pris en charge, n’existent pas encore. Alors qui prendra la relève ? « Il n’existe que très peu de spécialistes en surdité et le grand problème réside dans le financement. Les autorités compétentes font « la sourde oreille ». Cette problématique concerne la prise en charge de la santé en général des personnes sourdes et pas seulement de la santé mentale. « Je pense que le bon fonctionnement de certains services mis en place, comme Le Repuis, centre de formation professionnelle et sociale vaudois, est dépendant de la volonté de la Direction des centres de formation spécialisés d'engager et de former des collaborateurs avec des compétences spécifiques en lien avec les différentes surdités. Mais si ces professionnels formés quittent leur poste pour une raison ou pour une autre, que se passera-t-il ? Aucun engagement politique n’assure la pérennité de telles démarches ». Implications dans le réseau Impliquée depuis 2003, Corinne Béran participe à différentes activités associatives. Elle est membre du comité du GRPS, depuis 2015 et a repris la fonction de présidente l’année passée, elle a encadré pendant 2 ans une psychologue stagiaire, participe aux réunions entre professionnels de la surdité et a contribué à l’organisation de séminaires de formation à la surdité des collaborateurs de l’OAI de Vevey. Corinne Béran sera prochainement l’animatrice de groupes de paroles pour personnes malentendantes. Groupes de paroles pour les personnes malentendantes En collaboration avec forom écoute, avec qui elle est en lien depuis plusieurs années, Corinne Béran crée des groupes de parole pour personnes malentendantes à venir tout prochainement. « Je souhaite, à travers ce projet, leur permettre de créer des liens, de se sentir moins seul, de profiter de l’expérience de chacun pour trouver des solutions respectueuses de leurs limites ». Subventionnées en partie par l’OFAS, ces rencontres auront lieu dans son cabinet Boulevard de Grancy et les inscriptions s’effectuent directement sur le site de forom écoute. Au vu du nombre de personnes à l’AI qui paraissent intéressées, deux groupes devraient démarrer de manière bimensuelle les lundis et mardis (voir encadré ci-contre). [border-around color="blue"]Groupe de paroles pour personnes malentendantes Les rencontres bimensuelles, animées par la psychologue spécialiste en Psychothérapie FSP/ACP, Corinne Béran, spécialisée en surdité, LSF, LPC, devraient démarrer dès la rentrée 2018. Mardi 4 septembre 2018 entre 18h et 19h30, Lundi 10 septembre 2018 entre 14h et 15h30. Maximum 7 personnes par groupe. Bld de Grancy 1, 1006 Lausanne Les inscriptions s’effectuent sur www.ecoute.ch , sous la rubrique CONTACT.[/border-around] SUIVANT PRECEDENT
- Une course pour faire parler de la malentendance | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Une course pour faire parler de la malentendance 19 septembre 2018 Publié le : Pour sa 29ème édition, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, qui se déroulera du 15 au 30 mars 2019, verra une équipe suisse concourir, dont le but est de promouvoir la malentendance et la surdité. Depuis 1990 déjà, Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est réservé à la gente féminine de 18 à 71 ans, qui parcourt le pays durant neuf jours. Le concept de cette compétition automobile a pour objectif la tolérance, la solidarité et la persévérance. Ni vitesse, ni GPS n’entrent en ligne de compte ; la navigation à l’ancienne uniquement hors-piste est privilégiée. A travers l’association « Surdigaz’Elles » l’initiatrice du projet, Laure Francesconi, prépare cette course d’arrachepied, actuellement à la recherche de sponsors. Surdigaz’Elles veut médiatiser la malentendance L’objectif principal de Surdigaz’Elles est de faire parler de la malentendance et de la surdité. En aparté de son travail au sein de l’Association Romande des Enseignantes en Lecture Labiale (ARELL), Laure soutient, via des traductions, une personne sourde participant au Rallye Paris-Dakar. « L’idée m’est venue de prendre une personne malentendante comme co-pilote ; c’est évidemment compliqué. Elle devra enlever son appareil et nous préparerons des mots code pour simplifier nos échanges ». Valérie Adatte sera ainsi la première malentendante à participer à la compétition. Agée de 50 ans, elle travaille dans le domaine social depuis de nombreuses années. [caption id="attachment_4990" align="alignnone" width="225"] Les pro du pilotage posent fièrement devant le projet qui leur tient à coeur[/caption] Récemment diplômée, elle est assistante socio-éducative et collabore avec la Fondation les Castors, au Foyer de Porrentruy. Ancienne membre du Conseil de fondation de forom écoute, elle endossera son brassard. Atteinte de déficience auditive, elle a subi une opération à l’oreille gauche lui permettant d’entendre à 86%, quant à l’oreille droite, elle atteint seulement 15%. Cela n’empêche pas cette mère de trois enfants de braver certaines contraintes liées à la course et de se lancer sur la route. Au contraire, Valérie est très motivée, sensibilisée également par des situations alarmantes. « En effet, je connais une malentendante qui n’ose pas faire ses courses de peur de déranger les gens qui pourraient l’aider. D’autre part, une collaboratrice a lu un article sur notre projet et a découvert que la lecture labiale existait. C’est un comble de vivre dans ces conditions », s’exclame-t-elle. Recherche de fonds Le projet constitue 100% de bénévolat. Préparation de dossiers, déplacements afin de visiter d’éventuels sponsors, etc. « Au stade actuel, nous devons trouver CHF 40'000.- avant le 31 décembre 2018 pour le réaliser. A contrario, nous devrons reporter la compétition en 2020. Les fonds représentent les investissements pour le véhicule loué par ZZ Automobile groupe SA, la balise de sécurité détectable à 1 mètre (obligatoire), ainsi qu’un stage de 2 jours pour la prise en main du véhicule, un second de 2 jours à Avignon pour apprendre à maîtriser la navigation et un troisième de 2 jours pour la mécanique. Préparation mentale et physique « Outre des activités sportives mi-hebdomadaires, je tente de visualiser la course et m’y projette chaque jour, visite de long en large le site du Rallye, m’inspirant des témoignages et des images que je partage via les réseaux sociaux, et surtout, je concentre mentalement mes capacités pour arriver au bout de la course ». Le Rallye Aïcha des Gazelles est réputé pour la solidarité des équipes. Lorsqu’une d’elles essuie un problème, les autres doivent s’arrêter pour tenter de l'aider, sinon elles sont pénalisées sur le classement final. [caption id="attachment_4991" align="aligncenter" width="225"] Tenue appropriée pour découvrir le matériel en vue de la course[/caption] « Si la peur de l’inconnu est présente, je suis animée par ma participation au service de la malaudition qui dure depuis vingt ans et je me concentre surtout sur les fonds nécessaires à trouver ». Hors-course L’organisation humanitaire Cœur de Gazelles se déplace en caravane médicale itinérante au sud du Maroc depuis 17 ans pour donner accès aux soins aux populations les plus reculées lors de la course, Innovant, du matériel et des informations sur la malentendance et la surdité seront distribués en mars prochain. « Si un ORL ou audioprothésiste pouvait se joindre au voyage, ce serait idéal ». Au-delà de la course, Surdigaz’Elles poursuit ses efforts en Suisse romande afin de créer un fonds d’entraide pour les personnes souffrant d’une déficience auditive (moyens auxiliaires, financement, etc), car la participation de l’AI pour un appareillage est partiel, le problème persiste … Découvrez les moments forts des précédentes éditions sur : www.rallyeaichdesgazelles.com Gazelles TV est présente sur l’opération chaque année, en développant un pool images. Surdigaz’Elles, Sous la Roche Bourquin 24, 2952 Cornol laure.francesconi@arell.ch Compte Poste Délémont : IBAN CH 0900 0000 1507 9250 9 En équivalent : matériel, accessoires, fournitures… Légendes photos: 1 Valérie Adatte à gauche et Laure Fransesconi à droite découvrent un véhicule dédié au Rallye qu’elles loueront auprès de ZZ Automobiles groupe SA 2 Tenue appropriée pour découvrir le matériel en vue de la course 3 Les pro du pilotage posent fièrement devant le projet qui leur tient à coeur SUIVANT PRECEDENT
- En randonnée sur les cimes | FoRom Ecoute
Retour au Magazine En randonnée sur les cimes 15 septembre 2012 Publié le : A 82 ans, Françoise Doutre-Roussel a plus de 50 ans de randonnées et de sorties en montagne dans les jambes. Qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il vente, cette passionnée discrète et bienveillante affiche une forme éblouissante et n’hésite pas à affronter les éléments pour aller à la rencontre de la nature. Retour sur une aventure hors norme. Rarement, rubrique de magazine aura autant mérité son nom. Car des escapades, Françoise Doutre-Roussel, malentendante légère en raison d’une presbyacousie, en pratique depuis… une bonne cinquantaine d’années. Et au rythme de plusieurs dizaines par an ! Etrange tout de même, que cette rencontre entre une fille de la ville, - Françoise est née et a grandi à Paris -, et le monde de la montagne. Comme souvent dans la vie, tout a commencé par… un malheur. Très jeune, Françoise souffre en effet de tuberculose. Pour l’aider à guérir, c’est tout naturellement en montagne, en Savoie qu’on l’envoie. « J’ai à ce moment-là fait la connaissance du massif de la Meije, raconte-t-elle. Et pour moi qui sortais de mes barres d’immeubles à Paris, ce premier contact avec la montagne a été un véritable coup de foudre. J’ai trouvé ça extraordinaire !» Compétitions Mais il était écrit que cette rencontre n’était qu’un premier rendez-vous avec le monde des cimes. Quelques années plus tard, - c’était il y a plus de cinquante ans ! -, c’est l’amour qui amènera en Suisse, dans le canton de Vaud, celle qui deviendra la maman de Michèle Bruttin, l’actuelle présidente de forom écoute. Et dès 1961, la jeune Françoise adhère à son club de montagne, le Piolet-Club de Renens-Lausanne (www.piolet-club.ch), dont elle est aujourd’hui encore membre. Et là, par le biais du club et au hasard des rencontres, Françoise apprend peu à peu à apprivoiser le monde de la montagne. « J’ai dû tout apprendre, raconte-t-elle avec sa réserve coutumière. Le ski, le ski de fond, la randonnée à peau de phoque, et même la varappe, le mot que l’on utilise dans le jargon pour parler… d’escalade. » Et dans cet univers, les sorties qui peuvent durer une journée entière voire plus, ne se comptent pas en kilomètres mais… en mètres de dénivelé. Petit à petit, année après année, le métier rentre, et Françoise Doutre-Roussel affiche de jolies performances. « C’est sûr, je n’ai pas fait le Mont Rose (second plus haut massif des Alpes après le Mont-Blanc, ndlr) du jour au lendemain, et je me rappelle qu’à mes débuts j’étais épuisée toute la semaine, jusqu’au jeudi. Ce qui ne m’empêchait pas de recommencer le week-end suivant ! » Amitié Car au bout de l’effort, il y a bien sûr l’extraordinaire sensation de plénitude que l’on éprouve lorsqu’on va à la rencontre de la nature, de soi-même, mais aussi des autres. « Le monde de la montagne, reprend Françoise, c’est aussi le monde de l’amitié et de la camaraderie. On s’entraide, on apprend à se connaître et on fait même des tas de choses ensemble. Et cela dure depuis 50 ans ! » Certaines amitiés peuvent néanmoins parfois être mises à mal par la dure loi de la nature. Car la montagne est un monde impitoyable pour qui n’en maîtrise pas les règles, et il arrive qu’elle impose sa loi à ceux qui tentent de la conquérir. Car un jour, alors qu’elle était en varappe à la Dent de Morcles, accompagnée de deux amis, la catastrophe survient. « C’était il y a une trentaine d’années, se souvient-elle avec pudeur. Celui de mes amis qui était en dernier a déroché, son piton s’est descellé, il est tombé et y a laissé sa vie. J’ai eu tellement peur que j’ai décidé d’arrêter la varappe. » Nouvelles activités Aujourd’hui, à 82 ans, cette amoureuse de la vie et des plaisirs simples, qui garde bon pied bon œil et ne fait vraiment pas son âge, pratique encore allègrement les sports de montagne. « Actuellement, nous préparons une sortie au Molard, lance-t-elle devant la carte dépliée sur la table de son salon. Bien sûr, on s’adapte à notre âge et on fait des randonnées moins difficiles et moins éprouvantes. Et chaque hiver, je fais de nombreuses sorties en raquettes, moins exigeantes. Je n’ignore pas que la montagne a beaucoup contribué à me maintenir en forme, mais je fais plus attention. Désormais, je cherche de nouvelles activités pour rencontrer des gens et me tourne gentiment vers d’autres associations, comme l’amicale des malentendants de Morges ». Aujourd’hui, Françoise Doutre-Roussel n’a qu’un seul regret. Celui qui agite depuis des décennies, des générations entières de grimpeurs. Car le mythique et majestueux Mont-Blanc s’est refusé à elle. « Nous étions bien partis pour y arriver, se souvient-elle avec une pointe de nostalgie dans la voix. Nous sommes arrivés jusqu’au refuge, mais en raison du mauvais temps, on a dû se résoudre à redescendre ! » Et cette éternelle optimiste de conclure: « ce n’est pas bien grave. Ceux qui sont parvenus jusqu’au sommet racontent souvent qu’ils ont été très déçus par la vue ! » ChA SUIVANT PRECEDENT
- Participez à ce sondage pour améliorer l’orthographe des jeunes malentendants de 8 à 12 ans | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Participez à ce sondage pour améliorer l’orthographe des jeunes malentendants de 8 à 12 ans 25 mars 2021 Publié le : Une équipe de recherche de l’Université Libre de Bruxelles cherche à comprendre comment les enfants malentendants intègrent l’orthographe des mots pour les aider à améliorer celle-ci. Vous pouvez participer à cette enquête en ligne jusqu’au 30 avril. Lorsqu’ils lisent, les enfants ne cessent de rencontrer l’orthographe de nouveaux mots pour la première fois. Ils doivent à chaque fois l’apprendre, la mémoriser et être capables de la restituer afin d’apprendre à communiquer efficacement dans une société où l’écrit occupe une place essentielle, via les emails, les services en lignes, les courriers aux administrations… Comment ce processus se déroule-t-il en revanche pour les enfants qui présentent une déficience auditive ? Comment les enfants malentendants et sourds retiennent-ils l’orthographe des mots ? Une équipe de recherche de l’Université Libre de Bruxelles cherche à trouver des réponses à ces questions via une étude à compléter en ligne et sur inscription. « A l’heure actuelle, les études sur l’apprentissage et la maitrise de l’orthographe chez les enfants sourds et malentendants, restent rares, voire inexistantes, notamment pour le français écrit » observe Elodie Sabatier, doctorante à l’Université Libre de Bruxelles et impliquée dans la recherche. D’une durée de 30 minutes, l’étude est ouverte à tous les enfants âgés de 8 à 12 ans et présentant une déficience auditive, qu’ils utilisent une communication signée, et/ou orale, avec ou sans LPC et qu’il soit équipés ou non de prothèses auditives ou d’implants cochléaires. État des lieux et adaptation des méthodes « Concrètement, il s'agit de faire un état des lieux de l'apprentissage du français écrit par les enfants sourds et malentendants francophones, en les suivant sur 3 ans, explique Elodie Sabatier. Les résultats de cette étude devraient permettre à terme d'adapter les méthodes d'évaluation de l'orthographe qui existent actuellement pour les praticiens comme les logopédistes, les neuropsychologues et/ou les professeurs à l'école ». Cette recherche s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet européen autour de la surdité intitulé Comm4CHILD (Communication for Children with Hearing Impairment to optimise Language Development), qui s’intéresse à la variabilité interindividuelle de la plasticité cérébrale, aux ressources cognitives et aux capacités linguistiques et communicationnelles chez les enfants porteurs de déficience auditive. Pour participer, et pour des raisons de confidentialité, il faut s’inscrire auprès d’Elodie Sabatier, par e mail elodie.sabatier@ulb.be ou par Facebook : https://fb.me/Comm4CHILD.ElodieSabatier . L’étude est ouverte jusqu’au 30 avril et u n feedback sur les résultats sera donné à l'été 2021. SUIVANT PRECEDENT
- Témoignage: Moi, Darja, malentendante slovène et maman de 3 enfants | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Témoignage: Moi, Darja, malentendante slovène et maman de 3 enfants 6 juillet 2017 Publié le : La Slovène Darja Pajk fait face à une déficience auditive depuis l'âge de 23 ans. Au début, elle en avait honte et se sentait à la fois solitaire, mal comprise et effrayée. Aujourd'hui, elle a accepté sa déficience auditive et reconnaît l'importance de dire aux gens qui l'entourent qu’elle est déficiente auditive ainsi que des avantages de parler avec d'autres personnes déficientes auditives. Darja Pajk, âgée de 48 ans, travaille depuis 25 ans avec des personnes handicapées et a mis au monde trois filles. Par la suite, elle a dû affronter une déficience auditive progressive et inexplicable depuis l’âge de 23 ans. À ce stade, Darja a complètement perdu son audition et utilise des implants cochléaires qui lui permettent d'entendre. Au préalable, elle a bénéficié de l’utilisation d’appareils auditifs. Comme elle l'explique, les implants cochléaires se sont révélés indispensables pour faire partie du monde des entendants et empêcher la déficience auditive de la couper du monde : « Sans appareils auditifs et mes implants cochléaires maintenant, je me sentirais perdue ». Au départ, Darja a eu recours d'abord à des appareils auditifs, jusqu'à ce qu'elle reçoive des implants cochléaires. Aujourd'hui, elle ne peut même pas s’imaginer comment elle aurait pu travailler sans eux. Dans son métier, elle est en constante conversation avec ses interlocuteurs et cela n’aurait pas été possible sans appareils auditifs. Ainsi, selon elle, les appareils auditifs étaient une partie intégrante de sa personne. Difficultés à accepter la situation Sauf que Darja n'a pas toujours apprécié ses appareils auditifs. Au début, elle a éprouvé beaucoup de mal à les accepter, au point d'en avoir honte et les cacher sous ses longs cheveux, s'imaginant que les autres ne l’apprécieraient pas et que sa déficience auditive l’isolerait socialement. De fait, elle a choisi de ne pas révéler aux autres l'existence de sa déficience auditive obtenant un résultat inverse, se sentant seule et incomprise.. À titre d'exemple, Darja décrit comment elle a commencer à craindre de conduire des conversations avec des personnes qui ne connaissaient pas sa déficience auditive, au point d'en arriver à éviter ce genre de situations, comme les activités à l'école de ses enfants. Se sentir reconnue Après avoir vécu avec une déficience auditive pendant 15 ans, Darja a finalement accepté ses circonstances et décidé de ne pas avoir l'impression qu’elle était néfaste. C'est à ce moment là qu'elle a commencé à dévoiler sa déficience auditive aux autres : «Les gens ont réagi normalement et j'ai finalement été reconnue à nouveau. Maintenant, tous mes amis, collègues, voisins et amis de mes filles savent que je suis malentendante. Ils comprennent la situation et la plupart d'entre eux l'acceptent très bien.» Récemment, Darja s’est engagée dans l'Association des sourds et malentendants en Slovénie. Elle y a rencontré des personnes présentant les mêmes problèmes qu’elle et qui capables de comprendre parfaitement sa situation. Résultat, les conseils de Darja à d'autres personnes qui éprouvent des problèmes auditifs sont clairs : à côté de leur expérience personnelle et d’un contrôle pour vérifier si les appareils auditifs s’avèrent utiles, Darja recommande aux personnes malentendantes de révéler leur problème auditif aux autres et de chercher quelqu'un avec des problèmes similaires afin d’en parler. (Source: www.hear-it.org ) SUIVANT PRECEDENT
- Guillaume Berbier : « Devenir cantonnier, mon rêve d’enfance » | FoRom Ecoute
Retour au Magazine Guillaume Berbier : « Devenir cantonnier, mon rêve d’enfance » 21 décembre 2016 Publié le : Âgé de 20 ans, Guillaume Berbier vit aux Pommerats, dans le canton du Jura. Sportif, travailleur et déterminé, ce malentendant de naissance vient de décrocher son CFC de cantonnier. Un rêve d’enfant qu’il a exaucé en juin dernier, après des années d’efforts. En juin dernier, vous avez décroché votre CFC d’agent d’exploitation. Où avez-vous effectué votre apprentissage ? A la commune de Noirmont pendant 3 ans, puis j'ai effectué une 4e année au canton du Jura, à Porrentury. Les cours théoriques en revanche, se sont déroulés à Neuchâtel. Cela a-t-il été facile de décrocher cet apprentissage ? Non pas du tout, car il y avait très peu de places d'apprentissage dans la région. J'ai alors effectué deux postulations dans des communes, qui ont décidé de former un apprenti, dont la commune du Noirmont. Agent d’exploitation, en quoi cela consiste-t-il ? En fait, c’est tout simplement un travail de cantonnier et concierge : entretien des routes et des espaces verts, maintenance et entretien des bâtiments. C’est donc un métier très complet. Pourquoi avoir choisi ce métier ? C’est une passion depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours rêvé de faire ça ! Mon père l’exerçait déjà, et enfant, je l’accompagnais dès que je pouvais. En fait, je n’aime pas rester derrière un bureau, j’aime quand ça bouge ! Comment s’est déroulé votre apprentissage ? Je n'ai pas réussi mes examens en 2015, à la fin des 3 ans, j'ai alors refait une année, mais cette fois, à Porrentruy, à la division technique et au service de la voirie du canton du Jura, à Porrentruy. A quoi attribuez-vous cet échec ? Le travail est très exigeant et ce n’est pas évident de tout maîtriser dans ce métier, surtout quand on a un souci d’audition. Etant le premier apprenti à être formé par la commune, il me manquait des connaissances métier. A Porrentruy, les responsables des apprentis se sont donnés beaucoup de peine pour combler mes lacunes. Une année plus tard, en juin dernier donc, j’ai repassé mes examens avec succès et décroché mon CFC. En plus, j’ai été très bien soutenu par mes parents. Forom écoute vous a d’ailleurs décerné à cette occasion le Prix aux élèves malentendants ! Oui et j’étais très content car c’est une reconnaissance du chemin parcouru, une reconnaissance du fait que pour un malentendant, ce n’est pas évident. Mais ce n’était pas la première fois : je l’avais déjà reçu à la fin de ma scolarité obligatoire, en 2012 (rires) ! Depuis quand êtes-vous malentendant ? Depuis la naissance, et dans la famille j'ai des petits cousins qui ont aussi des problèmes d'audition. Êtes-vous appareillé ? Oui bien sûr, aux deux oreilles, depuis l’âge de 3 ans. En fait, ce qui est drôle, c’est que ma maman avait déjà senti avant ma naissance que j'aurais des problèmes d'audition, car disait-elle « je bougeais beaucoup dans son ventre, mais jamais en relation avec le bruit ». Mais aucun médecin ne l’a prise au sérieux. A l’âge de 3 ans, comme je ne parlais pas, mais surtout ne comprenait rien, les médecins ont bien dû se rendre à l’évidence. Heureusement, grâce aussi à ma logopédiste à St-Imier, chez laquelle je suis allé pendant plus de 17 ans, entre 1 à 3 fois par semaine, je me débrouille très bien avec mes appareils. Comment s’est déroulée votre scolarité ? Normalement, dans des écoles ordinaires pour personnes entendantes, dans le Jura. J’obtenais de bonnes notes, mais bien sûr au prix d’un important travail, comme pour tous les enfants malentendants. Avec mes parents, mes professeurs de soutien et ma logopédiste, nous faisions tout ce que nous pouvions pour avancer. Le plus difficile pour moi, ça a été les langues, français, allemand ou anglais. Et avec les camarades d’école, c’était comment ? Pas toujours facile ! Certains camarades n’étaient pas très ouverts à la différence. J’en avais beaucoup parlé avec ma professeure de soutien et on avait même élaboré un Powerpoint pour leur expliquer ce qu’étaient les troubles de l’audition ! Mais ça n’avait pas été très utile, et pour avancer, j’ai choisi d’ignorer ceux qui m’embêtaient et d’aller vers ceux qui étaient plus sympas. Heureusement, les enfants mûrissent et c’est devenu beaucoup plus facile après l’école obligatoire. En dehors de vos études, que faisiez-vous ? Avec un ami, du bûcheronnage, pour gagner un peu d’argent. Sinon, je faisais beaucoup de bricolage chez mes grands-parents, sans compter de la marche, du vélo et de la natation, pour laquelle je m’entraînais régulièrement… Quels sont vos projets désormais ? Trouver du travail, peu importe dans quel canton. Et puis, mon rêve, ce serait de passer le permis de conduire « camion ». J’adore conduire, et cela améliorerait mes compétences pour le travail, d’autant que les camions me passionnent depuis que je suis tout petit. Le hic, c’est qu’il faut trouver un employeur qui me le paye, car il coûte au moins 15'000 francs ! Propos recueillis par Charaf Abdessemed SUIVANT PRECEDENT